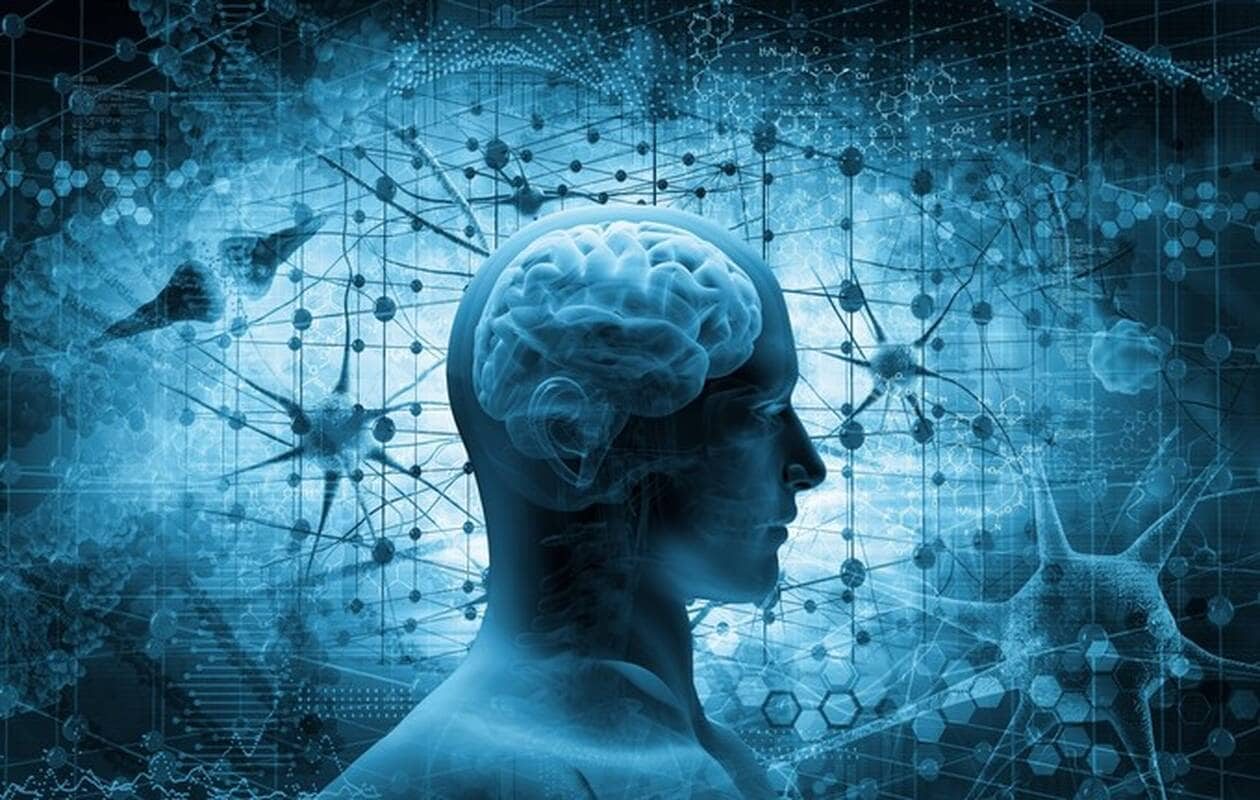La neuroscientifique Jimo Borjigin a été surprise de constater que nous ne savions « presque rien » de ce qui se passe dans le cerveau lorsque nous mourons, bien que « la mort soit une partie essentielle de la vie ».
Cette prise de conscience s’est faite il y a une dizaine d’années par « pur hasard ».
« Nous faisions des expériences sur des rats et surveillions leurs neurosécrétions cérébrales après une intervention chirurgicale », explique-t-elle à BBC News Mundo.
Soudain, deux d’entre eux sont morts.
Cela lui a permis d’observer le processus de mort de leur cerveau.
« L’un des rats présentait une sécrétion massive de sérotonine. Ce rat avait-il eu des hallucinations ? », s’est-elle demandé.
« La sérotonine est liée à l’hallucination », explique-t-elle.
Cette explosion de sérotonine – une substance chimique régulatrice de l’humeur – a éveillé sa curiosité.
« J’ai donc commencé à faire des recherches pendant le week-end, pensant qu’il devait y avoir une explication. J’ai été surprise de constater que nous en savions si peu sur le processus de la mort ».
Depuis lors, le Dr Borjigin, qui est professeure agrégée de physiologie moléculaire et intégrative, et de neurologie à l’université du Michigan, s’est consacrée à l’étude de ce qui se passe dans le cerveau lorsque nous sommes en train de mourir.
Ce qu’elle a découvert, dit-elle, va à l’encontre de ce que l’on pensait.
La définition de la mort
Elle explique que pendant longtemps, si une personne n’avait pas de pouls après un arrêt cardiaque, elle était considérée comme cliniquement morte.
Dans ce processus, l’attention se concentre sur le cœur : « On parle d’arrêt cardiaque, mais pas d’arrêt cérébral.
« La compréhension scientifique est que le cerveau semble ne pas fonctionner parce qu’il n’y a pas de réponse : ces personnes ne peuvent pas parler, ne peuvent pas se tenir debout, ne peuvent pas s’asseoir.
Le cerveau a besoin de beaucoup d’oxygène pour fonctionner. Si le cœur ne pompe pas le sang, l’oxygène ne lui parvient pas.
« Tout porte donc à croire que le cerveau ne fonctionne plus, ou du moins qu’il est hypoactif et non hyperactif », explique-t-elle.
Cependant, les recherches de son équipe montrent quelque chose de différent.
Un cerveau en « hyperpropulsion »
Dans une étude réalisée en 2013 sur des rats, les chercheurs ont observé une activité intense de plusieurs neurotransmetteurs après l’arrêt du cœur des animaux.
« La sérotonine a été multipliée par 60, et la dopamine, qui est une substance chimique qui vous fait vous sentir bien, a été multipliée par 40 à 60 ».
« La norépinéphrine, qui nous rend très alertes, a été multipliée par 100 ».
Elle précise qu’il est impossible d’observer des niveaux aussi élevés lorsque l’animal est vivant.
En 2015, l’équipe a publié une autre étude sur le cerveau de rats mourants.
« Dans les deux cas, 100 % des animaux présentaient une activation cérébrale massive et fonctionnelle », explique-t-elle.
« Le cerveau est en hyperpropulsion, dans un état d’hyperactivité ».
Ondes gamma
En 2023, ces scientifiques ont publié un travail de recherche dans lequel ils se sont intéressés à quatre patients dans le coma et sous assistance respiratoire, connectés à des électrodes pour analyser l’activité du cerveau.
Ces quatre personnes étaient en train de mourir. Les médecins et les familles se sont réunis et « pensant qu’ils étaient condamnés, ils ont décidé de les laisser partir ».
Avec l’autorisation des proches, les ventilateurs de réanimation qui les maintenaient en vie ont été débranchés.
Les chercheurs ont alors constaté que deux des patients avaient un cerveau fortement activé, ce qui est révélateur des fonctions cognitives.
Des ondes gamma – les ondes cérébrales les plus rapides – ont également été détectées. Les ondes gamma sont impliquées dans la mémoire et le traitement d’informations complexes.
L’un des patients présentait une forte activité dans les lobes temporaux des deux côtés du cerveau.
Le Dr Borjigin souligne que la jonction temporo-pariétale droite est connue pour être très importante pour l’empathie :
« De nombreux patients ayant survécu à un arrêt cardiaque [et ayant vécu] des expériences de mort imminente (EMI) disent que cela les a rendus meilleurs, qu’ils sont capables d’avoir de l’empathie pour les autres ».
Expériences de mort imminente
Certaines personnes ayant vécu une expérience de mort imminente disent avoir vu leur vie défiler devant leurs yeux ou se souvenir de moments clés.
Beaucoup disent avoir vu une lumière intense et d’autres décrivent des expériences de sortie hors du corps et l’observation de ce qu’il se passe d’en haut.
L’hyperactivité cérébrale observée par le Dr Borjigin dans ses études peut-elle expliquer pourquoi certaines personnes ont vécu des expériences aussi intenses au seuil de la mort ?
« Oui, je pense que c’est le cas », répond-elle.
« Au moins 20 à 25 % des survivants d’un arrêt cardiaque déclarent avoir vu une lumière blanche, avoir vu quelque chose, ce qui suggère que le cortex visuel est activé ».
Dans le cas des deux patients chez qui une forte activité cérébrale a été observée après l’arrêt des ventilateurs, la chercheuse indique que leurs cortex visuels (qui soutiennent la vision consciente) ont montré une activation intense « qui est potentiellement en corrélation avec cette expérience visuelle ».
Une nouvelle compréhension
Le Dr Borjigin reconnaît que son étude sur les humains est de très petite envergure et que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau lorsque nous sommes en train de mourir.
Toutefois, après plus de dix ans de recherche dans ce domaine, une chose est claire pour elle : « Je pense qu’au lieu d’être hypoactif, le cerveau est hyperactif pendant l’arrêt cardiaque ».
Mais qu’arrive-t-il au cerveau lorsqu’il se rend compte qu’il ne reçoit pas d’oxygène ?
« Nous essayons de le comprendre. Il y a donc peu de réponses dans la littérature. On ne sait vraiment rien », dit-elle.
Elle évoque l’hibernation et m’explique qu’elle émet l’hypothèse suivante : en tant qu’animaux, incluant au moins les rats et les humains, nous disposons d’un mécanisme endogène pour faire face au manque d’oxygène.
« Jusqu’à présent, on pensait que le cerveau était le spectateur innocent de l’arrêt cardiaque: lorsque le cœur s’arrête, le cerveau tombe raide mort. C’est ce qui est communément acceptée: le cerveau ne peut pas faire face à la situation et meurt ».
Mais, insiste-t-elle, nous ne savons pas, avec certitude, si c’est le cas.
Elle pense que le cerveau n’abandonne pas si facilement. Comme pour d’autres crises, il se bat :
« L’hibernation est l’un des très bons exemples qui, à mon avis, montre que le cerveau est équipé d’un mécanisme lui permettant de survivre à cette épreuve ou au manque d’oxygène. Mais cela reste à étudier ».
Beaucoup d’autres choses à découvrir
Le Dr Borjigin estime que ce qu’elle et son équipe ont découvert dans leurs études n’est que la partie émergée d’un gigantesque iceberg et qu’il reste encore beaucoup à explorer :
« Je pense que le cerveau dispose de mécanismes endogènes que nous ne comprenons pas, pour faire face à l’hypoxie [lorsqu’il est privé d’oxygène] ».
« En apparence, nous savons que les personnes qui subissent un arrêt cardiaque ont une expérience subjective étonnante, et nos données montrent que celle-ci est due à une augmentation de l’activité cérébrale ».
« La question qui se pose maintenant est la suivante : pourquoi le cerveau mourant présente-t-il une activité cérébrale accrue ? »
« Nous devons nous réunir pour comprendre, étudier, rechercher et découvrir, car nous risquons de diagnostiquer prématurément la mort de millions de personnes, puisque nous ne comprenons pas le mécanisme de la mort ».