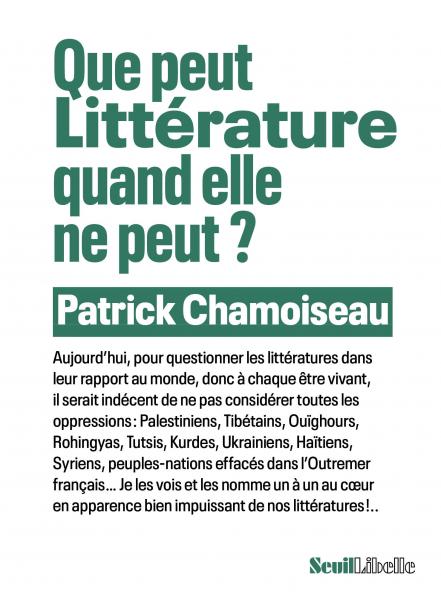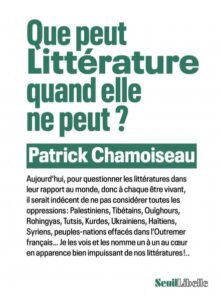
Je n’ai jamais lu Patrick Chamoiseau, il ne m’inspirait rien, mais hier, lors de l’émission la Grande Librairie du 19/02/2025 sur la Guerre (Quel est le pouvoir d’un écrivain, d’un livre ou d’un poème dans un monde en crise ? ) , il a été flamboyant de virtuosité et parle de création, de poésie, d’imaginaire, de beauté, d’amour, de puissance et de pouvoir, de liens d’humanité etc. Ce matin je suis allé a la bibliothèque de mon travail pour prendre ses ouvrages et je tombe sur Texaco son Goncourt. Entre le lecteur et un auteur c’est une histoire d’accident et d’occasion. Pape B CISSOKO
Aujourd’hui, pour questionner les littératures dans leur rapport au monde, donc à chaque être vivant, il serait indécent de ne pas considérer toutes les oppressions : Palestiniens, Tibétains, Ouïghours, Rohingyas, Tutsis, Kurdes, Ukrainiens, Haïtiens, Syriens, peuples-nations effacés dans l’Outremer français… Je les vois et les nomme un à un au cœur en apparence bien impuissant de nos littératures !…
Il rappelle combien la littérature demeure un refuge essentiel, où l’on peut renouer avec notre humanité et réenchanter notre regard sur le monde.
L’écrivain Patrick Chamoiseau raconte notre rapport au monde
Par TV5MONDE Patrice Férus
Patrick Chamoiseau, le grand écrivain martiniquais, nous présente son dernier livre « Que peut littérature quand elle ne peut ? ». Un dernier livre qui raconte notre rapport au monde, qu’il faut s’indigner et surtout avoir la force de se réinventer.
Patrick Chamoiseau : Que peut littérature quand elle ne peut ?
À quoi peuvent bien servir les mots de l’écrivain ? Cette question est au cœur du nouvel essai de Patrick Chamoiseau, Que peut littérature quand elle ne peut ? (Seuil Libelle). Dans ce qui sonne comme un cri de résistance poétique, l’ancien prix Goncourt, auteur de Texaco (Gallimard/folio) et père de la créolité, se fait la voix des peuples opprimés et montre que la littérature est, aujourd’hui plus que jamais, un espace où il est possible de renouer avec notre humanité et réenchanter nos perceptions.
Né en 1953 à Fort-de-France en Martinique, Patrick Chamoiseau effectue des études de droit et d’économie sociale avant de devenir travailleur social dans l’Hexagone puis en Martinique.
Le 9 novembre 1992, Patrick Chamoiseau, reçoit le prix Goncourt pour son troisième roman intitulé Texaco, écrit dans un français luxuriant et créolisé. Il réagira en direct sur France 2 en déclarant : « C’est toute la Martinique qui a été honorée en ce qu’elle est ».
Né en 1953 à Fort-de-France en Martinique, Patrick Chamoiseau effectue des études de droit et d’économie sociale avant de devenir travailleur social dans l’Hexagone puis en Martinique. Inspiré par l’ethnographie, il s’intéresse aux formes culturelles en disparition de son île natale, notamment l’oralité poétique des récits transmis par les conteurs. Il est fortement inspiré par l’œuvre d’Edouard Glissant (avec lequel il signera plusieurs textes), et par ses concepts de l’Antillanité et de la créolisation, phénomène qui, par l’addition d’éléments de cultures différentes dont la rencontre impromptue a été provoquée par l’histoire, en forme une nouvelle, singulière et inédite. Depuis la Martinique, il milite ainsi pour la reconnaissance non seulement du créole mais de la culture dont le créole est le symbole, en créant le mouvement de la Créolité avec Raphael Confiant et Jean Bernabé. Ensemble, ils signent en 1989 l' » »Eloge de la créolité » », texte bilingue dans lequel ils s’affirment pleinement « »créoles » » : « »Ni Européens, ni Africains, ni Asiatiques, nous nous proclamons Créoles. Cela sera pour nous une attitude intérieure, mieux : une vigilance, ou mieux encore, une sorte d’enveloppe mentale au mitan de laquelle se bâtira notre monde en pleine conscience du monde. » »
Romancier, Patrick Chamoiseau n’a cessé de varier ses genres d’écriture, de l’essai, parfois cosigné, au conte, à l’autobiographie, au scénario de cinéma (3 films avec Guy Deslauriers), de bande dessinée et même de jeu vidéo (Méwilo, en 1987, et Freedom, en 1988, avec la pionnière française du jeu vidéo Muriel Tramis).
Livre dense et puissant, Texaco raconte l’histoire du quartier populaire de l’agglomération de Fort-de-France qui porte le nom de cette compagnie pétrolière américaine qui y avait des réservoirs. A travers son personnage principal, Marie-Sophie Laborieux, dont il raconte la vie et celle de ses ancêtres dans un récit choral entremêlant plusieurs narrateurs, Patrick Chamoiseau trace la double figure d’une femme et d’un pays. Elle, Marie-Sophie, née au début du 20ème siècle, fille d’Esternome affranchi en 1848, et fondatrice du quartier de Texaco, et sa terre, la Martinique. Véritable représentation de la femme « poto mitan », elle se bat pour ce quartier où elle a rassemblé toute une société modeste et laborieuse, loin de l’univers d’exploitation des plantations de cannes à sucre, et affronte « comme toutes les femmes créoles », la police, les puissants, la malchance et un ordre colonial destructeur.
Remontant le fil des histoires familiales, Patrick Chamoiseau embrasse ainsi 150 ans d’histoire, vus par les yeux des plus humbles, depuis les dernières années de l’esclavage jusque dans les années 1980, quand un urbaniste, inspiré du personnage réel de Serge Letchimy, futur maire de Fort-de-France, explore le quartier dans le but de le rénover. Texaco est une fresque de la créolité, dans un style mélangeant l’oralité des conteurs martiniquais et l’écrit somptueux d’une langue française riche et baroque.
Dès l’été 1992, Milan Kundera salue l’oeuvre, dans les pages de la revue L’Infini : « »Contexte français et francophone ; contexte de la négritude africaine et mondiale ; contexte antillais, latino-américain, américain. Sans contester l’argumentation des uns et des autres (et sans vouloir intervenir dans un débat qui n’appartient qu’aux Martiniquais) je dirai seulement : la force, la richesse de la culture martiniquaise me semble justement due à la multiplicité des contextes médians qu’elle habite simultanément. La Martinique : intersection multiple ; carrefour des continents. » »