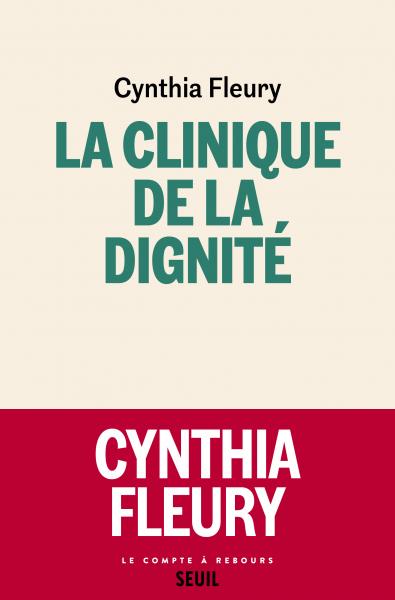L’impératif de dignité s’est imposé ces dernières années au cœur de nombreux mouvements (des Printemps arabes à Black Lives Matter) et débats de société (discriminations, travail, condition animale…). Mais simultanément les atteintes à la dignité se sont multipliées dans les institutions et les pratiques sociales (hôpitaux, EHPAD, prisons…). La promesse de dignité que la modernité annonçait semble ainsi avoir été trahie de façon répétée.
Face à cette menace d’un « devenir indigne » de nos sociétés, Cynthia Fleury pose les jalons d’une clinique de la dignité, pour établir un diagnostic philosophique et des solutions thérapeutiques au chevet des « vies indignes ». Convoquant aussi bien les écrits de James Baldwin, les théories du care ou les approches postcoloniales, cet essai invite à ne pas se résigner à l’inaction ou à la déploration. Il appelle à refonder le concept de dignité à partir de ses marges.
Passée au crible de la psychanalyse, de la littérature et des sciences sociales, l’exigence de dignité retrouve toute son actualité, et sa radicalité. Cette réflexion signe ainsi l’ouverture d’un nouvel agir politique, entièrement dédié à la reconquête d’une dignité en action à l’âge de l’anthropocène.
Cet essai est discuté et prolongé par une contribution inédite de Claire Hédon, Défenseure des droits, et par les regards de Benoît Berthelier, Benjamin Lévy et Catherine Tourette-Turgis.
Cynthia Fleury : « Nous n’avons jamais connu une époque avec autant de revendications de dignité
«Après le manque de courage et le ressentiment, Cynthia Fleury s’intéresse à la dignité dans son nouveau livre, “La Clinique de la Dignité” (Seuil). La dignité des uns est-elle compatible avec celle des autres ? La dignité est-elle menacée par la modernité ? Débat avec Cynthia Fleury ».
« ynthia Fleury : “Il faut rappeler aux individus que leur dignité est inaliénable”
À la tête de la première chaire de philosophie à l’hôpital, Cynthia Fleury en a tiré un essai en forme d’enquête sur le statut paradoxal de la dignité, promue valeur cardinale de nos sociétés mais de plus en plus bafouée dans la vie concrète. Dans un passionnant entretien paru dans notre nouveau numéro, elle analyse cette contradiction, qui court des réseaux sociaux aux quartiers sensibles.
Cynthia Fleury : “L’indignité, passager clandestin de la démocratie”philomag
Lemonde. » Cynthia Fleury : « Nos sociétés sont devenues des fabriques systémiques de situations indignes »
La psychanalyste et philosophe Cynthia Fleury appelle à refonder la dignité par le soin et déplore, dans un entretien au « Monde », le décalage tragique entre l’affirmation d’une dignité humaine universelle et la réalité des faits qui dément ce discours.
Cynthia Fleury publie « la Clinique de la dignité ». Dans son nouvel essai, la philosophe et psychanalyste convoque la notion de care pour soigner la société face à la banalisation des situations indignes. Interview.
Cynthia Fleury publie la Clinique de la dignité. DR.
- Nous avons trois valeurs en France avec la devise « Liberté, Egalité, Fraternité ». Comment la valeur Dignité a, selon vous, réussi à s’imposer ?
La notion de dignité s’impose d’autant plus qu’elle est dans un premier temps moins contrainte d’affronter sa « matérialisation ». Parler de dignité humaine, c’est immanquablement évoquer la singularité des vies, le caractère irréductible de la dignité de chaque vie. Aucune réalité matérielle, ni nos stigmates, ni notre pauvreté, ne peut symboliquement remettre en cause notre dignité. Certes, il n’est pas souhaitable que les politiques publiques se satisfassent de ce fait symbolique. Elles ont donc à créer les conditions de possibilité de la vie digne. Mais néanmoins, la notion de dignité a peut-être plus encore que les notions de liberté et d’égalité une portée symbolique qui la rend d’autant plus inaliénable, presque l’autre nom de l’être humain. Prenons le cas d’un criminel, il peut se conduire de la pire des façons, les institutions d’un Etat de droit ne devront pas, normalement, se conduire de façon indigne avec lui.
- Nos contemporains font régulièrement appel, selon vous, à cette notion de dignité. Comment le percevez-vous ?
Cette notion est partout, des marches de la dignité jusqu’à la question du mourir dans la dignité, en passant par la dignité animale. Depuis les années 60, ce sont des pans « stigmatisés » de la population qui ont revendiqué cette question de la dignité, précisément parce qu’ils en étaient privés : en tête, la communauté LGBT, les minorités ethniques, les malades du sida, les homosexuels, etc. De nos jours, c’est une terminologie qui s’infiltre partout. On peut citer les épigones de mouvements comme « Occupy Wall Street » ou le Mouvement des Indignés en Espagne. On peut évoquer les rhétoriques d’indignation aussi, depuis Stéphane Hessel et son « Indignez-vous ! ». L’indignation est souvent pour les populations les plus « vulnérables » le premier geste de militance politique.
- Vous exprimez un paradoxe dans votre livre. La dignité est devenue une valeur primordiale, mais notre société est particulièrement génératrice de situations indignes. Comment expliquez-vous cela ?
Nous n’avons jamais connu une époque avec autant de revendications de dignité. C’est une valeur clé de notre modernité occidentale. Conjointement, il y a une forme de banalisation des situations dégradées voire dégradantes, notamment dans les institutions publiques. Il y a une douleur forte qui remonte des soignants, des policiers, des magistrats ou des enseignants. L’institution publique est le premier lieu qui vient détricoter la notion de dignité. Pourtant, elle devrait être la garante de conditions dignes de travail et de vie. « Je ne peux plus exercer mon métier dignement » est une phrase qui revient sans cesse chez ceux qui travaillent dans les services publics.
- La dignité est irréductible. Pourtant, il existe des situations indignes. C’est-à-dire ?
Nous sommes irréductiblement dignes et en même temps, la dignité n’a de sens que si elle vient modeler nos relations avec autrui, et s’incarner dans des actions concrètes.
- Comment la politique doit-elle s’approprier la notion de dignité ?
Une politique de la dignité consiste notamment à mieux répartir la charge du « sale boulot », du « dirty work » qui est souvent l’autre nom des pourvoyeurs du soin qui sont des pourvoyeurs de dignité. Autrement dit, il faut par exemple mieux répartir le fardeau de l’entretien, soit ce qui nous permet de « rester digne », d’entretenir nos corps, d’autant plus s’ils sont dépendants et vulnérables, ou encore de vivre dans un milieu non-toxique.
- Un certain nombre d’associations utilisent le champ lexical de la dignité. La Fondation Abbé Pierre, par exemple, entend lutter contre l’habitat indigne. En quoi ces associations sont représentatives de ce que vous appelez la clinique de la dignité ?
Les associations sont constituées par une clinique de la dignité au sens où elles vont au chevet des vies des plus vulnérables. Elles affrontent le réel dans sa complexité, elles ne sont pas technocratiques, elles font l’« épreuve » de l’indignité des situations. Disons qu’elles ne se paient pas de mots, pour elles défendre la dignité humaine c’est immanquablement agir dignement, porter la dignité comme une charge publique.
- Les entreprises peuvent-être créatrices de conditions indignes pour les salariés. Peut-on inverser cela et faire qu’elles participent à cette clinique de la dignité ?
C’est évident que les entreprises peuvent être créatrices de dignité. Heureusement, quantité d’entreprises le sont déjà en rénovant grandement les conditions de travail, les relations entre les individus et les milieux. Mais d’autres, hélas, estiment toujours qu’il existe une obligation de croissance exponentielle délirante, qui entre en concurrence avec le maintien de relations dignes entre les personnes. La dignité en action, en partage, suppose des notions d’optimum, d’équilibre, de réciprocité. Elle ne peut pas se trouver dans une relation de domination, d’hyper exploitation ou de maximalisation comme le monde de la rentabilité l’exige. Un délire de prédation, de croissance, ne peut pas permettre d’instaurer un régime de dignité. Ou alors, uniquement en fabriquant l’indignité des autres. C’est ce qu’il s’est passé pendant les premières vagues de la mondialisation pendant lesquelles on a délocalisé le fardeau de l’indignité.
- Face aux situations indignes, il peut sembler selon vous pertinent de convoquer l’éthique du care. Qu’entend-on par le care ?
Le care définit une morale qui prend en considération les vulnérabilités, qui considère que leur diagnostic est nécessaire pour éviter que leur déni ne les renforce. Á la chaire de philosophie à l’hôpital, nous tentons d’expérimenter la générativité de la vulnérabilité, autrement dit nous produisons une théorie de la conception à partir du point de vue du plus vulnérable, pour prototyper des solutions.
- Pourquoi cette notion a-t-elle été longtemps dévalorisée ?
Cette notion a longtemps été dévalorisée parce qu’elle était sentimentalisée, féminisée à outrance. Si l’on reprend la généalogie du concept, il y a un premier âge du care avec les définitions de la psychologie du développement, les théories de l’attachement, la pédopsychiatrie, disons un âge clinique du care, où il était opposé au « cure », et il venait déterminer le soin maternel. Puis des philosophes comme Gilligan, dans les années 80, se sont interrogés sur le caractère genré de la morale et ont définit le care comme cette activité morale qui consiste à placer le soin d’autrui au cœur de ses motivations et actions. Et bien sûr, cette morale était « féminine », car sociologiquement et culturellement les femmes ont toujours assumé ce rôle dans la société. Depuis les années 90, avec Tronto, heureusement, nous avons commencé à déféminiser le care, à montrer qu’il était indissociable de l’activité humaine en règle générale. Le care est d’abord une notion sociale et absolument structurelle de l’être humain qui doit être portée par l’ensemble du système humain, et demain en lien avec le non-humain. Pour ma part, je définis le care comme cette aptitude à rendre capacitaire, cette manière que nous avons en partage pour créer l’autonomie de chacun.
- N’y a-t-il pas un risque que cette notion cache une déresponsabilisation de l’État et une sur-responsabilisation de l’individu ?
Souvent, les notions qui rencontrent un grand succès conceptuel, politique et culturel, connaissent un phénomène d’instrumentalisation. C’est un travail permanent de veiller à ce qu’elles ne soient pas instrumentalisées.
- Peut-on déployer la politique du care sans être aveugle des dominations structurant la société ?
C’est nécessaire. Il est toujours possible de défendre une éthique du care tout en se confrontant aux impasses de la société. Mais ces impasses ne sont pas éternelles. C’est par le déploiement des éthiques et des politiques du care que l’on trouve des issues à ces impasses. Bien évidemment, dans un premier temps, on peut se sentir dans l’obligation de négocier avec l’inacceptable, la rémanence des dominations. Mais on les met à mal avec le déploiement du care.
- Vous parlez des communs (commons). En quoi cette notion est-elle pertinente pour penser le care ?
Les communs sont une combinaison de deux choses : d’une part, des ressources matérielles ou immatérielles considérées comme un bien commun. D’autre part, un mode de gouvernance ad hoc, pensé par ceux qui ont accès à et entretiennent cette ressource. Le commun est une révolution de la gouvernance par le care, au sens où toutes les parties prenantes sont prises en considération, et font l’objet de relations dignes.