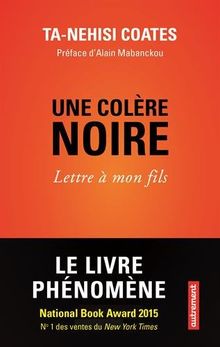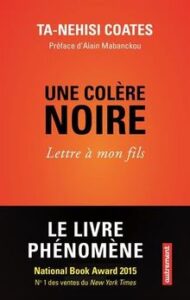
Le livre phénomène aux USA .
Un livre a lire calmement sans haine mais pour comprendre, ce monde qui dérive dans la violence PBC
La description
Voilà ce qu’il faut que tu saches : en Amérique, la destruction du corps noir est une tradition – un héritage. Je ne voudrais pas que tu te couches dans un rêve. Je voudrais que tu sois un citoyen de ce monde beau et terrible à la fois, un citoyen conscient. J’ai décidé de ne rien te cacher.
« Je me suis demandé qui remplirait le vide intellectuel après la mort de James Baldwin. Sans aucun doute, c’est Ta-Nehisi Coates… Une lecture indispensable. »
Toni Morrison, Prix Nobel de Littérature. National Book Award 2015
Une colère noire Lettre à mon « frère » d’Amérique Par Alain Mabanckou Cher Ta-Nehisi Coates, Nous sommes semblables par la couleur de peau, mais éloignés par l’Histoire.
Le premier constat est une évidence : notre couleur est ce qu’on voit de prime abord. Le second recommande en revanche une lecture plus attentive car, même si nous avons l’Afrique comme racines, le « déplacement » lugubre dont vous avez été la victime vous a obligé à forger une autre culture dans un autre territoire où, chaque jour vous devriez lutter pour être considéré comme un être humain.
Oui, vous êtes un Noir d’Amérique – ceux qu’on appelle maintenant « Africain-Américain » –, je suis un Africain, je suis aussi un « Noir de France » et je vis désormais en Amérique. Fruit d’un voyage funeste – la traite négrière –, l’Africain-Américain veut reconstituer le parcours de cette traversée qui le catapulta de l’Afrique aux champs de coton dans lesquels on entendait s’élever des refrains de gospel entrecoupés de coups de fouets et d’aboiements de chiens de garde. Il n’a pas oublié ses désirs de rébellion, sa jambe coupée, la corde et le regard méprisant des maîtres blancs qui le traitaient comme un animal sauvage. Il avait donc échoué dans une contrée qui n’était pas la sienne, le nouveau continent.
Cette « terre d’accueil » l’avait réduit à un statut si humiliant qu’il ne participait pas aux décisions de cette nation pourtant multiraciale, mais dirigée par une seule race. De l’autre côté, moi l’Africain je n’étais pas pour autant libre dans mon continent. Il y avait la présence du colonisateur qui prétendait être investi d’une mission de civilisation. Il devait apporter les Lumières aux barbares, à nous autres qui, pour reprendre les termes d’Aimé Césaire dans Le Cahier d’un retour au pays natal, n’avions rien inventé, « ni la poudre ni la boussole », à nous autres qui n’avions jamais « su dompter la vapeur ni l’électricité », à nous autres qui n’avions exploré « ni les mers ni le ciel ».
Or nous voulions changer notre terre, notre « pays réel », dessaisir le colonisateur du pouvoir de décider à notre place puisque lorsque la chèvre est là il ne faut surtout pas bêler à sa place. Nous voulions par conséquent mettre fin à l’exploitation des richesses de nos terres, au mépris de nos cultures, de nos croyances et surtout de notre propre histoire qui restait à écrire, nos ancêtres n’étant pas les Gaulois mais les rois Makoko, Loango, les héros et héroïnes Shaka Zulu, Kimpa Vita, Samory Touré, etc.
C’était un combat d’émancipation de nos nations, de reconquête de notre autonomie et de l’affirmation de notre identité… Vous et moi avions de ce fait emprunté deux « directions » différentes, mais avec la même idée en tête : l’urgence de devenir des êtres libres. Vous aviez demandé des comptes à l’Amérique blanche depuis l’entre-deux[1]guerres avec le mouvement de la « Renaissance de Harlem » qui valorisait la culture afro-américaine portée par des figures de premier plan comme W. E. B. Du Bois, Langston Hughes, Richard Wright, Zora Neale Hurston, ou encore Duke Ellington, Count Basie, Louis Armstrong ; nous avions fait de même, en Europe, dans les années 1930, avec le mouvement de la Négritude lancé par Léopold Sédar Senghor, Léon-Gontran Damas et Aimé Césaire.
Les « Noirs de France » d’alors avaient même rencontré en 1956, à la Sorbonne, les plus grands intellectuels et écrivains noirs américains venus pour le « premier congrès des écrivains et artistes noirs », congrès qui se déroula à la Sorbonne, dans le célèbre amphithéâtre Descartes qui accueillit, en 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme. Un premier moment de dialogue entre nous ? Oui, mais le constat était là, évident : il y avait quelque chose qui nous éloignait. L’Africain s’acharnait à chasser le colon, le Noir américain luttait pour être reconnu comme un citoyen à part entière en Amérique. Le Noir américain et l’Africain étaient des étrangers l’un à l’autre, et peut-être le demeureront-ils éternellement.
L’Africain a en effet une idée certaine de l’Afrique et, en cela, il a tendance à réclamer le monopole de la source, une source dans laquelle, d’après lui, tous les lamantins éloignés reviendraient boire. À l’opposé le Noir américain a plutôt une certaine idée de l’Afrique fondée sur le mythe, sur des héros aux noms magiques arrachés du continent et jetés dans la mer pendant la « traversée ». Et ce « passé d’esclave » est souvent érigé en élément constitutif de « l’identité noire américaine », bien au-delà de l’appartenance à la nation américaine.
Nous autres Noirs de France ne pouvons revendiquer ce passé, et nous recherchons encore ce qui pourrait définir notre lutte collective au-delà du fait que nous venons tous d’Afrique… Je vis depuis le début des années 2000 en Amérique où j’ai assisté avec euphorie à l’élection historique de Barack Obama à la Maison-Blanche en 2008, puis à sa réélection quatre années plus tard. J’ai constaté comment certains
Africains américains reprochaient à ce métis de ne pas avoir un « passé d’esclave », sorte de brevet qui aurait justifié son appartenance à la « communauté », celle-là même qui attendait l’avènement d’un « vrai Africain-Américain » au pouvoir, et il ne pouvait être incarné par ce Barack Obama dont la mère avait plutôt des origines irlandaises et le père venait du Kenya. L’Amérique conservatrice, encore sonnée par la victoire historique d’un « non-Blanc » à la présidence du pays doutait elle aussi de l’« américanité » de ce personnage au charisme indubitable, allant jusqu’à mettre en cause sa naissance à Honolulu, dans l’État d’Hawaï. Votre livre, Une colère noire, paraît désormais en France. Cette lettre que vous adressez à votre fils adolescent émut une bonne partie de l’Amérique, un pays qui, ces derniers temps, traverse des turbulences sociales marquées par des bavures policières contre les Africains[1]Américains ou des tragédies à caractère raciste comme le massacre perpétré le 17 juin 2015 par Dylan Roof, un partisan de la « suprématie blanche », dans une église noire de Charleston, en Caroline du Nord. Neuf personnes périrent, laissant le pays dans la stupeur, et ce drame apparaissait alors comme une conséquence de la « faillite » de la politique de Barack Obama sur la « question raciale » aux États-Unis…
À la sortie de Colère noire aux États-Unis, Toni Morrison déclara que vous combliez désormais « le vide intellectuel » qu’elle ressentait depuis la mort de James Baldwin, romancier que je considère comme le plus grand théoricien des droits civiques aux États-Unis. Je lui avais « adressé » une lettre en 2007 * à l’occasion du vingtième anniversaire de sa disparition en France où il s’était installé dès 1948, révolté contre la ségrégation raciale et la haine des homosexuels, dans ce même pays que vous scrutez désormais avec une acuité et une justesse singulières. Oui, vous observez l’Amérique d’aujourd’hui avec la lucidité de Baldwin, et votre lettre, à cet égard, n’est pas éloignée de celle que votre « aîné » spirituel adressa à son neveu dans l’ouverture de La prochaine fois, le feu, brûlot qu’il commit en 1963 et devenu un classique dans la compréhension des rapports entre les « races » en Amérique. Vous apportez une modernité et une fraîcheur de regard qui remettent en selle les grands principes civiques que notre époque semble de plus en plus gommer.
Qu’est-ce qu’un Africain-Américain de nos jours ? En quoi l’histoire de la haine et de la violence en Amérique est-elle intimement liée à la communauté noire, tantôt actrice de ces affrontements, mais le plus souvent victime expiatoire d’un système politique fondé sur l’hégémonie d’une classe au détriment des « minorités » qui ont pourtant toutes contribué, et contribuent toujours, à façonner le nouveau visage du pays, se sacrifiant au nom de ses intérêts et de son rayonnement dans le monde ? Une colère noire remet sur la table la question de la « race » en Amérique par le biais de votre parcours personnel, celui d’un gamin des quartiers populaires de West Baltimore dans les années 1980. Cette approche personnelle a le mérite de ne pas tomber dans l’écueil de ces analyses trop généralistes.
Et, curieusement, la peur qui vous animait alors n’était pas celle du Blanc mais celle des autres Noirs qui vous menaçaient, vous battaient. Vous alliez comprendre bien plus tard que ces gamins n’étaient en réalité que le produit du « racisme blanc » – une manière de signifier que le racisme est forcément une fabrication. Aux États-Unis, j’ai en permanence le sentiment que je ne serai jamais intégré dans la communauté noire américaine. Si on m’appelle « frère » – ce qui me fait évidemment plaisir, et je sais que c’est simplement à cause de la couleur de ma peau –, on me fait comprendre clairement qu’il y a des choses que je ne pourrai pas saisir. Parce que je ne peux revendiquer votre passé de la captivité. Parce qu’il se pourrait que certains de mes ancêtres aient comploté avec le Blanc durant cette période douloureuse. Je suis aimé, adulé comme le frère des « racines », mais je suis aussi perçu comme une des sources des problèmes de cette communauté. C’est en cela qu’Une colère noire me parle particulièrement…
Transposé dans la réalité française, votre ouvrage nous apprend beaucoup de choses et pourrait contribuer à traiter autrement le débat sur l’acceptation de l’Autre. L’obsession de la « classification » des individus, « normale » en Amérique, tomberait en France sous le coup de la violation de l’article 1 de la Constitution qui pose clairement les règles du jeu : la France est « une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » et, mieux encore, elle « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion… »
Certes le mot « race » utilisé dans le débat américain n’a pas le même écho dans mon pays d’adoption, la France, qui n’a pas encore réglé les conséquences de son passé colonial. Il est urgent que la France combatte systématiquement une certaine conception rétrograde de la composition de sa population, cette conception qui a fait dire à certaines personnalités politiques de la droite que la France est « un pays judéo-chrétien de race blanche qui accueille des personnes étrangères… »
Au fond, en France, à la différence de votre pays, il y a comme une crispation lorsque la « couleur » est au cœur du débat. L’imaginaire occidental est alors ballotté entre le sentiment de la repentance tel que décrit par le philosophe et essayiste Pascal Bruckner dans son Sanglot de l’homme blanc, et la gêne que pourrait engendrer la déconstruction de l’inconscient colonial sur la place publique. Parler de la couleur c’est inéluctablement évoquer les pages sombres de l’Histoire de France dans laquelle les Noirs attendent encore qu’on leur consacre des épisodes à la hauteur de leur apport quant à la construction de la nation française.
Dans l’esprit de beaucoup de conservateurs, reconnaître cet apport serait amoindrir la grandeur d’une Nation qui a toujours pensé se suffire à elle-même. La classe politique française n’échappe pas à ce dilemme et se dédouane le plus souvent en pointant du doigt l’extrême droite ou l’aile de la droite qualifiée de « dure », prompte à aller à la pêche des voix des Français les plus désespérés en leur expliquant que l’Autre est la cause de leurs malheurs. Ici, comme chez vous d’ailleurs, les réactions des politiques sont par conséquent tributaires des enjeux électoraux, et surtout de l’air du temps… Une colère noire arrive à un moment où en France quelques voix veulent nous persuader que le raciste devient un « résistant », un « courageux » face à la pensée unique. Grave erreur ! Nous l’avons fabriqué de toutes pièces, ce raciste, le laissant impunément parader dans les allées de la courtoisie et de la tolérance sous couvert d’une certaine liberté d’expression.
Il trouve aujourd’hui un terrain fertile, propage sa haine et se terre derrière les principes abstraits qui sont censés être le socle de la Nation française. Il ne s’agit pas de taxer quiconque de raciste parce qu’on aurait eu une dispute et qu’on n’aurait pas la même couleur de peau. Il existe aussi un « racisme » et des violences entre Noirs – et vous l’avez vécu dans votre enfance –, il suffit de regarder par exemple comment sont traités certains Haïtiens dans les départements français d’outre-mer ou encore la condition pitoyable des Noirs dans le Maghreb, des Noirs qui sont pourtant algériens, marocains, égyptiens ou tunisiens ! Pour mieux combattre la haine, cher Ta-Nehisi Coates, j’ai toujours utilisé les deux armes qui sont en ma possession, et ce sont elles qui nous unissent, pas notre couleur de peau : la création et la liberté de penser. Elles dépassent le crétinisme du raciste parce que le raciste est incapable de créer, de penser librement, trop préoccupé à détruire. Et votre livre est une invitation au dialogue, ce dialogue qui aboutira un jour à ce que Derek Walcott appelle « la culture de la courtoisie et de l’échange »… A.M