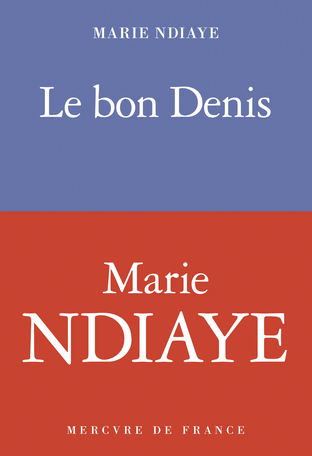Marie NDiaye Le bon Denis ( sur le père )
Marie Ndiaye est douce et son bégaiement la rend encore plus singulière. Une pensée qui se déroule au fil de l’eau et qui coule lentement sans masquer la puissance incarnée A lire Pape B CISSOKO
Dans “Le Bon Denis”, Marie NDiaye fait l’anatomie d’un père
par Sylvie Tanette
« Elle entendait la voix égale et limpide du garçon, ni lion ni souffle n’en altérait la placide assurance.
Il semblait, lui, aussi, ce Denis, pareil aux petites feuilles du lilas, se consumer sans brûler.
Il s’écarta brusquement, tournant le dos au père, puis il prit la main de la fille dans un geste d’une telle tendresse qu’elle s’en trouva presque déconcertée.
Ils revinrent vers l’hôtel, leurs pas unis, sans un coup d’œil derrière eux.
Il ne veut pas nous reconnaître, il ne veut pas de nous le pauvre homme, nous sommes libres ! chuchota le garçon avec joie.
Il sembla à la fille qu’une joie de même nature exactement la grisait en toute lucidité.
Libres, enfin libres ! répétait Denis en riant. »
L’autrice de “Trois Femmes puissantes” aborde enfin l’histoire de ses parents dans un texte très intime, qui interroge les liens familiaux et le racisme.
“Ce n’est ni un roman ni des nouvelles, c’est un texte, on n’est pas obligé de le définir”, répond-elle à notre première question. Marie NDiaye est au-dessus des genres littéraires et des carcans imposés. Depuis Quant au riche avenir, cela fait quarante ans que cette autrice, Goncourt 2009 avec Trois Femmes puissantes, construit une œuvre qui ne ressemble à aucune autre dans le paysage littéraire français.
Son nouveau livre le prouve encore : Le Bon Denis est une suite de quatre textes courts, fictionnels ou non, reliés par le prénom Denis qui apparaît dans chacun d’eux. Dans le premier, une narratrice cherche à obtenir de sa mère âgée des informations sur leur passé. Dans le deuxième, l’autrice retrace le parcours de ses parents. Dans le troisième, elle réfléchit à la personnalité de son père. Dans le dernier, une jeune femme part aux États-Unis rencontrer un père qu’elle n’a jamais vu.
Si NDiaye creuse ici ses thématiques récurrentes – l’incommunicabilité, la relation mère-fille, la réalité mise en doute –, elle parle pour la première fois de ses parents. Sa mère, fille de paysan·nes qui parvient contre toute logique à fréquenter le collège de la ville voisine. “Elle aurait pu ne jamais y aller”, glisse-t-elle. Son père, né au Sénégal, qui traverse mille obstacles pour aller à l’école puis étudier en France. “Tout était fait pour qu’ils ne se rencontrent jamais. Quand ils sont jeunes à la fin des années 1950, leurs enfances, leurs pays, leur mode de vie étaient différents. Mais tous deux avaient l’expérience d’une certaine dureté de la vie, la conscience qu’il fallait s’accrocher à l’éducation. Pour mon père, c’était une question de survie.”
Ce père, elle en parle aujourd’hui avec une certaine incrédulité : “Enfant, il a été donné à une tante qui l’a maltraité. Il a réussi je ne sais comment à fréquenter l’école, l’instituteur l’a repéré et fait entrer au collège. Après le bac, il a eu une bourse pour venir faire des études en France, il a rencontré ma mère, ils se sont mariés, ils ont eu mon frère et moi. Il est allé au Sénégal pour préparer notre venue, on devait y vivre, ma mère aurait adoré enseigner là-bas, mais il a disparu.” Elle-même est alors toute petite et n’a revu ce père “d’une froideur presque surjouée” qu’une fois devenue adulte, et rarement.
C’est lorsqu’elle a appris “très incidemment” sa mort, il y a sept ou huit ans, que l’autrice dit avoir commencé à porter un regard différent sur lui. “Jusqu’à récemment, je le jugeais avec une certaine sévérité. J’en suis arrivée à la réflexion que si nous avions été de la même culture, je me serais dit : quand on n’a jamais reçu d’amour dans l’enfance, quand on a dû se battre, c’est sans doute difficile de trouver en soi des ressources pour être un bon époux et un bon père. Mais je ne lui ai pas accordé cette analyse psychologique que j’aurais eue avec un père français.”
Elle mesure aussi le racisme que, au début des années 1960, ce jeune surdiplômé noir a dû affronter – “une forme de mépris, au mieux de condescendance” – jusque dans sa belle-famille : “Pour quelqu’un né en 1910 comme mon grand-père maternel, que sa fille épouse un homme noir était quelque chose d’inconcevable. Comme si elle avait épousé un chien ou un cheval.”
Malgré cette dénonciation du racisme, Marie NDiaye refuse le qualificatif d’autrice engagée : “Jamais je n’aurais l’outrecuidance d’affirmer que je suis engagée. Je ne suis pas de ces gens admirables qui donnent de leur temps pour ce genre de cause, même si, quand on me le demande, je n’hésite pas.” On se souvient alors que l’élection de Nicolas Sarkozy avait participé à son installation à Berlin. Et aujourd’hui, dans ces temps politiquement plus qu’incertains, pense-t-elle à partir de nouveau ? “Non, j’ai envie de rester, quoi qu’il arrive je resterai. C’est mon pays et ma langue.”
Le Bon Denis de Marie NDiaye (Mercure de France/“Traits et portraits”), 128 p., 17 €. En librairie le 3 avril
«Le bon Denis» de Marie NDiaye : variations autour du père
Marie-Laure Delorme
Dans un autoportrait fictionnel, la grande romancière raconte le départ paternel.
Elle est l’une des plus grandes voix d’aujourd’hui. Son art dérangeant de l’ambiguïté ; ses phrases musicales, à la fois douces et dures ; son univers entre deux mondes ; sa manière de restituer la réalité brute. L’écrivaine Marie NDiaye, née en 1967, dans le Loiret, de mère française et de père sénégalais, revient avec un autoportrait fictionnel. À partir d’un élément marquant de sa vie (son père parti en Afrique, en 1969, alors qu’elle avait 1 an), elle se livre à une enquête romanesque sur les origines : comment savoir d’où l’on vient quand tout le monde ment ? « Le bon Denis » est composé de quatre histoires, quatre époques. Elles se complètent, se rejettent. L’auteure de « Rosie Carpe » (prix Femina, 2001) et de « Trois femmes puissantes » (prix Goncourt, 2009) ne surplombe jamais ses créations. Elle nous laisse libres de pleurer ou de rire face à un suicide raté, une mère âgée qui continue à tirer les ficelles, un hôtel clinquant.
La suite après cette publicité
Une maison de retraite. Une fille tente de converser avec sa mère. D’emblée, on sait que la mémoire maternelle est défaillante. Marie NDiaye ne nous donne jamais à voir le monde sans soulever la peau de son étrangeté. Son écriture introduit un accroc. Quel crédit accorder aux propos de la mère ? La vieille femme assure qu’elle n’a pas été abandonnée par son mari. Au contraire. Elle a fait elle-même le choix de claquer la porte, pour partir vivre avec un employé prénommé « Denis ». L’homme s’est occupé de son enfant comme s’il était le sien. Mais la fille a d’autres souvenirs, d’autres images de ses premières années. Rien ne colle. Les récits entrent en guerre les uns avec les autres. La fille rend aussi visite à son mari, dans sa maison de repos. Il a fait une tentative de suicide.
Marie NDiaye
Marie NDiaye est née en 1967 à Pithiviers. Elle est l’autrice d’une vingtaine de livres – romans, nouvelles et pièces de théâtre. Elle a obtenu le prix Femina en 2001 pour Rosie Carpe, et le prix Goncourt en 2009 avec Trois femmes puissantes. Une de ses pièces, Papa doit manger, est entrée au répertoire de la Comédie-Française.