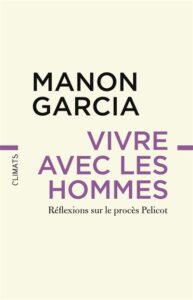
Réflexions sur le procès Pelicot 2025
« Je suis philosophe, je m’intéresse aux rapports entre les femmes et les hommes : après un premier livre sur la soumission des femmes aux hommes, j’ai écrit un ouvrage sur le consentement et les injustices de genre dans la sexualité hétérosexuelle. Je suis aussi une femme de bientôt quarante ans, qui voudrait pouvoir exister dans le monde sans s’inquiéter sans cesse des violences sexistes et sexuelles dont mes amies, mes filles ou moi pourrions être victimes. J’ai vu les changements apportés par le mouvement #MeToo, je vois le backlash masculiniste qui s’efforce de renvoyer les femmes à leur position de deuxième sexe. Lorsque je découvre les crimes commis sur Gisèle Pelicot, je sais que se condensent dans cette histoire toutes les questions philosophiques qui sont les miennes. J’hésite à aller au procès de Mazan. Puis je me rends à l’évidence : il me faut écrire ce procès et l’expérience que j’en fais, comme philosophe et comme femme. Et tenter de répondre à cette question qui me hante : peut-on vivre avec les hommes ? »
Manon Garcia est une philosophe française née en 1985. Spécialiste en philosophie féministe, elle publie son premier essai en 2018, On ne naît pas soumise, on le devient.
Biographie
Manon Garcia naît en 1985 dans une famille d’autodidactes cultivés. Ses parents fréquentent des milieux sociaux variés. Sa mère, Claire Simon, est réalisatrice, féministe, membre du collectif 50/50 pour l’égalité des femmes et des hommes et la diversité dans le cinéma et l’audiovisuel
Après sa classe préparatoire au lycée Henri-IV, elle étudie à l’École normale supérieure et obtient l’agrégation de philosophie en 2014.
En 2017, elle passe sa thèse de doctorat à l’université Paris I – Panthéon Sorbonne sous la direction de Sandra Laugier qui a pour titre « Consentir à sa soumission, un problème philosophique ».
Carrière
Manon Garcia obtient en 2016 un poste d’enseignante à l’université Harvard, qu’elle va occuper pendant deux ans, puis un poste de chercheuse et enseignante à l’université de Chicago[4], jusqu’en 2022. En juillet 2022, elle est nommée professeure junior à l’université libre de Berlin[5]. Elle analyse les causes qui poussent les femmes à la soumission, et met en lumière le paradoxe dans cette soumission féminine consentie, notamment par la pensée de Simone de Beauvoir, elle-même modèle de contradictions entre une forme de soumission dans sa vie personnelle et une volonté de révolutionner les normes sociales.
Manon Garcia publie des articles sur le consentementet donne des conférences. Selon elle, il existe deux formes de soumissions : l’une par la force, qui ne laisse pas d’autre choix que se soumettre, et une autre plus complexe, plus volontaire, par laquelle les femmes auraient un intérêt — plus d’attention masculine, statut social valorisé — et leur consentement relèverait alors d’une sorte de « calcul coûts-bénéfices». Cependant, cette soumission ne serait pas liée à une quelconque « nature féminine », mais bien le résultat d’un conditionnement social
Elle publie en 2018 On ne naît pas soumise : on le devient, où elle reprend la thèse de Beauvoir selon laquelle l’oppression sexiste réifie le corps des femmes. Elle dénonce l’aliénation du corps des femmes qui les conduit à cultiver un plaisir spécifique et ambigu à se soumettre.
Dans son ouvrage La Conversation des sexes, Philosophie du consentement paru en 2021 Manon Garcia en appelle à une culture de l’érotisation égalitaire pour dépasser la culture du viol. Une politique éducative à destination d’un public adolescent pourrait notamment s’appuyer, par exemple, sur des séries ayant mis en avant le consentement comme Grey’s Anatomy, Sex Education ou Normal People, pour expliquer à quoi correspond une sexualité bonne pour toutes et tous.
Dans Vivre avec les hommes, elle fait le récit des audiences du procès Pélicot et livre une analyse philosophique et sociale des agressions sexuelles, marquée par des normes sociales de genre qui maintiennent « un ordre social hiérarchique », et la « complicité » des hommes français avec le patriarcat. wikepia


