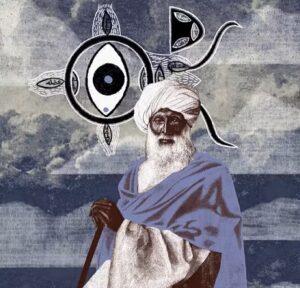
J’ai trouvé divers articles pour présenter ce penseur et savant atypique. P B CISSOKO
Ibn Al Haytham (965 – 1040) : mathématicien et physicien arabe du XIe siècle
« Le prix du savoir » (2/7). En l’an 1011, le mathématicien bagdadi s’installe au Caire à l’invitation d’Al-Hakim, souverain érudit et « sanglant » cherchant à étendre son influence. Echouant à anticiper les imprévisibles crues du Nil, le savant se fit passer pour fou pour ne pas être exécuté.
L’information est arrivée par des voies détournées jusqu’en Occident chrétien, en plein Moyen Age. Yusuf Al-Mutaman, souverain du petit royaume musulman de Saragosse, en Espagne, mathématicien à ses heures, tombe, au XIe siècle, sur un livre sobrement intitulé Traité d’optique et s’en fait l’écho. Ses 1 300 pages, peu après traduites de l’arabe au latin, sans doute à Cordoue, vaudront une renommée à son auteur, Ibn Al-Haytham, en qui certains voient le père de l’optique moderne.
Plus connu en Occident sous le nom d’Alhazen – un patronyme issu de la latinisation de son prénom, Ibn Al-Hasan –, Ibn Al-Haytham est né à Bassora, dans l’actuel Irak, en 965. Mathématicien, philosophe, astronome et physicien – on ne parlait pas alors de physique mais de mécanique –, il est, comme ses contemporains de l’espace musulman, pétri de culture grecque. Bagdad fourmille depuis un siècle de savants que le calife Al-Mamun, qui régna de 813 à 833, a encouragés et financés. Ptolémée, Archimède et Aristote, entre autres, y sont traduits en arabe et étudiés. La dynastie des Abbassides brille alors de mille feux.
Abu Ali al-Hasan Ibn al-Haytham
Abu Ali al-Hasan Ibn al-Haytham, nommé Alhazen, est un mathématicien, physicien et philosophe né à Bassora, dans l’ancienne Irak. Il est le premier physicien à avoir compris pourquoi la lune et le soleil paraissent plus gros quand ils sont proches de la ligne d’horizon. Il est aussi le premier à avoir compris que si on voyait la Lune, s’est parce qu’elle est éclairée par le soleil. De même, et contrairement à Ptolémée, il comprend que nos yeux n’envoient pas de lumières. Si nous voyons les objets, c’est parce qu’ils sont éclairés par la lumière (du soleil) et qu’elle est réfléchie vers nos yeux.
Alhazen, un scientifique oui, un fou non !
La légende raconte que le Calife lui avait demandé son aide pour construire un immense barrage sur le Nil, un grand fleuve d’Egypte. Jugeant le travail infaisable, et par peur de la colère du Calife, Alhazen a fait semblant d’être fou. Avec ce stratagème, il est autorisé a resté enfermé chez lui, ce qu’il fit jusqu’à la mort du Calife. Pendant ce temps, il s’est occupé intelligemment. très doué en mathématique appliquée, il a écrit son livre sur l’optique. Un livre qui lui a permis d’obtenir des revenus.
Lumière sur les travaux d’Alhazen
Notre ami n’a pas chômé durant sa carrière et il a découvert de nombreuses propriétés de la lumière. Dans son traité, il explique que la lumière se déplace en ligne droite, et que sa vitesse varie suivant le milieu.
Il explique les lois de la réflexion de la lumière et tente de comprendre le mécanisme des couleurs. Le plus incroyable est qu’il valide chacune de ses hypothèses par des expériences scientifiques. Une méthode moderne qui te parait normale aujourd’hui, mais qui était loin d’être habituelle au 11è siècle. https://curiokids.net/
Ibn Al Haytham (965 – 1040) : mathématicien et physicien arabe du XIe siècle
Ce savant, né dans l’actuel Irak à la fin du Xe siècle, a révolutionné, entre autres, la science de la lumière. Il invente la chambre noire et il est le premier à établir que la lumière de la Lune vient du Soleil et à contredire Ptolémée qui affirmait que l’œil émettait de la lumière. Par AHMED DJEBBAR, PROFESSEUR ÉMÉRITE À L’UNIVERSITÉ LILLE
Ibn Al Haytham (Alhazen en latin) est né en 965, dans la ville irakienne de Bassora. Après avoir acquis une formation solide en arabe, il s’est mis à étudier la philosophie et les sciences puis il s’est spécialisé en physique, en mathématiques et en astronomie. Dans ces trois domaines, il a eu à sa disposition les principaux ouvrages grecs, en particulier ceux d’Euclide (IIIe siècle avant J.-C.), de Héron d’Alexandrie (Ier siècle), d’Archimède (mort en 212 avant J.-C.) et de Ptolémée (mort vers 168). Il a également étudié les écrits les plus importants publiés en pays d’islam avant le XIe siècle. Durant son séjour à Bassora, il aurait occupé un poste officiel important. Mais il semble qu’il se soit vite lassé de cette charge parce qu’elle le détournait de ses activités scientifiques. Quelque temps après cet épisode, il quitte sa ville natale pour aller s’installer au Caire sur invitation du calife fatimide de l’époque, Al Hâkim (996-1021).
Ce dernier le charge d’étudier la faisabilité d’un projet ambitieux, celui de la régulation des crues du Nil. Ibn Al Haytham accepte de diriger une mission scientifique qui devait remonter la vallée du fleuve jusqu’aux cataractes. Au retour de cette mission, il informe le calife que les savoirs de l’époque n’étaient pas suffisants pour réaliser le projet. Et, pour échapper à d’éventuelles sanctions, il simule la folie. Assigné à résidence et privé de ses biens, il occupe son temps à recopier des ouvrages mathématiques grecs qui lui étaient achetés à prix d’or. Cette situation aurait duré jusqu’à la mort d’Al Hâkim, date à laquelle notre savant aurait retrouvé tous ses esprits.
Quelque temps plus tard, il s’installe près de la grande mosquée Al-Azhar et il poursuit ses différentes activités scientifiques jusqu’à sa mort que l’on situe aux environs de 1040. L’essentiel des travaux scientifiques d’Ibn Al Haytham concerne la physique, les mathématiques et l’astronomie. Mais un nombre non négligeable concerne d’autres disciplines, comme la philosophie, la théologie spéculative et la médecine. En physique, sur les vingt et un ouvrages qu’il a publiés, seize traitent des différents aspects de l’optique : théories de la lumière et de la vision, phénomènes astronomiques et miroirs ardents (appareil illustrant la propagation de la chaleur sous forme de rayonnement lumineux, utilisé comme arme par Archimède à Syracuse – NDLR) dans l’infrarouge essentiellement. Son plus important ouvrage dans ce domaine est le Livre d’optique qui est considéré par les spécialistes de l’histoire de la physique comme la plus importante contribution réalisée sur le sujet avant le XVIIe siècle.
En astronomie, Ibn Al Haytham a publié 28 traités ou articles. Certains sont théoriques, comme ceux qui exposent ses critiques contre les modèles planétaires de Ptolémée. D’autres ont un caractère pratique, comme ceux qui concernent l’observation astronomique, l’étude des gnomons (instrument astronomique pour prendre la hauteur du soleil déterminée par la longueur de son ombre projetée sur une table généralement plane), et la détermination des distances des corps célestes et de leurs diamètres. En mathématiques, il est l’auteur de 64 écrits plus ou moins volumineux. Seuls 23 d’entre eux nous sont parvenus. Plus des deux tiers traitent de géométrie et le reste est consacré à la science du calcul, à l’algèbre et à la théorie des nombres.
En géométrie plane et solide, ses travaux prolongent les apports d’Euclide avec de nouvelles contributions. En géométrie de la mesure, ses contributions s’inscrivent dans la tradition d’Archimède, en l’enrichissant par de nouvelles méthodes pour le calcul des volumes de la sphère et des paraboloïdes de révolution. Il a également publié des résultats originaux en théorie des nombres et sur les systèmes d’équations. En plus de la résolution de nombreux problèmes mathématiques et physiques, Ibn Al Haytham a réfléchi sur les méthodes et les outils théoriques qui lui ont permis de résoudre ces problèmes. En physique, il a mis en avant le rôle de l’observation et de l’expérimentation dans l’élaboration de résultats théoriques. En mathématiques, il a analysé les différentes formes de preuves qui interviennent dans l’établissement d’un résultat.
Certains des écrits scientifiques d’Ibn Al Haytham ont été étudiés en Andalus (Espagne) avant de circuler en Europe, grâce aux traductions qui en ont été faites, à partir du XIIe siècle, à Tolède et ailleurs. En astronomie, son Épître sur la structure de l’univers a d’abord été traduite en espagnol, au XIIIe siècle, avant de bénéficier de deux traductions en latin et de deux autres en hébreu. Mais ce sont surtout ses travaux en optique qui l’ont rendu célèbre en Europe. Deux de ses ouvrages ont été traduits en latin : le Livre des miroirs ardents coniques et le Livre de l’optique. Ce dernier sera étudié et commenté jusqu’au XVIIe siècle. De nombreux savants, parmi lesquels Bacon (mort en 1294), Vitello (mort après 1280), Kepler (mort en 1630) et Fermat (mort en 1665) se sont inspirés de son contenu ou s’y sont référés.
Les Contributions D’Ibn Al Haytham en optique
Il a remplacé les explications qualitatives anciennes par des démarches quantitatives mêlant observation, expérimentation et théorisation. Il est le premier à avoir étudié l’œil comme un système optique. Il a analysé la vision comme un phénomène distinct de la lumière. Il est le premier à avoir expérimenté les premiers modèles de chambre noire, à simple et double ouverture, pour confirmer le déplacement rectiligne des rayons lumineux. Il a expliqué le phénomène de la réfraction par la relation entre la vitesse de la lumière et la densité du milieu traversé. Il a établi des résultats nouveaux sur les miroirs ardents. Son étude originale du phénomène de l’arc-en-ciel a permis à Al Farisi (XIIIe siècle) d’en donner une explication scientifique.
https://www.vh.ma/lheritage-des-grands-penseurs-arabes/ibn-al-haytham-
Les scientifiques musulmans -EP03- Al-Hassan ibn al-Haytham (Alhazen)
Alhacen, Alhazen ou Ibn al-Haytham, de son vrai nom Abu Ali al-Hasan ibn al-Hasan ibn al-Haytham (Bassorha, 965 – Le Caire, 1039) est un mathématicien, philosophe, physiologiste et physicien du monde médiéval arabo-musulman.
Un des premiers promoteurs de la méthode scientifique expérimentale, mais aussi un des premiers physiciens théoriciens à utiliser les mathématiques, il s’illustre par ses travaux fondateurs dans les domaines de l’optique physiologique et de l’optique. Certains, pour ces raisons, l’ont décrit comme le premier véritable scientifique, héritier des scientifiques grecs et indiens.
https://abumuslim.fr/scientifiques
Alhazen Le premier véritable scientifique
Alhacen, Alhazen ou Ibn al-Haytham, de son vrai nom Abu Ali al-Hasan ibn al-Hasan ibn al-Haytham (Bassora, 965 – Le Caire, 1039) est un mathématicien, philosophe et physicien du monde médiéval arabo-musulman. Il est d’origine perse.
Un des premiers promoteurs de la méthode scientifique expérimentale, mais aussi un des premiers physiciens théoriciens à utiliser les mathématiques, il s’illustre par ses travaux fondateurs dans les domaines de l’optique physiologique et de l’optique. Certains, pour ces raisons, l’ont décrit comme le premier véritable scientifique.
Biographie
Alhazen est né en 965 à Bassora dans l’actuel Irak où il reçut une éducation qu’il compléta cependant dans la ville de Bagdad. À l’époque, Bassora était sous le contrôle de la dynastie des Buwayhides qui régnèrent sur la Perse. C’est pourquoi il est parfois mentionné sous le nom d’al-Bassri. Bien que cette version ne soit pas acceptée par tous, la plupart des gens s’entendent pour dire qu’il est décédé au Caire en Egypte en 1039.
Alhazen commença sa carrière de scientifique dans sa ville natale de Bassorah. Il fut cependant convoqué par le calife Hakim qui voulait maîtriser les inondations du Nil qui frappaient l’Egypte année après année. Après avoir mené une expédition en plein désert pour remonter jusqu’à la source du fameux fleuve, Alhazen se rendit compte que ce projet était pratiquement impossible. De retour au Caire, il craignait que le calife qui était furieux de son échec ne se vengeât et décida donc de feindre la folie. Il est alors assigné à résidence.
Il profita de ce loisir forcé pour écrire plusieurs livres sur des sujets variés comme l’astronomie, la médecine, les mathématiques, la méthode scientifique et l’optique. Près de 200 ouvrages ont été attribués par les biographes mais seule une soixantaine nous est parvenue. Peu de ces ouvrages, en effet, ont survécu jusqu’à nos jours. Quelques-uns, ceux sur la cosmologie et ses traités sur l’optique notamment, n’ont survécu que grâce à leur traduction latine.
Après la mort du calife Hakim, en 1021, Alhazen cessa de feindre sa folie et put sortir de sa résidence. Il en profita donc pour entreprendre quelques voyages, notamment à Al-Andalus.
Ses recherches
La plupart de ses recherches concernaient l’optique géométrique et physiologique. Il a été l’un des premiers physiciens à étudier la lumière, l’un des premiers ingénieurs et astronomes. Contrairement à une croyance populaire, il a été le premier à expliquer pourquoi le soleil et la lune semblent plus gros lorsqu’ils sont proches de l’horizon (on a cru longtemps que c’était Ptolémée), il établit aussi que la lumière de la lune vient du soleil. C’est aussi lui qui a contredit Ptolémée sur le fait que l’œil émettrait de la lumière. Selon lui, si l’œil était conçu de cette façon on pourrait voir la nuit. Il a compris que la lumière du soleil était diffusée par les objets et ensuite entrait dans l’œil.
Il fut également le premier à illustrer l’anatomie de l’œil avec un diagramme.
Comme ce diagramme n’est pas novateur par rapport aux connaissances anatomiques de Galien, le doute subsiste quant à savoir s’il fut copié d’un ancien manuscrit grec, ou s’il est issu d’une dissection contemporaine.
Il a également énoncé une théorie à propos du jugement et de la reconnaissance des objets. Il remarque que l’on ne reconnaît que les objets que l’on connaît, et que l’image d’un objet persiste quelque temps après qu’on a fermé les yeux. La reconnaissance est donc basée sur la mémoire et n’est pas qu’une simple sensation liée au jugement, car on ne reconnaît pas les objets qui nous sont inconnus. Il a aussi étudié la mécanique du mouvement et dit qu’un objet en mouvement continue de bouger aussi longtemps qu’aucune force ne l’arrête. Le principe d’inertie sera énoncé par Galilée et sera formulé de façon rigoureuse par Isaac Newton.
En astronomie, il a tenté de mesurer la hauteur de l’atmosphère et a trouvé que le phénomène du crépuscule (lumière au lever et au coucher du soleil sans voir le soleil) est dû à un phénomène de réfraction : les rayons de soleil ne doivent pas dépasser un angle de 19° avec l’atmosphère. Il parla également de l’attraction des masses et on croit qu’il connaissait l’accélération gravitationnelle.
Alhazen a écrit plusieurs ouvrages sur l’optique. Dans son Traité d’optique, livre consacré à la physique optique et qu’il mit 6 ans à écrire (1015-1021), il prouve scientifiquement la théorie de l’intromission d’Aristote selon laquelle la lumière entre dans l’œil. Il prouve que tous les objets reflètent la lumière dans toutes les directions, mais c’est lorsqu’un rayon entre en collision à 90° avec l’œil qu’on verra l’objet reflétant le rayon. L’image, selon Alhazen, se formait sur le cristallin.
Dans le même domaine, il dit que l’œil pouvait percevoir la forme, la couleur, la transparence ainsi que le mouvement de quelque chose. Il prouva également que l’œil perçoit effectivement deux images même si on n’en voit qu’une par la démonstration et non par la logique et la beauté du raisonnement. Ce livre n’a été traduit en latin qu’en 1270. Selon lui, la réfraction de la lumière est causée par un ralentissement ou une accélération de la lumière dans son déplacement. Dans un milieu plus dense la lumière voyage plus lentement, selon Alhazen.
Il trouve aussi un rapport entre l’angle d’incidence et l’angle de réfraction mais ce rapport n’est constant que lorsque c’est la même matière qui réfracte le rayon. Il fait tous ses travaux dans une chambre noire dont on lui doit l’invention. Il explique le pouvoir grossissant des lentilles.
Dans le livre V consacré à la catadioptrique de son traité d’optique se trouve une discussion sur la question connue aujourd’hui sous le nom de problème du billard d’Alhazen. Le problème peut se résumer ainsi: «Soit deux billes A et B placées en deux points quelconques d’un billard parfaitement circulaire. Trouver le point sur le rebord sur laquelle la bille A doit être envoyée pour revenir heurter la bille B après avoir rebondi une seule fois ». Alhazen a réussi à le trouver grâce à des sections coniques, mais il n’a pas réussi à le prouver à l’aide d’un raisonnement d’algèbre mathématique. Léonard de Vinci a conçu un instrument à système articulé destiné à construire une solution mécanique du problème d’Alhazen. Plusieurs scientifiques ont essayé de résoudre ce problème tel Christian Huygens mais c’est seulement en 1997 que Peter M. Neumann, professeur à Oxford, a démontré que la solution fait appel à une équation du quatrième degré et ne peut donc être résolue avec une règle et un compas.
HéritageAlhazen a devancé de quelques siècles plusieurs découvertes faites par des scientifiques européens pendant la Renaissance. Il fut l’un des premiers à se servir d’une méthode d’analyse scientifique et influença grandement des scientifiques comme Roger Bacon et Kepler.
Sa doctrine fut diffusée en Europe par les écrits de Roger Bacon et le De perspectiva de Vitellion.
Alhazen est très estimé de la communautée scientifique. Son portrait figure également sur le billet iraquien de 10 000 dinars. Un autre hommage que l’on fit à Alhazen, fut de nommer l’astéroïde (59239) Alhazen en son honneur, ainsi que de baptiser de son nom un cratère de la Lune. De plus, l’Année internationale de la lumière et des techniques utilisant la lumière 2015 permet la commémoration de plusieurs grands événements scientifiques du domaine de l’optique, notamment l’anniversaire du millénaire des grandes découvertes des scientifiques arabes du Xe siècle, dont les travaux d’Alhazen en 1015.
https://www.libe.ma/Alha


