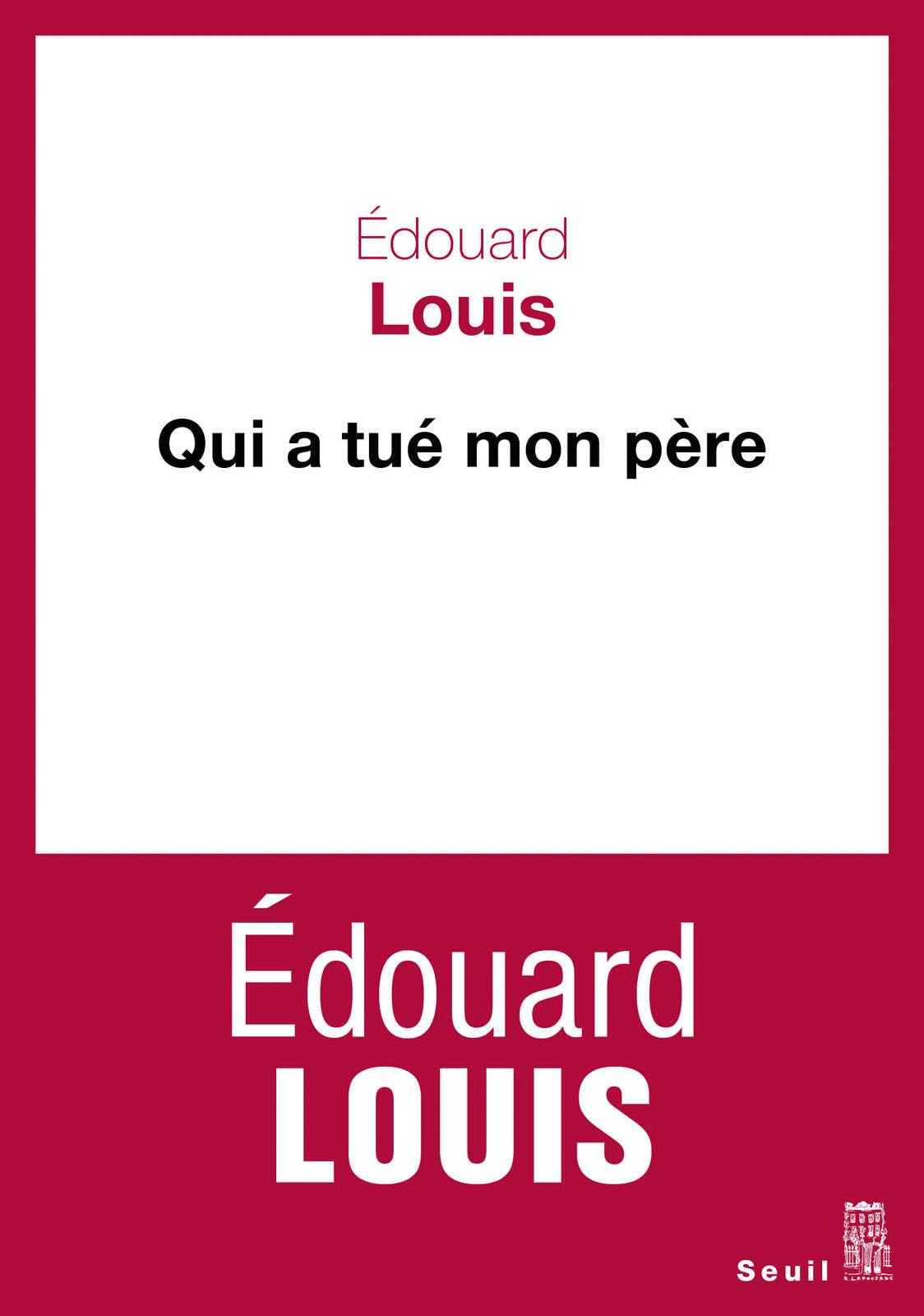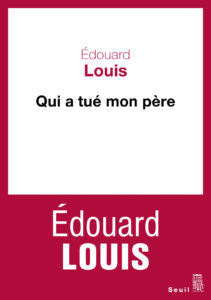
« méli melo -Un ouvrage qui nous parle comme dans Zola qui nous raconte sa vie . Une vie qui est le fruit d’un environnement hostile et dur ,sec et rigide ou les êtres sont prisonniers de l’incertain et de leur corps meurtris. Un auteur vrai et sensible qui démontre comment, le pouvoir politique peut écraser . P B CISSOKO
l’adresse bouleversante d’un fils à son père, soumis à la violence sociale.
Ce nouveau livre d’Édouard Louis est un véritable pamphlet politique, porté par une voix littéraire qui s’installe avec évidence.
« L’histoire de ton corps accuse l’histoire politique »
Édouard Louis ne tourne pas autour du pot. Il donne les noms : « Jacques Chirac et Xavier Bertrand te détruisaient les intestins », « Nicolas Sarkozy te faisait comprendre que tu étais en trop dans le monde, un voleur, un surnuméraire, une bouche inutile », « Nicolas Sarkozy et Martin Hirsh te broyaient le dos », « Hollande, Valls et El Khomri t’ont asphyxié », « Emmanuel Macron t’enlève la nourriture de la bouche ».
Édouard Louis donne les noms de ceux qui « prononcent des phrases criminelles parce qu’ils ne savent pas ». Car qui sait l’effet d’une augmentation de 100 euros de la prime de rentrée ? « Tu étais fou de joie, tu avais crié dans le salon : « on part à la mer » et on était partis à six dans notre voiture de cinq places (…) Toute la journée avait été une fête ».
« Je n’ai jamais vu de famille aller voir la mer pour fêter une décision politique, parce que pour eux la politique ne change presque rien », dit Édouard Louis. Pour son père, elle change tout : « L’histoire de ton corps accuse l’histoire politique ».
La vengeance de la honte
par Pierre Benetti
Depuis En finir avec Eddy Bellegueule, son premier livre paru en 2014, Édouard Louis explore la violence du monde où il a passé son enfance, la Picardie pauvre du début du XXIe siècle. Dans le sillage d’Annie Ernaux, il a également inscrit dans la littérature française, en particulier avec Histoire de la violence (2016), la figure du transfuge de classe contemporain, sa honte, ses rêves de vengeance. Son troisième livre poursuit la même démarche d’écriture, mais cette fois au moyen d’une adresse directe à son père, ouvrier devenu handicapé à l’usine et directement touché par les politiques antisociales. Ce portrait troué restitue avec une colère implacable la part de silence, de contradiction, d’absence d’un homme à « l’existence négative ». Qui a tué mon père convainc moins lorsqu’il devient un objet de discours, aussi juste soit-il, sur l’exploitation, la domination, l’exclusion du pouvoir.
Le théâtre, de manière plus profonde, est lié à une obsession : le corps du père, déformé au pastis, écrasé par une charge, éventré par une opération, perfusé après la maladie. Corps frappé par l’autre fils, le demi-frère. Corps éloigné, car sur cette scène « vaste et vide » le père et le fils ne se touchent pas, ne s’embrassent pas. Tout est de l’ordre du négatif, de l’empêchement dans cette situation, comme dans leur parole. En ce père singulier vivent des cohortes de pères des usines et des champs, aux gestes d’affection impossibles, interdits, inaptes à l’amour, reproducteurs indéfectibles du manque. Par mimétisme, les mots du fils, qui a brisé à son tour la chaîne de reproduction « des mêmes émotions, des mêmes joies à travers les corps et le temps », se révèlent le plus souvent tournés vers l’expression d’une impuissance, qu’elle s’exprime par la forme négative ou le conditionnel. Même le souvenir demeure incapable (« Je ne me rappelle pas si j’ai pleuré » ; « mes souvenirs sont ceux de ce qui n’a pas eu lieu »).
Cette scène centrale – le frère se battant avec le père – n’est pas sans rappeler l’image inaugurale de La honte d’Annie Ernaux – le père essayant de tuer la mère –, mais aussi, dans le même livre, « l’image du restaurant de Tours » à propos de laquelle on lisait : « En écrivant un livre sur la vie et la culture de mon père, elle me revenait sans cesse comme la preuve de l’existence de deux mondes et de notre appartenance irréfutable à celui du dessous.
« La violence ne produit pas que de la violence. J’ai répété cette phrase longtemps, que la violence est cause de la violence, je me suis trompé. La violence nous avait sauvés de la violence. »
« Ce que je dis ne répond pas aux exigences de la littérature »
« La possession n’est pas quelque chose qu’on peut acquérir »
La charge, frontale, vise la substance même de la politique vue comme entreprise de destruction
« La violence ne produit pas que de la violence. J’ai répété cette phrase longtemps, que la violence est cause de la violence, je me suis trompé. La violence nous avait sauvés de la violence. »
« En écrivant un livre sur la vie et la culture de mon père, elle me revenait sans cesse comme la preuve de l’existence de deux mondes et de notre appartenance irréfutable à celui du dessous. »
« mes souvenirs sont ceux de ce qui n’a pas eu lieu »).
Jean-Philippe Cazier Edouard Louis, Livres
Édouard Louis : Échapper à la violence (Qui a tué mon père)
Édouard Louis © Heike Huslage-Koch (Wikimedia)
Comme dans ses livres précédents, Qui a tué mon père, d’Édouard Louis, a pour centre la violence : celle que l’on subit, celle que l’on inflige, violence physique et psychologique. Mais la violence dont il est question ici dépasse les limites de ce que l’on entend habituellement par « violence » puisqu’il s’agit aussi de violence symbolique, de violence systémique, de la violence de rapports de pouvoir qui ne se réduisent pas aux coups de matraque de la police. Ce sont toutes ces dimensions de la violence que visent à décliner En finir avec Eddy Bellegueule, Histoire de la violence et, aujourd’hui, Qui a tué mon père. La violence n’est jamais simplement localisée dans un type d’actes, dans un « lieu » exclusif, dans une institution identifiable, dans un sujet qui par essence l’exercerait : elle est dispersée à travers un ensemble de relations et de places plurielles et variables.
Face à cette violence, écrire pourrait apparaître comme une violence en retour – présente dans les titres : « en finir », « tué », – mais surtout comme une lutte contre la violence, celle des autres autant que la sienne, comme une façon de contrer ses objectifs et ses effets, en même temps qu’un moyen de faire exister les individus par-delà cette violence, y compris, comme dans Qui a tué mon père, par-delà celle qu’ils peuvent exercer. Il ne s’agit pas d’absoudre dans un geste chrétien, encore moins de tout rendre équivalent en mettant sur un même plan les victimes et les bourreaux. Si la violence est constitutive, elle l’est de tous et s’exerce sur tous, comme le père du livre qui à la fois peut infliger la violence de paroles, de silences, d’actes, et subir lui-même la violence de son fils, la violence sociale, la violence d’un néolibéralisme économique et politique destructeur. La violence ne définit pas une essence mais est le mode de rapports mobiles et complexes, stratifiés, pluriels.
Ce que l’on pressent en lisant « Histoire de la violence », c’est qu’Edouard Louis n’en a pas fini avec Eddy Bellegueule, que comme pour Annie Ernaux, sa littérature est indissociable de son histoire, qu’elle en est et en sera sans doute à jamais imprégnée, qu’elle en constitue en quelque sorte l’ADN. C’est la terre où il a grandi, aride, hostile (pour lui, parce qu’il était différent et donc inadaptable au modèle imposé par cette société), c’est ce terreau, et son échappée, qui donnent à Edouard Louis sa singularité.
Edouard Louis ne répète pas ce que les livres lui ont appris. Edouard Louis ne refait les gestes que son monde lui a montrés.
Il s’est échappé de sa condition, mais n’en a pas adopté une autre (même s’il essaie : changement de nom, de langage, d’habitudes vestimentaires, déménagement, études, amis intellectuels). Il est à la fois là, et ailleurs. Edouard Louis est lui-même, brutalement, comme obligé, et c’est ce qui lui donne ce regard unique, une voix qui fait de lui un écrivain.
Qui a tué mon père s’organise autour de souvenirs du narrateur, souvenirs qui sont comme des instantanés brefs, suscités – lors d’un retour du fils auprès de son père –, par la vision de ce qu’est devenu celui-ci : un corps en lambeaux, souffrant, détruit. Ce corps est l’axe du récit, ce à partir de quoi les souvenirs se déploient et ce vers quoi ils convergent. Et ces souvenirs formeront une histoire de ce corps, une sorte d’archéologie par laquelle est reconstituée une histoire faite d’une violence plurielle qui, s’exerçant sur ce corps, étant aussi produite par lui, aboutit à son état présent, à l’état détruit de ce corps déjà presque agonisant. Le corps subit une sorte de fatalité : celle de la violence sociale, physique, psychologique, symbolique, économique, violence de discours et de gestes qui assignent des identités, des places à l’intérieur des relations. Le livre d’Édouard Louis construit l’histoire de cette violence, entremêlant la pluralité qui lui est inhérente, les différentes strates qui la constituent, pour aboutir à cet état d’un corps massacré, lentement assassiné.
Si ce corps est ainsi mis en avant, c’est qu’il est ce qui dans ce massacre est le plus évident, le plus immédiatement visible. Mais il est aussi le signe d’un processus de démolition, d’une logique destructrice qui, moins visible, tirant en partie son efficacité de ne pas l’être, doit être mise au jour.
C’est cette opération de mise au jour que, de manière extrêmement condensée, réalise Qui a tué mon père. Il s’agit de faire l’histoire de ce corps pour, à travers celle-ci, faire l’histoire des dimensions d’un pouvoir pluriel et violent, pour faire apparaître le développement de ce pouvoir à travers la durée d’une vie.
Habituellement, la violence structurelle, systémique, n’est pas perçue en tant que telle, elle est au contraire recouverte par des discours et représentations qui la font passer pour un ordre naturel des choses, ordre qui permet à la violence, dans toutes ses dimensions, de s’exercer efficacement, de détruire ou sauver selon la place que l’on occupe dans le système. Ainsi les pauvres sont des fainéants, les hommes sont virils, faire des études est une idée de PD, etc.
Tout un ensemble de discours, de stéréotypes, de conditions matérielles est réuni pour produire en chacun une subjectivité, une représentation de soi et des autres, une identité que l’on s’attribue ou que l’on attribue aux autres, des affects et façons de percevoir – tout ceci étant régulé par une logique de la violence par laquelle cette violence est produite et reproduite. Si la violence est constitutive des relations mais aussi, à l’intérieur de ces relations, des identités et subjectivités, cette violence n’est jamais « naturelle », elle est toujours – comme les identités, les subjectivités, les existences matérielles – prise dans un système de production de cette violence, elle est acquise, transmise, répétée selon des modalités plurielles et complexes. Ce sont ces modalités et cette complexité qu’Édouard Louis déplie et donne à voir.
Il n’y a pas d’un côté les méchants et de l’autre les gentils, personne n’est en soi victime ou bourreau même si, dans le système, les places de la victime et du bourreau ne sont pas équivalentes, ne doivent pas être confondues selon une forme de cynisme qui ne serait, au fond, qu’un masque pour la domination et la violence. Dans Histoire de la violence, par exemple, celui qui subit le viol est aussi celui qui peut facilement, en tant que Blanc, exercer la violence, reproduisant un système de violence raciste. Aux positions de l’agresseur et de l’agressé dans ce cas de violence sexuelle – positions conditionnées par un système hétérocentré et sexiste – se superposent ici celles du Blanc et du non Blanc, de celui qui est devenu un membre de la bourgeoisie intellectuelle et de celui qui demeure parmi les pauvres, les déclassés, etc. L’identité de chacun est ainsi multiple, et son action sur les autres ou ce qu’il peut subir, sa place dans la relation de pouvoir sont mobiles et pluriels. Dans Qui a tué mon père, le père et le fils occupent tour à tour des places différentes, le rapport de pouvoir s’inversant, sautant d’une strate à l’autre, d’un degré à l’autre – mobilité qui s’accompagne d’affects et sentiments eux-mêmes mobiles, complexes, réversibles, et d’une subjectivité traversée de changements et inversions. (Cette pluralité et complexité sont d’ailleurs condensées dans le titre du livre qui peut être autant lu comme une affirmation que comme une interrogation mais sans point d’interrogation : celui ou celle ou cela « qui a tué mon père » n’étant pas, dans le titre, énoncés, peuvent correspondre à une pluralité d’assassins divers et tous également coupables ; la couverture du livre peut aussi être lue comme « Édouard Louis qui a tué mon père », ouvrant une série d’interprétations possibles sur l’identité du coupable…).
Cette complexité des relations de pouvoir est l’objet des livres d’Édouard Louis, la mobilité et pluralité de celles-ci, les subjectivités qui leur sont liées, leurs effets matériels, affectifs, politiques. Dans Qui a tué mon père, Édouard Louis insiste sur la sorte d’enfermement impliqué par ces relations : enfermement non pas nécessairement dans des prisons ou des asiles, mais à ciel ouvert, dans son propre corps, sa propre tête : emprisonnement que l’individu opère lui-même sur lui-même – sans pourtant que cette opération ait été consciemment choisie – comme il le produit chez les autres.
Le soi est un soi qui résulte d’une oppression subie autant qu’auto-effectuée, comme l’autre est constitué autant qu’il se constitue à l’intérieur de ce système d’oppression sans matraque ni esclavage. Ce qui en résulte est l’exclusion de possibles non actualisés, étouffés et recouverts par le poids d’un soi qui est le produit fini d’une chaîne de production de la violence.
Ces possibles affleurent parfois dans un geste, un regard, une action imprévue ou insuffisamment maitrisée par la subjectivité policière qui est devenue la nôtre. Ils sont là, dans le corps, dans la pensée, en conflit avec le corps et la pensée du flic que nous constituons en nous, et parfois lui échappent, la plupart du temps lui obéissent – ce que chacun est se constituant à l’intérieur de ces rapports conflictuels, se déplaçant sans cesse à l’intérieur de ces rapports : subjectivité scindée, plurielle, mobile…
Par rapport à cette réalité des rapports violents constitutifs d’un pouvoir anonyme et pluriel, l’écriture aurait deux fonctions. La première consiste, par l’écriture, par le livre, à s’emparer d’un moyen qui dans l’ordre de la violence sert à perpétuer et à produire cette violence – violence symbolique, violence dont les effets sont bien matériels – mais pour étaler cette violence, sa réalité, ses mécanismes, ses effets. L’écriture, donc, comme moyen d’une mise en évidence de ce qui nous gouverne et, littéralement, détruit. Un moyen valorisé de l’ordre bourgeois, hétérocentré, sexiste, raciste, néolibéral, devient la possibilité d’une arme contre cet ordre. La seconde fonction de l’écriture consiste à faire exister, au sein de l’ordre symbolique, ceux et celles qui en sont exclus, de faire advenir leurs paroles, leurs réalités, leurs vies à l’intérieur d’un système qui habituellement n’en veut pas, qui au contraire pour exister ne peut que les exclure et les piétiner. Ce qui, par l’écriture advient dans l’espace public, dans l’espace valorisé de la littérature, c’est non seulement toutes ces vies ignorées, condamnées, massacrées, mais aussi une dénaturalisation qui sert d’alibi aux assassins. L’écriture est ici synonyme d’échec de la violence – une sortie hors de ses rouages, une sorte de sabotage. Ce serait la question centrale de ce livre d’Édouard Louis comme des précédents : comment s’extraire de la violence ? comment la combattre mais surtout lui échapper, exister autrement et ailleurs que dans les mailles de sa logique ?
Édouard Louis, Qui a tué mon père, éditions du Seuil, mai 2018, 96 p., 12 €
Décryptez Qui a tué mon père d’Édouard Louis avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Qui a tué mon père, ce roman politique radical ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette oeuvre dans une analyse complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette – Un résumé complet – Une présentation des personnages principaux tels que le narrateur et son père – Une analyse des spécificités de l’ Un roman politique et dénonciateur; Les mécanismes d’exclusion et de domination; Le entre langue orale et langue littéraire Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’oeuvre.
À propos de la collection Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d’analyse d’oeuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes oeuvres littéraires.
La littérature est un sport de combat
Après avoir lu les deux précédents romans d’Edouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule et Histoire de la violence qui furent pour moi des véritables réussites littéraires, Qui a tué mon père était une obligation de lecture. L’approche sociologique que l’auteur apporte à sa littérature est un véritable plaisir.
Ce livre, c’est la déclaration d’amour d’Edouard Louis à son paternel. Paternel qui l’a rejeté à de multiples reprises mais qui ne l’a jamais non plus délaissé. C’est dans cet entre-deux que les deux hommes n’ont jamais vraiment réussis à se saisir, à s’aimer même si dans le fond l’un est inexorablement lié à l’autre.
« Chez ceux qui ont tout, je n’ai jamais vu de famille aller voir la mer pour fêter une décision politique, parce que pour eux la politique ne change presque rien. […] Pour les dominants, le plus souvent, la politique est une question esthétique : une manière de se penser, une manière de voir le monde, de construire sa personne. Pour nous, c’était vivre ou mourir. »
Édouard Louis est écrivain. Ses premiers romans, En finir avec Eddy Bellegueule et Histoire de la violence ont été traduits dans une trentaine de langues.
« Cinglant comme une gifle, son texte est celui d’une urgence. Une des voix majeures pour dire la France d’aujourd’hui. »
Nelly Kaprièlian, Les Inrocks