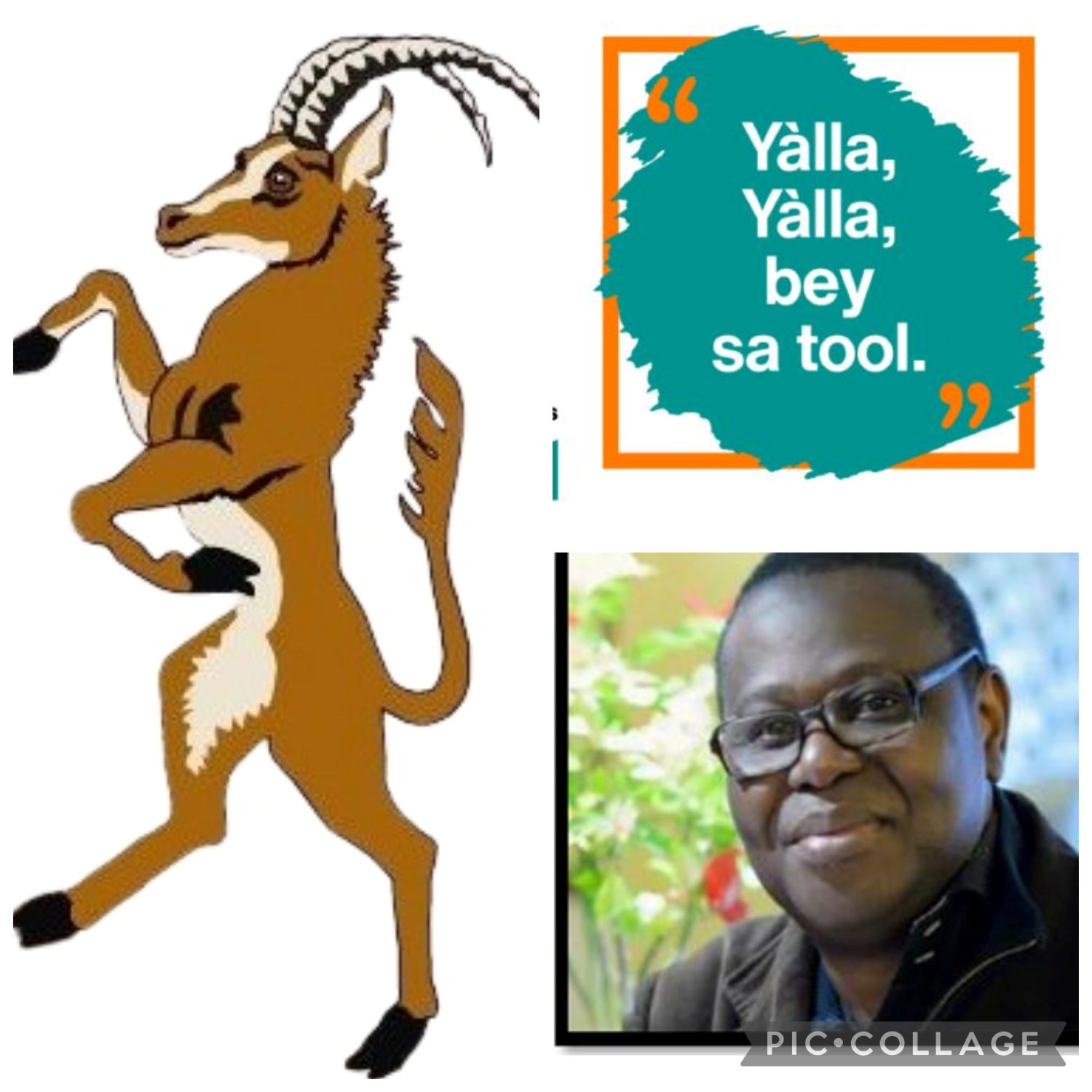« Quand les intellectuels s’approprient notre patrimoine il faut les suivre. Hier le Pr Alpha Sy Venu de du Sénégal nous a offert une conférence sur le corpus de Sembène Ousmane le père du Cinéma africain. C’est une occasion que l’éducation nationale, le ministère de la jeunesse aurait pu saisir pour promouvoir ces oeuvres dans les établissements. on doit d’abord se connaître plutôt que de nous laisser envahir par les autres . Un esclavage culturel alors qu’il faut résister. Enracinement et ouverture » suivre aussi Cécile Thiakane dans la même veine, Massamba Gueye, Amélie MBAYE, Raymond SEMEDO, etc. ils sont nombreux « , , . P BC
Pour le sociologue que je suis, naviguant entre l’Occident et l’Afrique, il est fascinant d’observer comment certains concepts venus d’ailleurs trouvent leur pertinence ou se transforment sur le terrain africain. Les théories d’ailleurs confrontées aux pratiques locales, révèlent des prolongements inattendus.
Cet article propose une réflexion sur cette rencontre, en montrant à travers une voix populaire que l’Afrique n’est pas périphérie mais centre de gravité théorique.
Quand la parole populaire devient puissance critique
Un ami me demanda un jour : « Sur quoi portent tes recherches ? »
Je lui répondis : « En ce moment, je réfléchis sur la manière dont certains concepts venus d’Occident s’éprouvent en Afrique. Comment ils éclairent certaines réalités, et comment, en retour, ces réalités les déplacent où les réinventent. »
Il réfléchit un instant, puis me dit : « Alors, écoute les analystes populaires. Ceux qui, sur les réseaux, traduisent le quotidien en paroles critiques. »
Intrigué, je suivis son conseil. Après avoir visionné plusieurs vidéos circulant sur Internet, une figure s’imposa rapidement : Sa Ndiogou. Sa voix, à la fois grave et rythmée, ses phrases ramassées comme des coups de cymbales, ses rires soudains et ses silences calculés avaient quelque chose d’inoubliable. Mais plus encore, ses chroniques oscillaient entre le comique et le tragique, révélant dans un même souffle la douleur d’une société abîmée et la légèreté d’un humour libérateur. C’est ce tragi-comique, à la fois miroir et antidote, qui donnait à sa parole une densité singulière. Très vite, je compris qu’il n’était pas seulement un amuseur public ni même un simple analyste : il incarnait une figure conceptuelle, un intellectuel critique situé, qui obligeait à revisiter nos catégories d’analyse en prenant au sérieux la puissance de l’oralité africaine.
Sa Ndiogou et la grammaire de la critique politique en Afrique
A travers le personnage de Sa Ndiogou se donne à lire le rôle singulier des enfants des daaras (écoles coraniques) dans la formation d’une avant-garde politique. Son langage nourri de proverbes, de métaphores et de références religieuses, constitue une herméneutique populaire : une interprétation critique du réel, enracinée dans la mémoire collective et la culture sénégalaise. Il témoigne de la capacité des savoirs locaux à dépasser la simple répétition d’une tradition figée pour produire des rationalités critiques, capables de dialoguer avec les grandes théories sociales tout en les déplaçant.
Sa Ndiogou incarne avec force la vérité énoncée par Bourdieu dans Ce que parler veut dire : la parole n’est pas un simple instrument de communication, mais un acte social chargé de pouvoir symbolique. Ses interventions, nourries de proverbes, de métaphores et de références religieuses, montrent que l’oralité sénégalaise n’est pas folklore, mais une puissance critique.
Lorsqu’il lance : «Fuki di gàss, fuki di suul » (Dix personnes creusent des trous et dix autres les remplissent), Sa Ndiogou dénonce avec ironie les détournements de fonds publics et l’absurdité d’une gestion corrompue.
Quand il affirme : (Kenn mënul ji tay, góob tay. Ci bi nuy jàngkoonteel ak jafe-jafe yi, ci la nuy jëmbat guyug ëllëg ngir bu sunuy doom maggee, mën a mos ci buy yi ci juddoo.)
On ne sème pas et pour espérer récolter le même jour. Pendant que nous affrontons les difficultés d’aujourd’hui, nous plantons le baobab pour l’avenir. Et lorsque nos enfants grandiront, ils goûteront aux fruits généreux qu’il portera.
Sa Ndiogou rappelle ici la valeur de la patience et la nécessité des sacrifices collectifs pour bâtir l’avenir. Cette image du baobab ne renvoie pas seulement à la sagesse populaire ; elle illustre aussi un schéma que les économistes appellent modèle à générations imbriquées.
Dans cette perspective, les décisions prises par une génération — travail, épargne, investissements — influencent directement le sort des générations futures. C’est ce cadre qui permet de comprendre des politiques de long terme comme le financement des retraites, l’accumulation de dettes publiques ou les investissements éducatifs. Ainsi, derrière la métaphore poétique de Sa Ndiogou, se profile une lecture fine des interdépendances entre présent et avenir, entre efforts d’aujourd’hui et prospérité de demain.
Enfin, en déclarant : (« Lu ne fàng ci jànt njolloor, kenn du ku niit.» ) On ne cherche pas avec une torche celui qui marche déjà sous le soleil »).
Sa Ndiogou invite à la lucidité et à la prudence. Cette formule, à la fois poétique et incisive, met en garde contre les manipulations politiques et les faux-semblants. Elle pointe aussi le rapport à l’évidence : l’art de nier ce qui est visible, pratiqué par certains membres de la classe politique ou relayé par des voix médiatiques complices.
Ces formules ne sont pas des ornements rhétoriques. Elles fonctionnent comme des actes. Elles déstabilisent les justifications de la classe politique qui a conduit à la situation économique et sociale catastrophique ; elles éclairent les angles morts des récits officiels et ouvrent au peuple des espaces de lucidité. Elles traduisent exactement ce que Bourdieu analysait : une parole reconnue et légitime peut orienter les perceptions collectives et fissurer les évidences imposées. Mais, à la différence de l’intellectuel universitaire dont l’autorité provient des diplômes et des institutions, celle de Sa Ndiogou naît d’ailleurs : de la force de l’oralité sénégalaise, de la mémoire populaire et du capital spirituel des daaras.
Ainsi, par sa voix et ses images, Sa Ndiogou illustre la possibilité d’une critique sociale enracinée dans les traditions locales mais pleinement tournée vers les urgences du présent. Ses chroniques montrent que l’oralité, loin d’être un vestige, demeure une arme d’émancipation collective.
Le rôle des daaras : au-delà du dogme
Comme l’a si bien observé C. Nguirane, « l’émergence des domou daara ou intellectuels non-europhones (selon l’expression du professeur Ousmane Kane) dans l’espace médiatique sénégalais traduit un changement important dans la formation de l’opinion publique. En écoutant certains, je constate qu’ils ne sont pas empêtrés dans les mailles des concepts et de la phraséologie. Ils arrivent à convaincre sans multiplier les sophismes. Et j’ose espérer qu’ils ne seront pas emportés – comme bon nombre d’intellectuels europhones – dans les tourbillons de la notoriété. »
Cette remarque vaut tout particulièrement pour Sa Ndiogou.
Ses chroniques révèlent la vitalité d’une intelligentsia populaire forgée dans les daaras, ces écoles coraniques trop souvent réduites par les regards extérieurs à des lieux de simple répétition mécanique. Or cette vision est profondément réductrice. Les daaras sont en réalité des matrices de formation intellectuelle, éthique et corporelle. Ils produisent un habitus au sens bourdieusien, mais singulièrement adapté au contexte sénégalais.
Trois registres s’y combinent :
Le registre cognitif : apprendre à mémoriser et interpréter les textes, mais aussi à relier la parole religieuse aux réalités contemporaines.
Le registre corporel : discipliner la voix, le geste, la posture, afin que la parole devienne autorité et persuasion.
Le registre éthique : cultiver la vérité, la justice et la sincérité comme repères de l’action.
Cet habitus, loin d’être abstrait, se voit et s’entend dans la parole de Sa Ndiogou. Forgée dans cette école du corps et de l’esprit, sa parole n’est pas seulement discours, mais acte. Elle prolonge ce que les scholastiques médiévaux ou Aristote avaient entrevu : l’habitus comme disposition stable tournée vers l’action et l’accomplissement moral. Mais ici, il se nourrit d’une profondeur spirituelle qui confère à l’oralité sénégalaise une dimension transcendante.
Dans la récente révolution sénégalaise, l’avant-garde fut constituée en grande partie de jeunes issus des daaras. Contrairement aux révolutions classiques où, dans la lignée marxiste, l’avant-garde émergeait de la classe ouvrière et de la conscience industrielle, ici elle s’est forgée dans un capital symbolique et religieux. Ces jeunes n’étaient pas mus d’abord par la conscience salariale ou économique, mais par la mémoire, le texte sacré et la discipline du corps.
Karl Marx avait pressenti, à travers la notion de «mode de production asiatique», que certaines sociétés échappaient aux catégories capitalistes classiques. Mais c’est Cheikh Anta Diop qui, en parlant du « mode de production africain », a montré que l’économie africaine ne peut être séparée du religieux et du symbolique. Dans l’Égypte antique, rappelait-il, le religieux était une véritable infrastructure sociale, organisant la production, la mémoire et le pouvoir.
L’expérience des daaras en offre une réactualisation contemporaine : au Sénégal, la révolution ne s’appuie pas seulement sur un capital économique, mais sur un capital spirituel et symbolique.
C’est là que se situe la singularité de figures comme Sa Ndiogou.
À travers proverbes, métaphores et récits populaires, il déstabilise les narrations officielles, met en lumière les contradictions du politique et restitue au peuple les clés d’une lecture autonome du social. Son autorité ne vient pas d’une noblesse d’État consacrée par les diplômes, mais de cette noblesse spirituelle forgée dans l’oralité et la mémoire collective.
Une herméneutique populaire et critique
La force de Sa Ndiogou tient à sa capacité à conjuguer trois dimensions dans sa parole : cognitive, éthique et corporelle. Sur le plan cognitif, il rend visibles les contradictions du politique, transformant des réalités complexes en images claires. Sur le plan éthique, il transmet des valeurs de justice, de solidarité et de responsabilité, assumant le rôle d’intellectuel organique au sens gramscien : enraciné dans la culture populaire, parlant pour et avec elle. Sur le plan corporel enfin, sa voix, ses gestes, son rythme sont constitutifs de son autorité. Comme le disait Foucault, le corps est un lieu stratégique de pouvoir et de résistance : chez Sa Ndiogou, le corps orateur devient instrument de persuasion et de proximité.
Cette oralité n’est pas décor mais pédagogie. Elle condense analyse et mémoire, raison et émotion.
Écouter Sa Ndiogou, ce n’est pas seulement suivre un chroniqueur populaire : c’est pénétrer dans un sanctuaire vivant de la parole, un lieu où les concepts respirent, se heurtent, s’éprouvent au feu du quotidien. C’est assister à la danse du sens, là où les mots deviennent matière, là où la pensée prend chair. Chez lui, chaque phrase est une forge : elle façonne le réel en même temps qu’elle le révèle, dans une clarté parfois rude, toujours féconde.
Ses récits rejoignent l’intuition de Paul Ricœur — raconter, disait-il, c’est mettre le temps en intrigue. Sa Ndiogou, lui, fait plus encore : il enchevêtre les temporalités, relie les douleurs anciennes aux promesses du présent, tisse dans la mémoire populaire le fil d’un avenir encore balbutiant. Le passé n’y meurt jamais ; il veille, vibrant, sous la peau des mots.
Et comme chez Noam Chomsky, le langage devient ici charpente de la pensée. Les proverbes qu’il lance, tels des éclats de sagesse, ordonnent les perceptions éparses, sculptent la conscience collective, éclairent les angles morts du réel. Mais ni Ricœur ni Chomsky n’auraient su dire cette part de sacré, ce souffle qui habite sa parole. Car chez Sa Ndiogou, l’oralité n’est pas simple narration ni pure cognition : elle est souffle et corps, rythme et présence.
Sa voix invoque raconte et explique le monde. Dans son timbre se mêlent les pulsations d’une mémoire ancestrale et les vibrations du présent, rappelant que parler, ici, c’est encore prier, et qu’écouter, c’est participer à une liturgie du sens.
Propositions aux collègues chercheurs et étudiants : Réflexions critiques
Nous, chercheurs et étudiants en sciences sociales, savons la force des outils théoriques. Mais nous savons aussi que ces outils ne prennent sens qu’à l’épreuve du terrain. Or, en Afrique, ce terrain résiste, surprend, oblige à reformuler les catégories.
J’invite donc mes collègues à réfléchir à ces évaluations, à interroger avec moi la manière dont certaines théories, si puissantes soient-elles, trouvent dans l’expérience sénégalaise une résonance inattendue, parfois un dépassement. Car écouter des voix comme celle de Sa Ndiogou, c’est entrer dans un champ d’observation où les concepts classiques se déplacent, se redéfinissent, s’enracinent autrement.
Là où Bourdieu décrivait la noblesse d’État et les mécanismes de reproduction sociale, l’univers des daaras et la parole de figures populaires m’invitent à penser une autre forme de noblesse — une noblesse spirituelle, fondée non sur les diplômes ni les institutions, mais sur la mémoire orale, la discipline du corps et le capital symbolique religieux. Le concept d’habitus éclaire la dimension éthique et corporelle de cette parole, mais il ne suffit pas à saisir la force de la transcendance, la manière dont le sacré informe le comportement et oriente la hiérarchie des valeurs. Ici, la reproduction sociale s’accomplit dans l’horizon de l’au-delà : le prestige se fonde sur la maîtrise de soi, la mémoire et la prière.
De même, si l’espace public d’Habermas ou la contre-hégémonie de Gramsci permettent de penser la discussion et la lutte, ils ne rendent pas justice à la densité symbolique du sacré dans la sphère publique sénégalaise. Les mosquées, les marchés, les places publiques ne sont pas de simples arènes de débat, mais des lieux de communion : la parole y devient prière, échange, offrande. L’espace public prend ici la forme d’un espace rituel, où le collectif se construit à travers la circulation des bénédictions, la voix partagée, la reconnaissance mutuelle.
Et si Gramsci voyait dans l’intellectuel organique un acteur des luttes sociales et politiques, l’observation du discours populaire invite à élargir cette figure : celle d’un intellectuel populaire et religieux, enraciné dans la communauté, nourri de la tradition, et capable de rendre au peuple la conscience critique de lui-même. Ce n’est pas un intellectuel solitaire, mais un relais collectif, une voix-miroir qui transforme la parole commune en réflexion partagée.
Chez Chomsky, le langage est un instrument cognitif et critique ; à travers cette oralité sénégalaise, il devient davantage : parole-rythme, voix-émotion, énergie vivante. La parole y pense par le corps, elle organise le collectif par la musicalité, par le souffle même du dire. Elle ne transmet pas seulement une idée : elle fait sentir, elle fait croire, elle fait agir.
Ainsi, les limites des concepts occidentaux ne marquent pas des échecs, mais des ouvertures. Elles nous invitent à déplacer nos cadres, à revisiter nos catégories, à écouter ce que les daaras, l’oralité critique et des figures populaires nous enseignent sur la relation entre le social, le symbolique et le spirituel. Cheikh Anta Diop l’avait déjà affirmé : penser depuis l’Afrique, c’est reconnaître que l’économie, le religieux et le politique sont indissociables — et que la révolution la plus féconde ne se joue pas seulement dans les structures matérielles, mais aussi dans la mémoire et le souffle du sacré.
Le discours de Sa Ndiogou en offre une illustration éloquente : l’oralité n’y est pas une survivance culturelle, mais une forme dynamique de raisonnement collectif et d’émancipation.
Penser à partir de ces voix africaines, c’est rouvrir les sciences sociales à un autre rythme — celui du vivant, du collectif et du transcendant. C’est apprendre à penser avec le monde, et non plus seulement sur lui.
La théorie, dès lors, ne naît pas uniquement dans les bibliothèques ou les institutions universitaires ; elle se façonne aussi dans les mosquées, les marchés, les places publiques, et jusque dans les espaces conversationnels des réseaux numériques.
Je me souviens d’un moment formateur de mon enseignement à l’Université de Princeton. Dans le cadre d’un cours sur les formes culturelles et les sphères politiques, j’avais conduit mes étudiants à Harlem pour rencontrer un griot mandingue venu de Gambie. Ensemble, ils ont échangé sur la question du leadership dans les sociétés africaines. Ce dialogue, d’une profondeur rare, leur révéla que la théorie peut surgir d’une voix vivante, du rythme de la mémoire et du récit. Leur demande d’organiser un séminaire avec ce griot ne fut jamais concrétisée, mais l’expérience demeura transformatrice : elle montra que la connaissance peut émerger autant du dialogue et de la performance que de l’analyse.
Cette expérience souligne la nécessité de mettre nos outils conceptuels à l’épreuve des contextes africains. Comme le rappelait Gaston Bachelard, un concept n’a de valeur que dans sa capacité à « fonctionner en extension et en profondeur ». Dans les proverbes, les métaphores et les rythmes incarnés de la vie quotidienne, se nichent des intuitions théoriques en attente de reconnaissance et d’élaboration.
J’invite ainsi les chercheurs, notamment au sein des universités africaines, à ouvrir leurs espaces d’enseignement aux sachants locaux — griots, artisans, maîtres soufis — dont les pratiques et les récits peuvent enrichir et bousculer la pensée académique. Penser depuis l’Afrique n’est pas un repli provincial, mais un geste d’ouverture épistémique. Cela revient à affirmer que l’oralité, la mémoire et le corps sont des lieux légitimes de théorisation, capables de contribuer aux débats mondiaux sur la connaissance et le sens.
La voix de Sa Ndiogou incarne pleinement ce potentiel : un discours populaire et spirituellement ancré, qui déstabilise les récits dominants et redéfinit la possibilité même d’une pensée critique venue du Sud. Écouter ces voix, c’est reconnaître que l’Afrique n’est pas une périphérie de la pensée, mais l’un des centres de gravité théoriques du monde à venir.