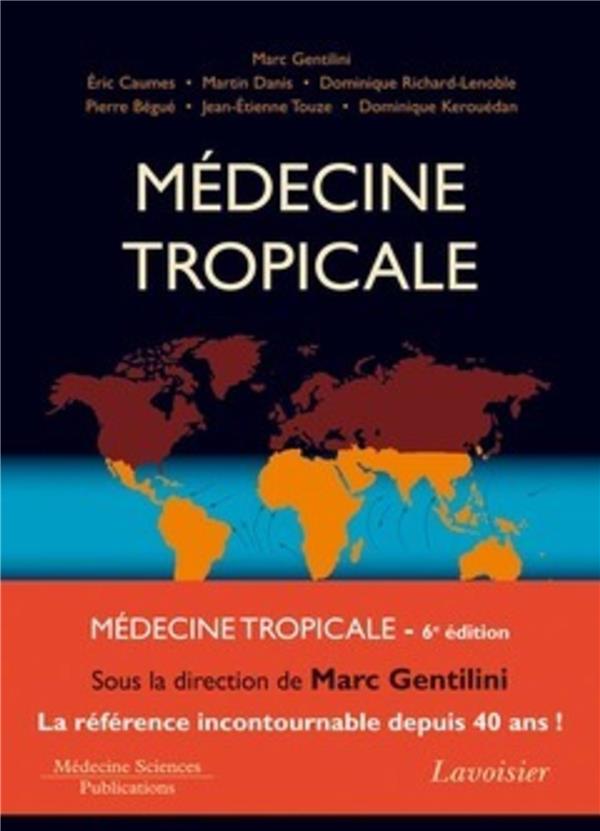Médecine tropicale Collectif, Marc Gentilini
‘C’est une amie soudanaise qui me parle de cet Homme d’une grande générosité et d’une sagesse inouïe. Assis sur les transats de Paris Plage 2025- 28/08/, cette amie me parle de faits et des hommes qui ont marqué son parcours. J’aime découvrir et apprendre à connaître et quand une personne que vous appréciez beaucoup ( le hasard n’existe pas rires) vous parle de quelqu’un avec emphase, on se doit de suivre ses mots et ses émotions, c’est pourquoi j’ai cherché à connaître ce géant de la médecine et de surcroît celle tropicale et spécialisé sur le VIH Sida. Il aimait depuis son enfance le Mali et a fini par vivre dans ce pays. Hasard ? Destin qui sait ? On ne parle de lui comme un métro venu exploiter l’Afrique, mais un humain au service de l’humain. Pape B CISSOKO
Lavoisier Médecine Sciences Traites 26 Septembre 2012
Depuis sa première parution il y a 40 ans, sous la direction de Marc Gentilini, Médecine tropicale a acquis une renommée internationale. Cette 6e édition, entièrement réactualisée et en couleurs, reste fidèle au concept original : offrir au lecteur le maximum de renseignements dans un style direct et didactique, reflet de la riche expérience des auteurs.
La médecine tropicale se définit comme la prise en charge et le traitement des maladies survenant dans un environnement tropical ou subtropical. Cette pathologie, géographiquement déterminée, n’est pas limitée au Sud et se rencontre également au Nord du fait des migrations humaines, mais elle atteint avant tout les populations pauvres des pays en développement La première partie du livre dresse le panorama dans lequel elle s’inscrit à travers la géographie, la population mondiale, le développement de celle-ci, les aides internationales ou régionales. Cette vision globale est la condition indispensable pour comprendre les enjeux de santé des pays du Sud.
Les parties suivantes sont consacrées à l’ensemble des maladies transmissibles, parasitoses, mycoses, maladies bactériennes et maladies virales rencontrées dans l’hémisphère austral. Mais aujourd’hui, les maladies non transmissibles prennent une place de plus en plus importante dans les pays en voie de développement où cancers, diabète, maladies respiratoires, affections cardiovasculaires, tendent à devenir, ensemble, les principales causes de mortalité.
L’émergence de ces maladies s’ajoute aux affections traditionnelles qui diminuent en pourcentage mais guère en valeur absolue compte tenu de la poussée démographique. Elles revêtent souvent, à cause de l’environnement, des aspects originaux exposés pour chaque discipline (hématologie, cardiologie, pneumologie, etc.) : la symptomatologie, les traitements des maladies cosmopolites diffèrent non seulement du fait de leur localisation en zone tropicale mais aussi des difficultés d’accès aux traitements de qualité. Il en est de même pour la chirurgie, dont les singularités et les carences sont le reflet de la précarité en moyens matériels et humains.
Une partie entière est consacrée à la pédiatrie : la population infantile, qui représente la moitié de la population des pays tropicaux, est prioritairement touchée par les conditions socio-économiques et environnementales défectueuses. La prévention des maladies tropicales est exposée à travers la vaccination, la lutte antivectorielle, l’assainissement, l’éducation sanitaire, les conseils aux voyageurs se rendant dans les pays tropicaux.
L’ouvrage s’achève par une présentation de l’épidémiologie adaptée à la zone tropicale. Les études épidémiologiques permettent de planifier rigoureusement les actions de santé communautaire et de rentabiliser au mieux les moyens disponibles, mais elles se heurtent à des difficultés logistiques imposant des méthodes originales et tenant compte de ressources humaines insuffisantes. Fermer
Marc Gentilini
Marc Gentilini, né le 31 juillet 1929 à Compiègne (Oise), est un professeur de médecine français, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, membre de l’Académie nationale de médecine, président honoraire de la Croix-Rouge française.
Cursus
À l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Marc Gentilini occupe successivement les emplois de professeur de parasitologie, de santé publique et de clinique des maladies infectieuses et tropicales au Pavillon Laveran. C’est du service qu’il dirige que partit le ganglion dans lequel le Pr Luc Montagnier et ses collaborateurs purent identifier le virus du sida[1].
À la Pitié-Salpêtrière, il rencontre notamment Bernard Duflo (1943-1988), médecin, lui aussi professeur à la Faculté de médecine de l’hôpital, puis maître de conférence agrégé à l’École nationale de médecine et de pharmacie de Bamako (Mali), initiateur de la médecine interne à l’hôpital du Point G à Bamako, dès 1975, créateur du département d’hématologie. Marc Gentilini co-écrira Médecine tropicale avec Bernard Duflo.
Professeur de médecine, spécialiste des maladies infectieuses, Marc Gentilini crée en 1988, avec quelques médecins français et étrangers confrontés à l’épidémie de VIH, l’Organisation Pan Africaine de Lutte contre le Sida (OPALS)[2]. L’objectif est de mettre à disposition des personnes infectées par le VIH vivant dans les pays du Sud, les médicaments disponibles au Nord.
Il est membre de l’Académie de Médecine depuis 1991 qu’il a présidé en 2008. Il est aussi élu membre libre de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer[3] depuis le 6 décembre 1996.
Engagements publics et associatifs
En juin 1997, Marc Gentilini est élu Président de la Croix-Rouge française et exerce cette fonction jusqu’en 2004. Il est président-fondateur l’Organisation Pan Africaine de Lutte contre le Sida (OPALS). Il est membre du Conseil économique, social et environnemental de 2002 à 2010. Il y rédige un avis critique en 2006 sur la « coopération sanitaire française dans les pays en voie de développement » [archive].
Il est ancien Membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme et ancien Membre du premier collège de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité de sa création en 2005 jusqu’en 2007. Il a été président de l’Académie de l’Eau de 2002 à 2013[4]. Il est délégué général de la fondation Chirac[5] pour l’accès aux médicaments et à une santé de qualité depuis 2009. Il est également membre du comité de parrainage de l’Association française pour l’information scientifique (AFIS) depuis 2017. Marc Gentilini, une passion l’Afrique, une profession de foi l’humanisme
Enfant de la guerre, comme il se définit, Marc Gentilini est né à Compiègne en juillet 1929. À dix ans, alors que la Seconde Guerre mondiale éclate, il vit au côté de sa mère, infirmière engagée volontaire de la Croix-Rouge, au sein d’un hôpital militaire au cœur de la Somme. L’avancée de l’armée allemande amène la famille à fuir et à prendre le chemin de l’exode. Quand on lui confie, des décennies plus tard, la présidence de la Croix-Rouge française, il se souvient qu’attaqués sur les route de Picardie par les « stukas » allemands, il disait à mon frère, « N’aie pas peur, nous sommes dans une ambulance de la Croix-Rouge, l’emblème nous protège, on ne nous tirera pas dessus ». Conviction illusoire dans la plupart des cas !
Prisonnier de guerre, son père est absent pendant les cinq années que dure le conflit et la famille vit pauvrement. Élève chez les Jésuites qui le prennent matériellement en charge à Reims pendant toutes les années de guerre. L’Armistice signé, il est marqué par la visite spectaculaire du général de Lattre de Tassigny, venu remercier les pères jésuites d’avoir caché son fils Bernard (tué plus tard en Indochine) pendant les années d’occupation. Cette visite réveille les consciences et l’on ne cessait de nous demander de « donner de notre personne », de rendre à la société ce que nous avions reçu, un peu comme des privilégiés. C’est dans cette ambiance que j’ai décidé de « faire médecine », choix moral et un choix personnel.
Parallèlement à cet engagement, avec quelques camarades, nous nous rendions régulièrement dans un des quartiers ouvriers de Reims pour animer des activités de « patronage ». Devant la pauvreté de ces habitants, j’ai ressenti l’envie d’agir et d’y revenir m’y installer comme généraliste…
La route semblait toute tracée, un autre pôle d’intérêt cependant va en changer le cours. En première année de médecine, à Reims, j’ai décroché le premier prix, ce qui m’a permis d’acheter un planisphère. Installé sur un mur de ma chambre, en l’observant, j’étais fasciné, au cœur du « Soudan français » (futur Mali), par la ville de Bamako. J’ai su de suite que c’était là que je voulais aller. Séduit par le continent africain et ses multiples cultures, le futur spécialiste des maladies tropicales lit de nombreux ouvrages sur le sujet.
Avant de partir à la découverte de cet horizon lointain, Marc Gentilini gagne la capitale et poursuit ses études et les concours d’externat et d’internat des Hôpitaux de Paris. Nommé interne, il intègre le service de médecine générale du Professeur André Domart qui m’adopte et me propose un poste fixe dès la fin de mon internat dans son service. Mon maître, lassé par les tensions hospitalo-universitaires (un monde difficile et complexe), me délègue rapidement beaucoup de responsabilités.
Rattrapé au cours de son cursus universitaire par le Service National, obligatoire, trente mois, Marc Gentilini part en Afrique en tant que médecin « appelé”. Au terme de six mois en Algérie, j’ai été muté en Afrique noire. Après une traversée en bateau, je suis arrivé à Dakar au mois novembre, la meilleure saison pour découvrir ce pays : transmission du paludisme plus rare, végétation luxuriante au décours de la saison des pluies. Mais à peine arrivé, on lui annonce son départ pour Bamako, la destination de ses rêves ! Le permis de conduire en poche, obligatoire pour manœuvrer l’ambulance, délivré en 15 minutes auprès d’un capitaine d’aviation manchot, Marc Gentilini n’a pas le temps de poser sa valise dans la capitale du Mali, qu’il prend aussitôt la route de Gao, ville où il est affecté. Envoûté par la ville des Askias, vieille civilisation de la boucle du Niger, il partage son temps entre la « base aérienne » dont il a la responsabilité et « l’ambulance » hôpital local dans la ville.
Parallèlement à ces activités, il effectue les tournées dans toute la région, aujourd’hui aux mains des islamistes : Kidal, Tessalit, Menaka et ainsi se familiarise avec les maladies tropicales.
Quand vient l’heure du retour à Paris, en 1959, difficile pour le jeune interne de s’arracher à l’Afrique. Une lettre de son « Patron » le contraint à reprendre ses études pour les achever et se spécialiser. Bientôt Marc Gentilini ouvre, au sein du service de médecine générale où il travaille, une consultation consacrée aux maladies tropicales et parasitaires. Les patients affluent, de l’éboueur à l’ambassadeur, du voyageur au coopérant de tous bords. Un temps, il est nommé professeur visiteur à Port-au-Prince, en Haïti. Expérience éprouvante mais enrichissante. Assigné à résidence durant 3 mois, conséquence de la mise en place de la dictature de Duvallier, père, alias « Papa Doc » et ses tontons macoutes, j’ai eu tout le loisir de dévorer le fonds de livres du Centre culturel français racontant l’histoire de Saint-Domingue, celle de l’esclavage, de la révolte de Toussaint Louverture et de l’épidémie de fièvre jaune qui décimât le corps expéditionnaire français.
Histoire des pays situés sous les tropiques, histoire de leur économie, histoire et environnement des maladies, populations et culture, tout cela enrichit le jeune médecin et ancre en lui définitivement cet intérêt pour la médecine exotique.
Après l’agrégation, à 36 ans, il devient, pour un temps, directeur du Laboratoire central de l’hôpital Saint-Louis, chargé de l’hématologie, de la bactériologie, de la virologie, de la parasitologie et de la mycologie… Poste difficile qui le prive de clinique et ne lui convient pas, mais lui permet de rencontrer le professeur Jean Bernard, pour lequel il a beaucoup d’admiration et Jean Dausset, le futur prix Nobel.
S’appuyant sur une équipe solide, performante et engagée, il continue à travailler avec son ancien Patron, André Domart, entretemps installé à l’hôpital Claude Bernard. Le succès d’une entité hospitalière, associant la clinique et la biologie, ne plaît pas à tous les confrères, notamment à ceux qui avaient, jusqu’à présent, le monopole des maladies infectieuses. « En mai 68, la révolte étudiante déferlant, j’en profite pour choisir, sur le plan universitaire, la Pitié-Salpêtrière, tout en restant rattaché à Saint Louis et à Claude Bernard, au plan hospitalier ». Mais soucieux de se séparer de l’élément perturbateur que j’étais, on me propose un vrai plein temps avec unité de lieu à la Pitié Salpêtrière ; je pose mes conditions : 20 lits. Mes exigences satisfaites, je m’installe définitivement dans ce grand Centre hospitalier et y crée, en quelques années, au pavillon Laveran (du nom du découvreur de l’agent responsable du paludisme), un ensemble clinique, biologique et de recherche, avec le concours de l’INSERM, pour la prise en charge des maladies infectieuses et tropicales, plus attractif que les autres structures. Ce dynamisme n’est pas du goût de tous et le combat fut difficile.
Mais en 1981, apparaissent les premiers cas, aux États-Unis, de ce que l’on n’appelait pas encore le Sida mais qui se révèle être un syndrome immunitaire surprenant, nouveau et grave, alors que les maladies infectieuses, au moins dans nos contrées, paraissaient maîtrisables. À l’époque, avec un de mes assistants, Willy Rozenbaum, transfuge de l’Hôpital Claude Bernard où son impétuosité avait déplu, nous décidons d’ouvrir une consultation dédiée à cette nouvelle maladie. L’inquiétude est grande devant l’augmentation du nombre de cas, la mortalité et l’incertitude quant à l’agent pathogène ; nous adressons un ganglion à l’Institut Pasteur, convaincus qu’il faut rechercher l’agent pathogène dans celui-ci plutôt que dans le sang.
C’est à partir de ce ganglion que sera découvert, en 1983, le virus du Sida. Les années passent, dures et douloureuses. « De 1981 à 1996, 99 % des malades ayant une sérologie positive meurent. Dans les dix premières années du Sida, j’ai perdu dans mon seul service, 2 000 jeunes malades. C’est au cours de cette triste période que je rencontre Daniel Defert, alors secrétaire de Michel Foucault, qui cherche à créer une association afin de protéger les patients séropositifs victimes de discriminations. Avec deux autres chefs de service de l’Hôpital Saint-Louis et de Claude Bernard, nous décidons d’appuyer son initiative ». Ainsi est né « AIDES ». Il a fallu aussi tenir des « amphis » pour rassurer les personnels soignants sur la contagiosité de la maladie ». Catholique, j’ai vite interpellé les autorités religieuses sur ce sujet et, avec l’archevêque de Paris, le Cardinal Lustiger, nous avons mis en place le Centre de la rue de Varenne pour accueillir les patients séropositifs.
Par la suite, Marc Gentilini alerte l’Académie de médecine et la communauté internationale sur le fait que le Sida n’est pas une maladie des homosexuels nordaméricains ou européens, mais avant tout une affection qui atteint les femmes et les enfants, et qui, au total, est d’abord une maladie hétérosexuelle sévissant dramatiquement en Afrique, épicentre de la maladie. En parallèle, il anime l’Organisation PanAfricaine de lutte contre le Sida (OPALS) et crée en 1988 les premiers Centres de Traitement Ambulatoire (CTA) des malades du « Sida » en Afrique. Enfin 1996 arrive, année de résurrection, avec la mise sur le marché des premiers antirétroviraux (bi et trithérapies).
Les années passent, les missions en Afrique se succèdent, Marc Gentilini continue
son parcours. ÀA 66 ans, arrive la « retraite ». Sa succession à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière réglée, il continue, un temps, dans son ancien service comme
Consultant.
Deux ans après, il est appelé à présider, pendant 7 ans et demi, la Croix-Rouge Française, qu’avec une équipe dynamique, il réveille et bouscule. Son mandat se termine la vieille du tsunami de 2004. Philippe Douste-Blazy, alors ministre de la Santé, lui propose la présidence d’un groupe de vingt associations en charge de l’enfance dans le Sud-Est asiatique, poste qu’il assume pendant 4 ans.
On le retrouve aussi au Conseil Économique, Social et Environnemental où il émet, en 2006, un avis percutant sur « ce qu’il reste de la coopération sanitaire française dans les pays en développement après les transferts budgétaires (du bilatéral au multilatéral) décidés par des politiques mondialistes ». Il sert aussi à la Halde (Haute Autorité pour la Lutte contre les Discriminations). Enfin, pendant 4 ans, à la Commission Consultative Nationale des Droits de l’Homme (CCNDH).
A 83 ans, rien n’a changé. Animé par les mêmes passions, il conseille encore quelques patients et s’attèle à une nouvelle édition enrichie, augmentée, modernisée de « Médecine Tropicale ». Le livre, publié aux éditions Lavoisier, vient de paraître…
Olivier Frégaville-Arcas, Journaliste
Information Hospitalière