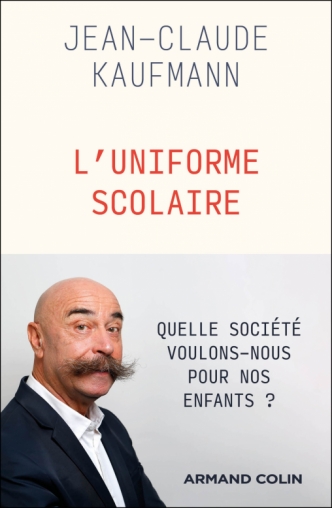Des écoliers français portant l’uniforme ? La question oppose deux camps : une droite réclamant l’ordre et la discipline ; une gauche rejetant ce symbole passéiste et liberticide. Mais un constat s’impose : ces débats multiplient idées…
Présentation du livre
Des écoliers français portant l’uniforme ? La question oppose deux camps : une droite réclamant l’ordre et la discipline ; une gauche rejetant ce symbole passéiste et liberticide. Mais un constat s’impose : ces débats multiplient idées reçues et contrevérités, au mépris de l’histoire de ce vêtement.
Car c’est à l’origine cette gauche, à présent hostile, qui a imaginé l’uniforme au sortir de la Révolution, pour répondre à un vaste projet : l’égalité sociale à l’école. Alors que la même idée sociale se concrétise aujourd’hui dans de nombreux pays d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique Latine, qu’en reste-t-il en France ?
Dans les plis et replis de cette histoire, le sociologue, observateur affûté des évolutions contemporaines, offre les outils pour comprendre. Derrière son aspect archaïque, ce vêtement anodin ne porterait-il pas une réponse paradoxale mais stimulante aux questions posées par notre modernité ? Un essai vivant et engagé qui renouvelle le débat.
Sommaire de l’ouvrage
Introduction
Première partie : De Robespierre à la jupe écossaise
- Ce que la gauche a oublié
- Que nous dit le Sud ?
- Le modèle anglais
Deuxième partie : Comprendre l’uniforme
- Flux et reflux
- Quelles leçons tirer des études ?
- Les dessous de l’uniforme
Troisième partie : Débats
- Comment se forment les débats
- Le corps des filles
- Péripéties françaises
- Une occasion ratée
Conclusion
Il faut le connaître pour comprendre l’évolution de notre monde
Auteur(s) de l’ouvrageJean-Claude Kaufmann est sociologue, directeur de recherche honoraire au CNRS. Il mène des enquêtes sur des aspects précis de notre vie quotidienne pour analyser les mutations anthropologiques actuelles et répondre aux grandes questions de notre époque. Ses livres sont traduits dans plus de 20 langues.
Jean-Claude Kaufmann est sociologue, spécialiste de la vie quotidienne, du rapport hommes-femmes et du processus identitaire. Auteur à succès, il a notamment commis un livre sur le corps des femmes à la plage, et un autre sur les crispations identitaires. Deux sujets qui se croisent dans l' »affaire » du burkini.
Jean-Claude Kaufmann analyse la façon dont les normes naissent et se structurent dans la vie sociale contemporaine. Alors que les sociétés anciennes étaient dominées par la reproduction des modèles de comportement hérités (le fils du paysan ou, au contraire, du noble agissait à la manière de son père), la société contemporaine (depuis les années 1960) semble marquée par la liberté des choix individuels et la diversité des comportements.
La sociologie de Kaufmann consiste à montrer que cette liberté n’est qu’apparente et que les espaces pacifiés où se manifeste cette diversité de comportements (comme la plage européenne où certaines femmes dénudent leur poitrine et d’autres non) sont néanmoins régis par des normes implicites (ainsi les hommes évitent de regarder de façon appuyée les femmes dénudées sur la plage, ce qui témoigne d’un important contrôle de soi, fruit de la socialisation et de ce que Norbert Elias a appelé la « civilisation des mœurs »).
Selon ses analyses, l’individu est porteur de modèles hérités de l’histoire personnelle (qui est aussi une histoire sociale), mais, malgré la force des habitudes intériorisées, il est aujourd’hui confronté à travers ses interactions avec autrui à d’autres modèles, multiples, divers et dans certains cas contradictoires entre eux : « ça ne va plus de soi », pourrait-on dire, et chacun doit s’engager dans une négociation plus ou moins approfondie avec autrui pour, par exemple, définir dans le couple quelle sera la répartition des tâches ménagères. Cela contraint l’individu contemporain à un travail réflexif sur soi qui débouche sur une définition, souvent instable, de son identité.
L’identité personnelle, loin d’être héritée, est dans cette perspective un « travail » itératif, un processus constant au cours duquel l’individu est amené à déterminer son image de soi par ces négociations souvent longues et risquées avec autrui.
Ce processus tend néanmoins à se stabiliser avec le temps et à transformer les effets de la négociation en habitudes (ce qui n’empêche pas que puisse survenir une rupture ultérieure), ce qui fait que les normes, au lieu de préexister aux comportements et de les guider a priori comme dans les sociétés anciennes, peuvent être vues aujourd’hui (un peu paradoxalement) comme le résultat plus ou moins maîtrisé des comportements.
Dans cette construction de l’identité personnelle, l’imaginaire occupe une place centrale puisque les normes et les comportements sont, pour une part, à construire sans devoir se référer à un modèle réel : c’est ainsi qu’étudiant la situation des femmes célibataires ou vivant seules en France (un phénomène récent et en augmentation), Jean-Claude Kaufmann met en évidence chez elles le rôle de la figure imaginaire du « Prince charmant », figure rêvée, idéalisée, enchantée, qui va, au gré des scénarios personnels, se métamorphoser en « petits princes », moins éclatants, moins brillants, à mi-chemin entre le rêve et la réalité, entre l’imaginaire et ses tentatives de concrétisation.
Entre le rêve et la réalité, les relations pourront être diverses — désillusion, angoisse notamment devant le temps qui passe, regrets éventuels, simple rêverie compensatoire, etc. —, mais la réalité sociale, loin de se réduire à des données objectives (selon notamment le principe ancien qui affirmait que « nécessité fait loi »), se construit également à partir de cet imaginaire irrépressible.
Méthodologie
La méthodologie de Jean-Claude Kaufmann repose essentiellement sur l’« entretien compréhensif ». Il s’agit donc d’interviews ou d’entretiens semi-directifs qui sont ensuite analysés et interprétés par le sociologue.
« Les propos recueillis dans les entretiens ne doivent être considérés ni comme la vérité à l’état pur, ni comme une déformation systématique de cette dernière. Ils sont complexes, souvent contradictoires, truffés de dissimulations et de mensonges. Mais ils sont aussi d’une extraordinaire richesse, permettant justement par leurs contradictions d’analyser le processus identitaire, donnant des pistes (les phrases récurrentes) pour repérer des processus sociaux sous-jacents[5]. »
On peut parler d’approche ethnographique dans le sens où les personnes interrogées sont considérées comme des informateurs permettant de comprendre les cadres de pensée de la société en cause (dans ce cas-ci, la société française contemporaine). Si cette démarche s’inspire de l’interactionnisme d’Erving Goffman qui, un des premiers, a étudié les interactions de la vie courante, elle s’en distingue cependant par une prise en compte de l’histoire personnelle (les individus disposant de ce point de vue de ressources différentes qu’ils peuvent mobiliser selon les circonstances auxquelles ils font face) mais aussi sociale (avec l’accent mis sur l’opposition entre les sociétés anciennes où les rôles sont en grande partie hérités, et les sociétés occidentales contemporaines, caractérisées par l’individualisme et la création sans cesse renouvelées des rôles).
Cette méthodologie, qui néglige pratiquement toute approche statistique, donne aux travaux de Jean-Claude Kaufmann un aspect essentiellement descriptif et interprétatif; en revanche, la dimension explicative (entre par exemple variables dépendantes et indépendantes) est peu présente. Ainsi, les normes de comportement, par exemple dans le couple en formation, résultent toujours des interactions dans ce couple sans qu’il soit possible de prévoir ni d’expliquer quelles seront les normes qui finiront par s’imposer : la répartition inégalitaire des tâches ménagères selon les genres (les femmes assumant aujourd’hui encore la plus grande partie de ces tâches) sera seulement constatée mais ne pourra pas être expliquée, sinon par la persistance des modèles traditionnels (mais c’est précisément cette persistance qui demanderait à être expliquée).