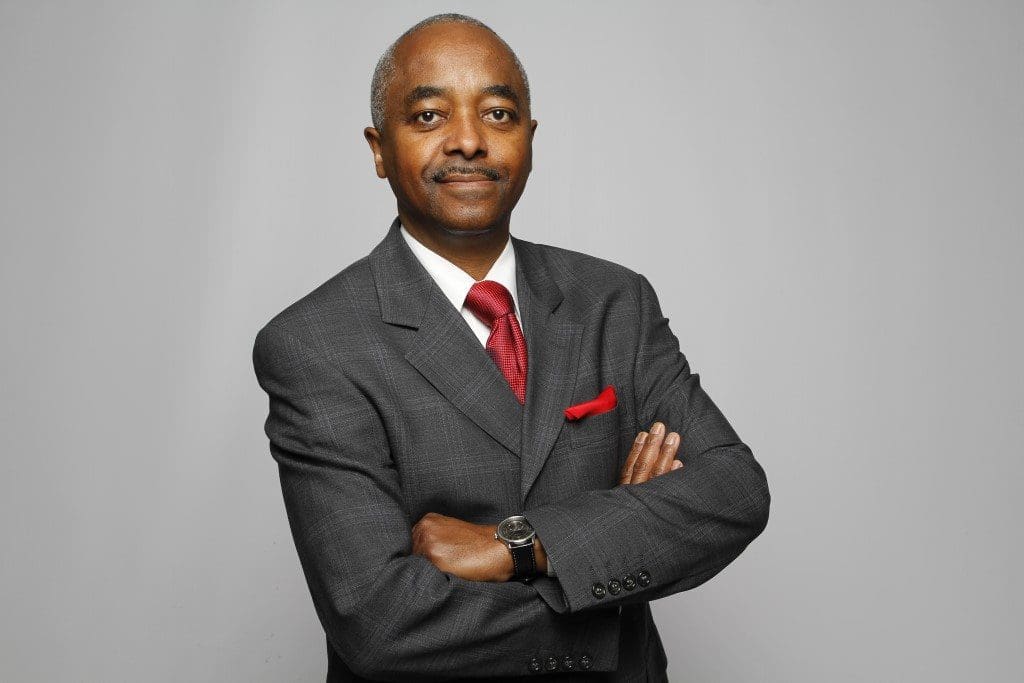J’ai le plaisir de vous partager un article érudit de mon ami le DR, je dirai le PR TAVARES.
J’ai rencontré le DR lors du 20 -ème anniversaire de Dekkal THIOSSANE de notre amie et sœur de l’UNSECO Paulette CORREA-Festival Racines Africaines et afro-descendantes à la Mairie du 15 -ème à Paris. Après son brillant exposé dans un panel érudit ( Doyen Doudou Diène et Le Dr Adama PAM), je me devais de le saluer et c’est ainsi que nous avons échangé sur notre discipline, lui étant hégelien et moi platonisant, disciple du Pr Djibril SAMB et Souleymane B DIAGNE UCAD.
Oui un texte puissant qui tente d’explorer la profondeur de la pensée de L. GBAGBO et recourant au stoïcisme. L’auteur nous avertit sur la lecture qui peut être âpre, parce que le travail s’appuie sur le stoïcisme qui nécessite un peu d’exercice ou de pratique. Mais, je nous fais confiance et suivons notre penseur discret. Je le dévoilerai au grand public et nous en avons besoin. P B CISSOKO
Erudition
« Pour l’être raisonnable, il n’y a d’intolérable que ce qui est contraire à la raison, mais ce qui est raisonnable peut être supporté. Les coups ne sont pas par nature intolérables »1.
Épictète, Entretiens.
Avertissement de l’auteur
La mise au jour d’une métaphysique cachée de Laurent Gbagbo est une âpre tâche, qui, pour être correctement comprise, réclame l’attention soutenue du lecteur, parce que, pour la première fois semble-t-il, est opéré une incursion philosophique dans la sphère de ses paroles et le domaine de sa pratique politique. Un jour nouveau les éclaire.
Au lecteur qui, de la philosophie, n’aurait qu’un vague aperçu, il est recommandé de ne point s’attarder aux notes nombreuses, longues et parfois difficiles de cette étude, sauf s’ils souhaitent s’initier à la philosophie stoïcienne ou approfondir sa connaissance du Stoïcisme sur les thèmes abordés.
Ainsi l’interprétation proposée, inédite, tente-t-elle de saisir certains axes essentiels, en les éclairant aux lampadaires d’une doctrine dont l’influence se poursuit jusqu’à notre époque. « Interpréter veut dire mettre en rapport »
- Il ne s’agit que d’expliquer une pensée originale. Et rien que cela.
Notre désir est d’exciter la curiosité et l’intérêt du lecteur pour un homme politique dont l’envergure intellectuelle est presque toujours négligée voire méconnue. Et lui-même n’aura pas entrepris de l’expliquer. Ainsi, les pensées profondes qu’il exprime sont-elles souvent voilées par la clarté même de ce qu’il dit. Il est grand temps de lever les velums qui les recouvrent.
Pour mener ce type de chantier, un vieil ami, l’éminent Jacques D’Hondt, demandait de « surveiller la lecture des philosophes ». Ici, c’est le dicible (les paroles) et l’éthique stoïcienne de Laurent Gbagbo qui sont mis sous surveillance, pour en retrouver les sources cachées dont ils sont souvent l’écho atténué.
1 Épictète, Comment on peut toujours sauvegarder sa dignité personnelle, Chapitre II, in Entretiens, Livres I à IV, Texte établi et traduit par Joseph Souilhé, avec la collaboration D’Amand Jagu, coll. Tel, Éditions Gallimard, Paris, Société d’édition Les belles Lettres, 1943 pour le livre I, 1949, pour le livre II, 1990, pour le livre III et 1991 pour le livre IV, p. 16. Il ajoute : « que l’être raisonnable n’est jamais plus opprimé que par ce qui est contraire à la raison et que, à l’inverse, rien n’a plus d’attirance pour lui que ce qui est raisonnable », Ibid.
2 Victor Goldschmidt, Le système stoïcien et l’idée de temps, quatrième édition revue et augmentée, coll. Librairie J. Vrin, Paris, 1979, p. 79.
2
Cet article crée et laboure un nouveau champ de recherches philosophiques, qui mettent en lumière les liens cachés et inédits de Laurent Gbagbo avec le Stoïcisme3, un courant philosophique qui prit son essor en Grèce avec Zénon de Kition ou Citium (334 av. J.-C. – 262) et atteindra son apogée à Rome, avec Chrysippe (-280 et -206), Cicéron (janvier 106 av. J.-C. – décembre 43 av. J.-C.), Épictète (50 – 130) et Marc-Aurèle, l’empereur-philosophe (avril 121 – mars 180).
Laurent Gbagbo en est, pour lors et jusqu’à plus ample informé, le seul et le plus grand représentant connu en Afrique noire. Sa vie et son action ne se laissent pas comprendre sans cette doctrine. Car il y a puisé la ligne directrice et les principaux éléments de son éthique personnelle ainsi qu’une partie de sa syntaxe.
Dans ce labour, pour les semailles et la moisson, la méditation questionnante est l’outil aratoire qui a porté à découvert ce que Laurent Gbagbo ne veut pas, ou ne peut pas, ou encore ne sait pas dire, parce qu’il le tient obscur dans la clarté même de sa parole.
- L’avocat et le musicien : qui dit vrai ?
Je me souviens d’un échange courtois et fort instructif, que j’eus, il n’y a pas si longtemps de cela, avec un avocat célèbre, dont le nom m’est en oubli, car, comme dit l’adage de prudence : on ne cite pas les contemporains. Il me fit alors la confidence suivante : « Dès l’arrivée de Laurent Gbagbo à [la prison de] La Haye, il lui a été proposé de reconnaître sa défaite électorale, pour être libéré au plus tôt. Il a refusé l’offre. C’est pour cela qu’il y est encore ».
L’homme de droit, par les belles manières de son éducation et son port, est peut-être concitoyen de Milord Stanhope4. Il exprime ses idées avec emphase et par le langage de bon usage. Plus récemment, un musicien de grande renommée a prétendu le contraire.
Ainsi, ou bien l’avocat anonyme dit vrai, ou bien Alpha Blondy a raison. La proposition libellée est « disjonctive »5 et rappelle le titre d’un ouvrage anti-hégélien de Kierkegaard6.
Bref, si la première proposition, celle de l’avocat, est vraie, la seconde proposition, celle du musicien, est nécessairement fausse. Nous recevrons, plus loin, quelques éléments de l’analyse grammaticale
3 Hegel : « Dans cette deuxième période, qui précède la philosophie alexandrine, nous avons à considérer le Dogmatisme et le Scepticisme : le Dogmatisme, qui se divise en deux philosophies, la philosophie stoïcienne et la philosophie épicurienne ; et le troisième terme qu’elles ont toutes deux en partage, et qui n’en est pas moins l’autre terme vis-à-vis d’elles, – le Scepticisme […]
Nous avons vu à la fin de la période précédente la conscience de l’idée ou de l’universel qui est intrinsèquement fin, – c’est la conscience d’un principe qui est universel tout en étant intrinsèquement déterminé, et qui de ce fait est susceptible de subsumer le particulier et d’y être appliqué. C’est ce rapport d’application de l’universel au particulier qui prédomine ici ; car l’idée de développer la particularisation de la totalité à partir de l’universel lui-même n’existe pas encore. Mais en un tel rapport réside le besoin de système et de systématisation ; on veut en effet qu’un principe unique soit appliqué de façon conséquente, en sorte que la vérité de tout particulier soit connue d’après ce principe. On a ainsi ce qu’il est convenu d’appeler le Dogmatisme. La question principale est à présent celle du critère », La philosophie stoïcienne, in Leçons sur la philosophie de l’histoire, Deuxième division, Deuxième période : le Dogmatisme et le Scepticisme, Les Néoplatoniciens, tome 4, La philosophie grecque, coll. Bibliothèque des textes philosophiques, Vrin, Paris, 1974, p. 633.
44 Milord Stanhope est le personnage anglais avec lequel Gabriel Bonnot de Mably a des entretiens dans son ouvrage, Des droits et des devoirs du citoyen, édition critique avec introduction et notes par Jean-Louis Lecercle, Librairie Marcel Didier, Publié avec le concours du CNRS, Paris, 1972, p. 3. Dans la note a, Jean-Louis Lecercle précise : « a. D’un bout à l’autre de M. Mably, chaque fois, a d’abord écrit : Hallifax (sic), il a biffé et écrit au-dessus : Stanope (sic) ; P. A : Stanhope », p. 3.
5 Émile Bréhier : « la proposition disjonctive […] signifie en effet que si l’une des propositions est vraie l’autre est fausse », Chapitre II, Théorie des « exprimables », in La Théorie des Incorporels dans l’ancien Stoïcisme, Thèse pour le Doctorat, Présentée à la Faculté des Lettres de Paris, Librairie Alphonse Picard et Fils, Paris, 1907, 1908, p. 29.
6 Kierkegaard, Ou bien… ou bien…, traduit du danois par F. et O. Prior, et M. H. Guignot, Introduction par de F. Brandt, coll. Tel, Éditions Gallimard, Paris, 1943.
3
stoïcienne, notamment avec la théorie des « exprimables »7, qui permettront de mieux comprendre l’orientation et l’intentionnalité de nos réflexions.
Pour lors, nous marchons, méditant ce qui, par lui-même, s’offre au regard et retentit encore, malgré ou à cause de cela : l’influence stoïcienne sur Laurent Gbagbo. La visée est inouïe, inédite et solitaire. Mais pas pour longtemps. Jusqu’à cela :
« Peut-être vais-je à travers de lourds monts, aux creux de dures veines, seul comme un minerai ; et si profond que je ne voie nul terme et nul lointain : tout ici n’est que proximité, et la proximité s’est faite pierre »8.
I.
Une prise de position stoïcienne incomprise
Or les propos de l’avocat sont indubitables. Ainsi Laurent Gbagbo n’aura pas donné son assentiment9 à cette enchère, non pas que l’offre fut en elle-même indécente. Mais il choisira, parmi d’autres, et telle est sa liberté, un préférable dont il assumera l’épreuve (car l’épreuve, pour un stoïcien, répond à l’occasion10) comme (soumission au) Destin11, qui est l’enchaînement nécessaire des événements (« manières d’être ») dictés par la Providence12, mais avec une très forte « certitude de soi » propre à tout agent moral stoïcien, et qui, parce qu’il sait distinguer13 le but (skopos, σϰόπος) de la fin (« fin suprême », télos, πέλος)14, accordera toujours son entière (con) fiance au temps (intervalles, temps physique et temps vécu), au nom de la droite raison et de la dignité personnelle, et ce dans une quête incessante et rationnelle du vrai, pour le surgissement de la vérité.
7 E. Bréhier, Chapitre II, L’incorporel dans la logique et la théorie des « exprimables », in op. cit., pages 14 à 36.
8 Rainer Maria Rilke, Le livre de la mort et de la pauvreté (1903), OEuvres poétiques et théâtrales, Édition publiée sous la direction de Gérald Stieg, avec la participation de Claude David pour les « oeuvres théâtrales », Traductions par Rémy Colombat, Jean-Claude Crespy, Dominique Iehl, Rémy Lambrechts, Marc de Launay, Jean-Pierre Lefebvre, Jacques Legrand, Marc Petit et Maurice Regnault, coll. Bibliothèque de la Pléiade, Éditions Gallimard, Paris, 1997, p. 339. Il existe maintes traductions de ce poème. Celle du site Arbrealettres est intéressante : « Peut-être qu’à travers d’âpres montagnes je circule en veines dures, seul ainsi qu’un minerai, et si profondément que je ne vois ni fin ni distance : tout est là, proche. Et tout ce qui est proche s’est fait pierre ».
9 V. Goldschmidt citant Aëtius : « pour les Stoïciens, toute sensation est assentiment et compréhension », op. cit., p. 23.
10 V. Goldschmidt, op. cit., p. 124.
11 V. Goldschmidt : « La loi du destin, semble-t-il, proclame, les uns après les autres, les événements comme les articles d’un code. Entraînant par contrainte comme les lois physiques, ces dispositions se laissent suivre comme des normes librement acceptées ; de ce double aspect et de cet accord, résulte la “conduite” morale », op. cit., pages 101 à 102.
12 Dans le Stoïcisme, Destin et Providence sont identifiés comme identiques, V. Goldschmidt, p. 79 et p. 91.
13 Sur la différence entre les deux notions, lire V. Goldschmidt, op. cit., pages 149 à 150.
14 Sur cette distinction conceptuelle capitale, lire V. Goldschmidt, Le présent, in op. cit., pages 168 à 169. Pour les stoïciens, d’une manière générale, le but, qui est une « visée », est conditionnée par le temps (l’intervalle entre le projet et sa réalisation, entre l’intention et son effectuation), tandis que la fin est immédiatement saisie en sa totalité dans l’instant opportun (« kairos ») par l’agent moral dans son acte ou son action. Ainsi, en est-il du bonheur dont « le but » est une vaine course après le temps illusoire (passé et futur), mais dont « la fin » saisit le présent dans son instant éternel. Le bonheur stoïcien ne s’étend pas en durée. Le « but » est dans le temps, la « fin » dans l’instant. René Char exprime autrement cette idée lorsqu’il affirme qu’on obtient la durée qu’en détruisant le temps. V. Goldschmidt : « Le bonheur du sage est saisi dans l’instant et dans un instant temporel et limité, par où il semble privé de toute apparence de bonheur. Il ne se manifeste pas par une vie longue et heureuse, étalée aux regards de tous ; il ne s’exprime pas dans les extases hors du temps, dans des ravissements dramatiques et solennels dont des élèves respectueux, comme chez Plotin, puissent dénombrer les rares productions. Il est partout et toujours, et cependant nul signe extérieur ne le manifeste », Le système stoïcien et l’idée du temps, quatrième édition revue et augmentée, Vrin, Paris, 1979, p. 215.
4
C’est l’attitude dont Épictète fait la recommandation et la décrit ainsi : « porter la tête haute en face des événements, comme un homme libre, et d’élever [son] regard vers le ciel, comme un ami de Dieu, sans aucune crainte de ce qui peut arriver »15 et dont Médée est l’antithèse16.
Pourquoi Laurent Gbagbo ne fuit-il donc jamais ? Qu’est-ce qui, ainsi, le porte, au point de l’amener à toujours répondre « présent » ?
Plus d’un l’oublie ou ne le sait pas, le Stoïcisme (des origines et de l’époque impériale) pose une exigence morale fondamentale qui doit servir de guide aux stoïciens tout le long de leur vie. Il leur est impérativement demandé de « se complaire à ce qui arrive »17 et de « supporter » cela comme une épreuve18, parce qu’ils ont chacun le devoir de « se satisfaire de la condition présente et [de] se réjouir de tout ce qui arrive présentement »19. Il leur faut, de la sorte, toujours « vouloir les événements comme ils se produisent »20. Même l’épreuve définitive : la mort.
Or la mise en oeuvre de ces recommandations éthiques n’est effective que dans et par l’intervalle21, et même plus exactement, par le présent réel, dans lequel le présent absolu, total, est posé par l’acte de l’agent moral : parce que, dans cette doctrine, « l’acte dérive toute sa réalité de l’être de l’agent »22.
Ainsi, pour tout stoïcien, « La liberté […] se porte au-devant de ce qui menaçait de le contraindre, et c’est en cela que consiste la coopération avec le destin »23. Si le stoïcien ne cherche pas de manière obstinée, c’est-à-dire coûte que coûte, l’épreuve, il l’accepte cependant en sa totalité lorsqu’elle se présente à lui. Il en fait un ou le présent même. C’est là l’exercice de son libre arbitre, sa « conscience de soi »24, cela même qui est sa liberté. Il ne tourne donc pas le dos aux événements et ne s’échappe
15 Épictète, Chapitre XVII, Comment il faut adapter les prénotions aux cas particuliers, in Entretiens, Livres I à IV, Texte établi et traduit par Joseph Souilhé, avec la collaboration D’Amand Jagu, coll. Tel, Éditions Gallimard, Paris, Société d’édition Les belles Lettres, 1943 pour le livre I, 1949, pour le livre II, 1990, pour le livre III et 1991 pour le livre IV, p. 149.
16 Épictète : « Je tue mes enfants, mais je me punirai moi-même. Et que m’importe ? ». C’est l’explosion d’une âme forte. Elle ignorait, en effet, où réside le pouvoir de faire ce que nous voulons, elle ignorait qu’il ne pas chercher à l’extérieur, ni par des substitutions ou des transformations d’objets. Ne désire pas cet homme [Jason, in Médée], et il n’est rien de ce que tu désires qui ne se réalise. Ne désire pas à tout prix qu’il vive avec toi, ne désire pas vivre à Corinthe ; en un mot, ne désire rien de plus que ce que Dieu désire. Et qui te fera obstacle, qui te contraindra. Pas plus qu’on ne le peut pour Zeus ! », Ibid. Sur Jason, in Médée, Euripide, Tragédies complètes I, folio classique, Gallimard, paris, 1962, p. 135 à 198. V. Goldschmidt : « se complaire à ce qui arrive », op. cit., p. 69 : « la loi du destin n’est pas entièrement impersonnelle, puisqu’elle est la loi de Zeus et que nous devons “coopérer” à son accomplissement », Ibid.
17 V. Goldschmidt, op. cit., 69.
18 Epictète : « Ce sont les difficultés qui révèlent les hommes. Aussi, quand survient une difficulté, souviens-toi que Dieu, comme maître de gymnase, t’a mis aux prises avec un jeune et rude partenaire. — À quelle fin demanda-t-il ? — Pour que tu deviennes champion aux jeux olympiques ; et on ne devient pas suer », Comment il faut combattre les difficultés, Livre I, Chapitre XXIV, in Entretiens, Lives I à IV, p. 72. V. Goldschmidt : « L’usage des représentations déjà répondait à l’événement subi par la libre coopération ; Mais celle-ci tend maintenant vers l’action proprement dite ; l’idée d’usage entraîne celle d’épreuve. Dans son traité Sur la Providence, Sénèque transforme toutes les contre-instances en arguments en faveur de la providence : calamitas uirtutis occasio est. L’interprète, ici, se fait acteur. Mais c’est toujours dans le même présent temporel où l’usage s’adapte à la représentation, que l’épreuve répond à l’occasion », op. cit., p. 124.
19 V. Goldschmidt, op. cit., p. 73.
20 V. Goldschmidt, op. cit., p. 79.
21 V. Goldschmidt : « Or, de même qu’à l’ensemble de la matière, nous ne participons que pour une très petite part, de même de l’ensemble de la durée, “un intervalle très bref et infinitésimal nous a été assigné”. De cet intervalle, seul est réel le présent, car “voici, tout proche, l’abîme infini du passé et du futur où tout s’évanouit”. La réalité unique du présent, enseignée dans la théorie physique du temps, est donc affirmée également à l’égard de la vie humaine et, en matière de morale, se traduit directement par des préceptes tels que : “User du présent”, […], préceptes qui contiennent comme le sommaire de l’ars vitae, etc., op. cit., p. 73 ; “Seul, le présent existe” ou, pourrait-on dire, le seul temps existant, c’est le présent », op. cit., p. 43.
22 V. Goldschmidt, op. cit., p. 62.
23 V. Goldschmidt, op. cit., p. 109.
24 Hegel : « Dans toutes les nombreuses écoles socratiques qui se développent, deux déterminations constituent l’intérêt principal ; la première est le critère, principe à partir duquel tout doit être déterminé, tout pourrait être jugé, — principe universel pour soi, principe qui serait en même temps l’élément déterminant pour le particulier […]
5
pas du présent réel, l’instant, l’épreuve ou le bonheur, le hic et nunc (« ici et maintenant »), en se réfugiant ou en fuyant vers les deux autres horizons du temps ordinaire, « le passé » et « le futur », mais, tout au contraire, il les ramène et les condense dans l’instant du présent.
Rétrocédons le pas. Au vrai, si Laurent Gbagbo avait accordé son assentiment à l’enchère, il eut clos, fermé, et non pas ouvert la séquence essentielle, axiale et décisive dans laquelle se concentre tout le Stoïcisme et qui consiste, en définitive, en un commandement : « coopérer avec le destin »25.
Ainsi, en délivrant son assentiment, que fit-il sinon retourner ipso facto le sens même et la portée des événements (politico-judiciaires) pour devenir, à cet instant-là, et par un « acte pur »26, « cause parfaite » ou « cause active »27 des stoïciens. Il s’attribue ainsi l’événement.
II.
Alors, qu’est-ce que donc la « cause parfaite » ?
« Revenons donc à l’événement singulier. Étant causé par Dieu, il a ceci de propre de ne l’être à aucun degré par nous ; par définition il fait partie des “choses qui ne dépendent pas de nous”. Or la cause n’est cause parfaite que pour ce qui dépend d’elle. Comment alors “coopérer” à ce qui, précisément, est soustrait à notre pouvoir et, pour se produire, n’a besoin que de Dieu ? — Mais poser la question ainsi, c’est méconnaître que la cause parfaite abolit toute distance entre l’intention et l’acte, entre elle-même et son effet. Sur ce qui ne dépend pas de nous, la causalité brute nous est certes refusée. Mais nous pouvons, à son égard, devenir causes parfaites et nous en attribuer l’avènement, si, lorsqu’il se produit, nous faisons tout ce qui dépend de nous, pour qu’il se produise, lui qui, de toute manière, se produit. Il suffira pour cela de réduire la distance. Et puisque nous ne pouvons pas, comme Dieu, aller, dans le même instant, de l’intention à l’acte, puisque l’acte nous est donné d’abord, il suffira, dans ce même instant, de suivre la démarche inverse et de faire coïncider l’acte (qui ne dépend pas de nous) avec l’intention (qui en dépend pleinement). Il faut donc “accepter” l’événement et le vouloir. Or, le vouloir, c’est-à-dire le causer pour ce qui dépend de nous, cela signifie ne pas le contrarier, ne pas
Une autre conséquence de ce philosopher, c’est le caractère subjectif du principe, en tant que formel ; il a pris ainsi la signification essentielle de la subjectivité de la conscience de soi. La réception de la diversité en général s’effectuant de façon formelle, extérieure, le point élevé où l’on trouvera la pensée dans son mode le plus déterminé sera la conscience de soi […]
La deuxième détermination dominante est celle du sage. La question principale était : qui est un sage ? Que fait le sage ? Ce n’est pas seulement le νοũς, c’est toute chose qui doit être du pensé, c’est-à-dire, en tant que subjective, être ma pensée. Par quelle voie est-elle quelque chose de pensé ? — Dans la figure de l’identité formelle à soi. — Qu’est-ce qui en soi un tel pensé, c’est-à-dire est lui-même ainsi objectif ? — Le penser. Le penser du critère, de l’unique principe, en tant qu’il est dans sa réalité effective immédiate est le sujet lui-même ; le penser et le pensant sont en connexion immédiate. Le principe de cette philosophie n’est pas objectif, mais dogmatique, il repose sur l’impulsion de la conscience de soi à se satisfaire. Le sujet est donc ce dont il faut se soucier. Le sujet est à la recherche d’un principe pour sa liberté, pour son inébranlabilité intérieure, il doit être conforme au critère, c’est-à-dire à ce principe tout à fait universel — Il doit s’élever à cette liberté abstraite, à cette indépendance. La conscience de soi vit dans la solitude de son penser ; elle trouve en cela sa satisfaction. Telles sont les déterminations fondamentales des philosophies qui vont suivre », La philosophie stoïcienne, in Leçons sur la philosophie de l’histoire, Deuxième division, Deuxième période : le Dogmatisme et le Scepticisme, Les Néoplatoniciens, tome 4, La philosophie grecque, coll. Bibliothèque des textes philosophiques, Vrin, Paris, 1974, pages 634 à 635.
25 V. Goldschmidt : « La solution jusqu’ici esquissée garde un équilibre parfait entre la volonté du destin et la volonté humaine. L’événement est reçu dans notre intériorité, mais, à l’inverse, la personne morale s’ouvre à l’action du destin et se met en quelque sorte à sa disposition », op. cit., p. 101 Lire les pages 99 à 101. C’est cela « coopérer avec l’événement », op. cit., p. 104 ou coopérer avec le destin, op. cit., pages 109 à 110.
26 Bréhier expose ce qu’est « l’acte pur », « l’être rationnel », dans la controverse entre Platon et les stoïciens, op. cit., pages 60 à 61.
27 E. Bréhier, op. cit., p. 4. L’auteur précise : « Les seuls êtres véritables que reconnaissent les stoïciens, c’est la cause active » (τὸ ποιοῦν), puis l’être sur lequel agit cette cause » (τὸ πάσχον), op. cit., p. 10.
6
l’empêcher, et cela, non pas par une action (car il ne dépend pas de nous de nous y opposer efficacement), mais, précisément, par nos intentions. Coopérer à l’événement consistera donc à l’opérer en nous, à combattre tout ce qui, en nous, s’oppose à lui, nos passions et nos préférences. En vertu de la contemporanéité de l’intention et de l’acte, c’est dans le même instant que notre volonté rattrape et recouvre l’événement et que le mouvement le plus secret de notre “personne morale” coopère avec le cours, extérieur à nous, du Destin. “L’univers est comme mutilé, si peu qu’on retranche à la connexion et l’enchaînement des causes, non moins que de ses parties. Or tu romps cet enchaînement, autant qu’il dépend de toi, quand tu es mécontent des événements et, en un sens, tu les détruis”28.
À titre comparatif, un autre procès, dans la même période et tout aussi retentissant, celui de Hissène Habré29, s’est constitué sur son refus frontal et son rejet catégorique d’accorder tout assentiment. Il a récusé le présent. Certes, comparaison n’est pas raison. Cependant, l’adage oublie de dire qu’il n’y a pas de raison sans comparaison.
En tous les cas, ces deux procès sont et valent encore comme deux contre-modèles absolus. Et chacun peut s’en convaincre, en regardant les enregistrements vidéos qui dévoilent les attitudes opposées des deux inculpés : la sérénité “ataraxique” et la confiance du premier, Laurent Gbagbo, contrastant avec l’agitation et le désarroi du second, Hissène Habré. Au fond, le Stoïcisme aura été et reste encore leur ligne de démarcation. L’un choisira de s’ouvrir au destin, par l’optatif30, l’autre, d’en murer l’accès, par l’inconstance, la rage et le déni.
L’acceptation ou le rejet des charges du Destin rend celle-ci ou bien tolérable ou bien insupportable. L’épitaphe, tirée d’Épictète, et placée au début de notre méditation, ne dit pas autre chose.
Bref, assentiment, agent moral, préférable, épreuve, devoir, Destin, Providence, événement, but et fin, coopération, temps, dignité personnelle, vrai, vérité, cause parfaite, sont autant de notions qui appartiennent au lexique du Stoïcisme.
Il n’est pas étonnant que tous les fameux espécialistes de l’africanisme n’aient pas vu l’appartenance à l’école stoïcienne de celui qu’ils accablaient alors avec tant de véhémence. C’est que ne sachant quasiment rien du Stoïcisme, ils furent loin d’imaginer ou même de soupçonner l’influence qu’elle exerçait sur “leur” prisonnier. Dans leur aveuglement, ils n’y auront vu qu’entêtement. Par suite, comme frappés de cécité involontaire, ils ne purent jamais voir les idées stoïciennes autour desquelles
28 V. Goldschmidt, op. cit., pages 100 à 101.
29 Le Monde Afrique, Hissène Habré refuse de comparaître à la reprise de son procès à Dakar, 07 septembre 2015. Reed Brody, Le procès de Hissène Habré : un tournant pour la justice internationale, Les cahiers de la justice, 2002/2, N° 2, pages 297 à 310, Cairn, Info, Droit et Administration. Les dates marquantes du procès : 19 septembre 2005, la justice belge lance un mandat d’arrêt international. Première arrestation, le 15 novembre 2005, par les Autorités sénégalaises. Juillet 2006, le Sénégal reçoit mandat pour juger l’accusé. Garde à vue, le 30 juin 2013. Début du procès, le 20 juillet 2015. Hissène Habré reconnu coupable le 30 mai 2016 de crimes contre l’humanité, viols, esclavage et enlèvements. Il est condamné à perpétuité et fait Appel. Un nouveau procès, le 9 janvier 2017 et le 27 avril 2017, la condamnation est reconfirmée.
30 CNRTL : « Gramm. Le mode optatif ou, subst., l’optatif, mode qui, dans certaines langues telles que le sanscrit et le grec ancien, sert, dans une proposition indépendante, à exprimer la possibilité et le souhait, et dont le thème est parfois distinct de ceux de l’indicatif et du subjonctif. En français, l’optatif est remplacé par le subjonctif, comme dans la phrase : “Que la volonté de Dieu soit faite !” Optatif oblique, en grec ancien, forme qui, dans une proposition complétive dépendant d’un verbe principal au passé, peut remplacer le subjonctif normalement attendu ». Il ne doit pas être confondu avec le désidératif.
7
s’articulent la biographie de Laurent Gbagbo, en tant qu’homme public ou comme personne privée ; idées qui se révèleront pourtant au grand jour lors de sa captivité, puis durant son procès et, plus encore, après sa libération.
Chacun comprendra donc que si notre propos est “indulgent pour les sots ou pour ce qu’on appelle la lie du peuple [… en revanche, il est] sévère pour les gens qui pensent et qui doivent penser”31. Faut-il les inviter à s’épargner cette lecture qui, à bien des égards, leur pourrait paraître fastidieuse ?
Car des stoïciens, ils ne savent presque rien de leurs catégories32, de leur conception générale des corps33 et des incorporels34, moins encore de ce qu’est la représentation en son “usage” et sa “théorie”. Par consécution, comment auraient-ils pu y déceler leur méthode du passage35, leurs raisonnements composés appelés “sorites”36 dont Laurent Gbagbo est pourtant si coutumier et qui
31 Gabriel Bonnot de Mably : « mais si je suis indulgent pour les sots ou pour ce qu’on appelle la lie du peuple, je suis sévère pour les gens qui pensent et qui doivent penser : voilà mon dernier mot », Des droits et des devoirs du citoyen, édition critique avec introduction et notes par Jean-Louis Leclercle, Librairie Marcel Didier, Publié avec le concours du CNRS, Paris, 1972, p. 55.
32 Les principales catégories sont le genre suprême (une simple pensée) et le quelque chose (corps et incorporels), la substance (ce qui est, l’être concret), la qualité (essence de ce qui est), la manière d’être (rapport de l’individu à soi) et la manière d’être relative (rapport de l’individu à ce qui l’entoure : événements, être en situation). Les catégories peuvent être évoquées et utilisées sans ordre et une hiérarchie préétablie. Avec les stoïciens, les dix catégories aristotéliciennes changent de statut et de fonction. Selon E. Bréhier : « Les catégories d’Aristote se divisent nettement en deux groupes. Le premier constitué par la première seule, la substance, et le second par les neuf autres qui sont les divers accidents de la substance. C’est le principe de ce groupement qui est changé par les stoïciens. Le terme général qui désigne ce que l’on peut ranger sous les catégories n’est plus, comme chez Aristote, ὸν (ce mot est réservé au réel, au corps), mais τί. Ce τί désigne à la fois les corps et les incorporels. Tels sont les deux groupes de catégories. Le premier comprend les sujets et les qualités (ύποϰείμενα, ποιά) qui sont des corps ; le second les modes [manières d’être) et les modes relatifs [manières d’être relatifs] (πῶς ἔχοντα, προς τί πος ἔχοντα) qui sont les incorporels. Cette distinction ne correspond plus à celle en substance et accidents, puisque parmi les accidents, les uns, comme les qualités ont été placées dans les réalité substantielles (l’avoir est également devenu une qualité), tandis que les autres sont classés parmi les incorporels. Ce qui intéresse les stoïciens dans ce groupement est de distinguer ce qui agit et ce qui pâtit, d’une part, et, d’autre part, ce qui n’agit ni ne pâtit : c’est un problème physique. Aristote, au contraire, se pose le problème de la classification des attributs, problème beaucoup plus logique que physique », op. cit., pages 42 à 43.
- Goldschmidt : « Le genre suprême, le τί, est une simple pensée, à laquelle manque l’être. Lors de sa division en σώματα et άσώματα, il semble, ici, prendre corps, là, demeurer une pensée. Au moins les incorporels, supposé qu’ils soient affectés d’une même absence d’être, ne se confondent-ils pas en tant que pensées ; ils n’ont pas le même contenu, ils n’ont pas, en termes platoniciens, la même essence (cette essence que les stoïciens admettent, à titre d’έννόμα, au rang de quasi existence) […] On verra plus loin que toute “pensée” peut au contact du sensible se “réaliser”. Et, d’autre part, l’analyse des catégories nous a montré dès à présent ce mouvement d’incorporation : prises en soi, les manières d’être manquent de toute réalité corporelle ; rattachées à l’agent et replacées dans le courant qui émane de sa réalité profonde, elles prennent corps et deviennent des corps », op. cit., 25.
33 E. Bréhier : « Tout ce qui existe est corps » ; « l’affirmation que tout est corps veut dire seulement que la cause telle que nous venons de la définir est un corps, et que ce qui subit l’action de cette cause (τὸ πὰσχον) est aussi un corps ; ce n’est nullement le refus de reconnaître qu’il y ait dans l’univers un principe spontané d’activité », op. cit., p. 6.
34 Émile Bréhier : « Ce mot [l’incorporel] désigne chez les stoïciens, d’après Sextus, les choses suivantes : l’“exprimable” (λεϰτóν) [le dicible], le vide, le lieu, le temps. Le mot même d’incorporel avait été peu employé dans les doctrines précédentes », La Théorie des Incorporels dans l’ancien Stoïcisme, Thèse pour le Doctorat, Présentée à la Faculté des Lettres de Paris, Librairie Alphonse Picard et Fils, Paris, 1907, 1908, p. 1. Les incorporels sont des êtres dotés d’une moindre existence, mais sans être dans le non-être. Ils sont appelés subsistants, à la différence de tous les autres êtres qui sont dits existants. V. Goldschmidt : « Le mot que, à la suite d’E. Bréhier, nous traduisons par “subsister”, sert couramment dans les textes à désigner le mode d’existence des incorporels », op. cit., p. 43.
« Les stoïciens disent que le vide est ce qui est capable d’être occupé par un être sans, de fait, être occupé ; ou l’intervalle vide de corps ou encore l’intervalle non-occupé par un corps ; que le lieu est l’intervalle occupé par un être et rendu égal à l’être qu’il occupe ; or ils appellent être, le corps », Sextus cité par V. Goldschmidt, op. cit., p. 26.
35 V. Goldschmidt, sur l’idée de « passage », op. cit., pages 55 à 58, p. 67, pages 71 à 72.
36 V. Goldschmidt : « D’après E. Bréhier, il conviendrait d’expliquer “ces longs raisonnements composés, improprement appelés sorites” par les besoins de la discussion dialectique, plutôt que par un “prétendu principe de continuité” (Chrysippe, 79). Ce procédé dialectique qui consiste à “inventer de nouveaux intermédiaires, toujours plus inattendus, comme pour mieux cacher la conclusion” (ibid., n. 2) et que pratiquent déjà très consciemment les Dialogues de Platon, était sans doute couramment appliqué dans l’École. Il semble cependant que les usages de la discussion ne soient pas suffisants pour expliquer la faveur que les stoïciens témoignent à ce procédé. Ces raisonnements composés sont fréquents dans des exposés doctrinaux, destitués de toute intention “dialectique”, et qui reposent visiblement sur le “principe de continuité”. — Cette explication semble d’ailleurs plus conforme à l’exégèse générale qu’E. Bréhier a donnée du stoïcisme, puisque nul mieux que lui n’a fait voir l’étroite solidarité qui unit les trois parties du système. Le raisonnement composé reproduit souvent un mouvement de continuité du réel, soit en physique, soit en morale. C’est d’ailleurs ce que Bréhier a vu tout le premier, en écrivant, par exemple, au sujet de la solidarité des vertus : “les qualités du sage s’impliquent réciproquement, et on peut en partant de l’une quelconque d’entre elles, en déduire toutes les autres par un jugement composé ; il n’en
8
renvoient toutes à la doctrine de l’homogénéité du réel reposant sur une ontologie où l’être même est défini comme ce “quelque chose” et dont la théorie de la connaissance fait débuter le savoir par la sensation37, cet effet imprimé par les objets et les événements sur l’âme, et qui, de façon spontanée, crée l’image compréhensive aussitôt transformée et acceptée comme représentation (représentation compréhensive) devenant, de fait, la base solide et infaillible de l’analyse systématique et rationnelle de l’être38. Par suite, ils ne pouvaient non plus saisir dans le langage de Laurent Gbagbo aux railleries voilées, notamment celles sur la danse, et dans ses idées sous-jacentes de la proportion39 sans cesse évoquées en macro-économie et qui, l’un et l’autre, langage et proportion, renvoient à cette école de pensée.
III.
Bref échange avec un nouchi40 :
–
Vié père, dans djaprapanpali41 de Gbagbo, y’a tout ça-là dedans ?
–
Oui, c’est cela. Interpréter, c’est conhan42 : dé-couvrir. J’ai dékrou43.
–
Stoïïïzien… quoi ? Ti connin [tu connais] affaire là. Tu es un bian44 dèh.
–
Vié père, ce que tu tcharo, c’est pas taba taba45 ? Est-ce que ton atalaku46, c’est pas materazzi47 ?
–
Non, croyez-vous donc ? Je ne cède jamais à la flatterie.
–
Hoouuunn, Babo est cracra48. Noooon, y’a Dieu dedans ».
Nombreux sont convaincus que Dieu protège constamment Laurent Gbagbo. Est-ce « le Dieu stoïcien [qui] n’est ni transcendant, ni immatériel ; [et qui] s’il peut être dit éternel, c’est en ce sens (et à la condition) que son activité se manifeste et se renouvelle dans l’étendue temporelle des périodes cosmiques »49 et ce jusqu’à la biographie de leur leader.
est pas entre lesquelles on ne puisse établir de continuité par la découverte des qualités intermédiaires” (Chrysippe, p. 218) », op. cit., p. 24 note 3 et p. 58.
37 V. Goldschmidt : « Selon les stoïciens, on appelle sensation le souffle venant de la partie hégémonique » [de l’âme] ; mais dans cette activité perceptive, l’âme n’est pas créatrice ; elle ne fait que consentir à une représentation qu’imprime en elle le réel. Aussi n’est-ce pas directement la sensation, qui limite l’étendue du présent, mais bien un acte réel, saisi (ou saisissable) par la sensation », op. cit., 40. E. Bréhier : « Parmi ces êtres actifs se trouvent les qualités des corps ; ce sont des souffles (πνεύματα [pneumata]) dont l’action se montre par leurs effets », op. cit., p. 11 : « Ce qui fait l’unité de chaque corps, c’est le “souffle” de la raison séminale qui en retient les parties », op. cit., p. 42.
38 V. Goldschmidt : « Le savoir prendra donc son origine dans la représentation, qui est infaillible, parce qu’en elle, c’est l’objet seul qui agit sur l’âme », op. cit., p. 60 ; tout comme « la physique, qui nous enseignera l’ensemble de la vie cosmique et nous fera connaître les dieux, pourtant invisibles, prend son départ dans la réalité la plus immédiate et la plus facile à connaître, les corps », op. cit., p. 57.
39 V. Goldschmidt, op. cit., p. 209 ; « À ce niveau [celui de l’assentiment] de la représentation, l’infaillibilité de la connaissance est entièrement assurée, et cela, grâce à l’action de l’objet dont la réalité pénètre et éclaire l’âme ; le sujet se borne à consentir et à adhérer », op. cit, p. 114.
40 Le Nouchi est un créole ivoirien inventé par le lumpenprolétariat des grandes villes ivoiriennes. Cette langue (système de signes linguistiques) dispose d’une syntaxe à dominante africaine, d’un lexique où se mêlent des mots africains et indo-européens (français, anglais, portugais, des mots arabes, etc.) et d’une phonologie particulière (déformation des syllabes qui altère voire dissimule la signification de la phrase). Un nouchi est un individu qui s’exprime selon ces règles.
41 Nouchi : le « djaprapanpali » est le « discours prononcé par un individu ».
42 Nouchi : « conhan » veut dire « comme cela », ou « ainsi ».
43 Nouchi : « dékrou » signifie « dévoiler », mettre au jour », etc. Il sonne comme dé-clou, enlever un clou qui enferme quelque chose.
44 Nouchi : « bian » signifie tantôt « sachant », parfois « expert », plus généralement « connaisseur » ou « spécialiste ».
45 Nouchi : « ce que tu tcharo, c’est pas taba taba ? » : « ce que tu dis, est-ce des fadaises ? »
46 Nouchi : « atalaku » est « faire l’éloge d’une personne »
47 Nouchi : « materazzi » signifie « provocation ».
48 Nouchi : « cracra » se dit d’une « personne qui ne baisse pas les bras face aux difficultés ».
49 V. Goldschmidt, op. cit., p. 176.
9
Non pas que Laurent Gbagbo ne soit qu’un stoïcien, mais il est impossible de le comprendre sans les renvois à cette doctrine. Cela, les nouchis, quand on leur explique les grandes lignes de cette pensée, le comprennent assez facilement.
Cependant, que tous les espécialistes n’aient rien perçu de ce qui précède reste encore acceptable. Ce qui, toutefois, l’est beaucoup moins, c’est l’incapacité cognitive des philosophes qui n’y ont pas reconnu les idées, les traits et les caractéristiques du Stoïcisme. Car les indications n’ont pas manqué. Il suffisait d’écouter ou de lire, pour les prendre en vue. Par exemple, dans la manière d’être relative de Laurent Gbagbo à son procès, autrement dit lorsqu’il était en situation50 devant ses juges, comment n’ont-ils pas pu s’apercevoir qu’il ne s’agissait nullement de témérité ou de courage (si habilement distingués par Hannah Arendt), mais plutôt de la ligne générale d’une tranquillité d’esprit que les stoïciens appellent l’ataraxie comme expression directe d’une liberté intérieure propre à leur morale publique et qu’il réitèrera en maintes occasions dont l’une en termes clairs : « Mes convictions ne sont pas négociables. Tant pis, si j’en paie le prix ». Qu’est-ce donc cela, sinon l’idée stoïcienne selon laquelle les « circonstances », en dépit de leur importance, de leur gravité et même de leur nécessité, ne sauraient fixer ni déterminer l’éthique, quand bien même la pratique obligerait à la casuistique (choix parmi) des préférables ? Dès lors, qu’importe le niveau du « prix » à payer pour un stoïcien par l’agent moral, pourvu que « le devoir », comme liberté ou destin, soit assumé pour être accompli.
IV.
Des trois Juges
Introduisons un court intervalle. Nous inclinons à penser que, lors du procès, le stoïcisme de Laurent Gbagbo a été comme pressenti par le juge Cuno Jakob Tarfusser, juge président, formé à l’université de Padoue, l’une des plus anciennes du monde (29 septembre 1222) où la liberté universelle et pour tous est la devise51, mais où aussi la philosophie est une discipline de belle réputation, une université dans laquelle est née la très célèbre École de Padoue qui professait « la philosophie de la nature » (monde humain, monde astral) et un « système cosmologique », deux branches du savoir qui ne sont pas sans rappeler le Stoïcisme où elles occupent une place centrale.
Le deuxième juge, Geoffrey Henderson, originaire de Trinidad-et-Tobago, ne semble pas éloigné de la philosophie, notamment des plus hauts concepts de la philosophie, la Liberté52, ni non plus des faits (réalité empirique) vers lesquels son diplôme de Baccalauréat en sociologie l’a sans doute préparé. Il sait ce qu’est l’évidence des faits53, le « ce-qui-se-voit » de lui-même, le « cela » qui tombe sous le coup du regard. Sa décision finale d’acquittement n’a reposé que sur les faits54 et par une
50 V. Goldschmidt : « Ainsi, le fait d’agir est une manière d’être, n’est pas une qualité essentielle du corps qui agit ; comparé avec la réalité de celui-ci, il est irréel. Rattaché, au contraire, à cette réalité qui le réalise, il “prend corps” et même devient corps ». « Ils [les stoïciens] considèrent comme des corps les vertus et les vices et, en outre, l’ensemble des techniques et des souvenirs, et encore les représentations, les passions, les tendances, les assentiments », op. cit., pages 22 à 23.
51 Le devise de cette Université est « Universa Universis Patavina Libertas » : « La liberté de Padoue est universelle, pour tous ».
52 Trinidad-et-Tobago, État insulaire des Caraïbes, indépendant depuis 1962, avec une économie pétrolière, a choisi une devise tout à fait significative : « Forgé par l’amour de la liberté ». Son PIB en Parité de pouvoir d’achat est parmi les cinq plus élevés du continent américain.
53 Phoebe Oyugi, 2.3.1 The Prosecutor’s narrative ignored historical facts (2.3.1 Le récit du Procureur a ignoré les faits historiques), in L’Affaire de Laurent Gbagbo et Blé Goudé et les politiques des poursuites impartiales de la Cour Pénale Internationale, pages 100 à 102 ; 2.3.2 The Prosecutor’s narrative was not supported by evidence presented (2.3.2 Le récit du Procureur n’était pas étayé par les preuves présentées, pages 102 à 103.
54 Bernard Ntahiraja et Gerhard Kemp, Reasons of Judge Geoffrey Henderson (n 5), International Criminal Justice in Africa, 2020, Fondation Konrad Adenauer, publié en 2021.
10
réfutation sans ménagement des « opinions » de la Procureure dont la faiblesse argumentaire était trop patente55. Il n’aura cherché et pratiqué « que » la sociologie des faits qui doit tant à la philosophie.
Il en va tout autrement avec la troisième juge, Olga Venecia Herrera Carbuccia56, au brillant parcours scolaire à l’Universidad Autónoma de Santo Domingo, en République dominicaine57, mais qui paraît ne pas y avoir fait de rencontre heureuse ou féconde avec la philosophie. On en prend l’exacte mesure dans la formulation de son « opinion dissidente »58 qui n’organise pas une argumentation rationnelle ni même fondée en droit, mais expose une opinion qui s’est accommodée de la lourde carence et de la nullité des preuves de l’accusation, et en défendant un parti-pris dont la faiblesse aura consisté en un montage alambiqué, un assemblage éclectique et des enchaînements d’idées qui empruntent beaucoup aux sophismes, au sens où le vraisemblable est réputé être plus juridique, mieux fondé en droit, que le vrai et les faits. Sur le plan de la construction juridique, on pourrait dire qu’elle a « entassé sophismes sur sophismes », pour reprendre le mot de Mably59.
C’était un peu « comme si » le Dieu des trois religions monothéistes (juive, chrétienne et musulmane) et le « Cela » (l’impérissable de l’hindouisme) étaient mis en procès au chef d’accusation que le mal et tous les maux sur terre, puis jugés coupables parce que créateurs du monde, donc responsables en dernière instance de la fonction et de l’exercice du mal et de ses variétés dans le monde. Ainsi, placée dans l’incapacité de démontrer et plus encore de prouver la responsabilité individuelle et directe de l’accusé, la juge « fabriquera » de toutes pièces une opinion sur le modèle du syllogisme suivant : a) Laurent Gbagbo est président de la République (au moment des faits) ; b) Or, tout chef d’État est le responsable direct des actes criminels perpétrés par des forces publiques et des milices privées, toutes supposées lui obéir, durant son mandat ; c) Donc, Laurent Gbagbo est coupable des crimes commis et dont il est accusé.
Il est facile de constater que le point principal sur lequel se fonde l’accusation est exprimé dans la seconde prémisse du raisonnement (« Or,… ») de la juge et qui constitue un vice logique. La fausseté de ce type de raisonnement, qui respecte les règles formelles du syllogisme, est apprise aux étudiants dès leur première année de philosophie, afin qu’ils s’en prémunissent, à l’aide de l’exemple suivant :
55 Phoebe Oyugi : « In deciding to acquit the two accused persons, the Majority of Trial Chamber I, Judges Geoffrey Henderson and Cuno Tarfusser, found that the Prosecutor had failed to produce sufficient evidence to prove the individual criminal responsibility of the two accused persons as well as to demonstrate the core constitutive elements of the crimes charged. Although the two judges came to a similar conclusion, they each arrived at the decision differently and each wrote a separate opinion justifying their respective decision to acquit. In their separate opinions, they both deeply faulted the Prosecutor’s narrative using phrases such as “one-sided”, “skewed”, “implausible”, “shaky” and “simplistic narrative”. The reasoning of the Majority with regard to the Prosecutor’s narrative raises many issues regarding the challenges facing the ICC, among them the issue of one-sided prosecutions » ; Google traduction : « En décidant d’acquitter les deux accusés, la majorité de la Chambre de première instance I, les juges Geoffrey Henderson et Cuno Tarfusser ont estimé que le Procureur n’avait pas produit suffisamment de preuves pour établir la responsabilité pénale individuelle des deux accusés ni pour démontrer les éléments constitutifs essentiels des crimes reprochés. Bien que les deux juges soient parvenus à une conclusion similaire, ils ont chacun rendu leur décision différemment et ont rédigé une opinion séparée justifiant leur décision d’acquittement. Dans leurs opinions séparées, ils ont tous deux profondément critiqué le récit du Procureur, utilisant des expressions telles que “partial”, “biaisé”, “invraisemblable”, “bancal” et “récit simpliste”. Le raisonnement de la majorité concernant le récit du Procureur soulève de nombreuses questions concernant les défis auxquels la CPI est confrontée, notamment la question des poursuites partiales », L’Affaire de Laurent Gbagbo et Blé Goudé et les politiques des poursuites impartiales de la Cour Pénale Internationale, pages 88 à 108.
56 Maxence Peniguet, Gbagbo/Blé Goudé : pourquoi la juge Herrera-Carbuccia refuse de les acquitter, Justice Info.net, Pays-Bas, 19 septembre 2019.
57 La devise de la République dominicaine est « Dieu — Patrie — Liberté ».
58 Cour Pénale Internationale, La Chambre de première instance I de la CPI acquitte Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de toutes les charges, communiqué du 15 janvier 2019.
59 Mably, op. cit., p. 17.
11
« De nos jours, les produits à bon marché sont rares.
Or, les produits rares sont chers.
Donc, les produits à bon marché sont chers ».
Conclusion inexacte, contradictoire60 et irréelle61. C’est ce type de syllogisme qu’a pratiqué la juge. La faillite de son opinion était inévitable, parce qu’un vice était logé dans la seconde prémisse de son syllogisme. Au reste, au lieu de débuter son analyse juridique par l’étude objective des faits afin de parvenir à les établir solidement, comme le feront ses deux collègues, elle est partie d’une certitude s’efforçant, en vain, de trouver dans les compilations jurisprudentielles des arguties pour conforter son opinion préconçue et ses préjugés.
Que voulut-elle, sinon peut-être simplement « sauver » la procureure Fatou Bensouda, au détriment des droits de la défense et de l’accusé, c’est-à-dire du Droit tout court ? Mais, ce faisant, elle tombait sans s’en apercevoir dans un type d’erreur contre lequel les stoïciens ont toujours mis en garde : transformer les faits62 en événements63. D’autant qu’un stoïcien n’est jamais aussi fort et redoutable qu’à l’instant même où il est (mis) en situation, c’est-à-dire selon la manière d’être relative, qui est l’une de leurs catégories du « temps vécu ». De la sorte, et très paradoxalement, elle favorisa Laurent Gbagbo, le « Cicéron ivoirien » auquel, avec l’aide habile de ses avocats, il aura « seulement » suffi de rétablir les faits pour que les événements perdent toute crédibilité et s’effondrent seuls et d’eux-mêmes.
Tel a été le ressort philosophique sur lequel a reposé la décision majoritaire des juges Cuno Jakob Tarfusser et Geoffrey Henderson. À la charmante Procureure Fatou Bensouda, ils n’auront réclamé qu’une « séquence empirique » semblable au fameux exemple fourni par les stoïciens et consigné dans la formule sur l’évidence : « Si un homme est blessé au coeur, il mourra ; si une femme a du lait, elle a accouché », séquence qu’elle a été incapable de produire, quand la juge Olga Venecia Herrera Carbuccia s’évertuait laborieusement à construire une « identité logique » impossible à parachever et
60 E. Bréhier : « La définition du contradictoire (τὸ μαχόμενον) est beaucoup plus malaisée à donner : « est contradictoire une chose qui ne peut pas être admise (παραληφθὴναι) en même temps qu’une autre ». L’opposé de : « il fait jour, c’est : il ne fait pas jour ; le contradictoire, c’est : il fait nuit. Si deux termes A et B sont opposés, il est visible que non-A contiendra plus que B, le non-vice plus que la vertu. L’exemple donné par Dioclès est celui-ci : “s’il fait jour, il fait clair”. L’opposé de la seconde proposition : il ne fait pas clair, contredit : “il fait jour”. Mais il y aura là, au point de vue stoïcien, une évidente difficulté : si le contradictoire a un sens dans un système défini de concepts, il n’en a plus lorsqu’il s’agit seulement de faits : un fait existe ou n’existe pas ; mais comment pourrait-il être contradictoire qu’un fait d’une nature déterminée (le jour) soit lié à un fait d’une nature autre (la nuit) ? Cette difficulté a pu amener certains stoïciens à ne laisser dans les συνημμένα que des propositions identiques, comme “s’il fait jour, il fait jour”. Car l’opposé du second est ici non plus le contradictoire, mais l’opposé du premier », op. cit., p. 28.
61 Dans ce cas, re raisonnement est dit « valide », parce qu’il respecte les règles du syllogisme (deu x prémisses et une conclusion), mais il n’est pas « valable », parce que sa conclusion est contradictoire et fausse.
62 E. Bréhier : « Les sciences expérimentales et les philosophies sceptiques ou critiques en accord avec elles nous ont accoutumés à voir dans le fait ou l’événement la véritable réalité objective et à considérer un objet comme un résultat et une synthèse d’un grand nombre de faits, plutôt que comme le sujet d’attribution de ces faits. Le centre du réel s’est pour ainsi dire déplacé. C’est cette circonstance qui peut rendre cette doctrine stoïcienne assez pénible à concevoir. Les faits sont le seul objet d’expérience et la pensée qui cherche à les observer et à découvrir leurs liaisons reste étrangère à eux. Au contraire les stoïciens, en admettant que les faits étaient incorporels et n’existaient que dans la pensée, pouvaient en faire, nous ne dirons pas même l’objet, mais la matière de leur dialectique. Au fond le caractère commun à toutes les logiques anciennes est d’être réalistes : jamais les anciens n’ont cru que l’on pouvait avoir la pensée de quelque chose qui n’existe pas. Les stoïciens, malgré les apparences, sont restés fidèles à ces tendances : si la pensée dialectique n’enserre plus, dans la proposition, des réalités, l’attribut pensé n’en est pas moins identique à l’attribut objectif. En refusant à la pensée la réalité telle qu’ils la conçoivent, ils ne peuvent ainsi que la refuser à son objet », op. cit., p. 22.
63 E. Bréhier : « Les stoïciens mettent la force et par conséquent toute la réalité non pas dans les événements, dans les démarches multiples et diverses qu’accomplit l’être [c-à-d les manières d’être], mais dans l’unité qui en contient les parties », op. cit., p. 13.
12
moins encore à démontrer. Finalement, les deux juges auront refusé l’identité logique, parce qu’elle ne reposait sur aucune séquence empirique. Eux furent des stoïciens64.
On le voit donc, il ne suffit pas d’appartenir à une famille où le Droit est une tradition65 pour aimer plus que tout l’exercice de la vérité et du raisonnement.
V.
Laurent Gbagbo, le « Cicéron » ivoirien : un stoïcien caché
Après cette longue, mais nécessaire digression, reprenons la ligne de notre réflexion, en demandant, et à juste titre, selon quelles raisons cette appartenance stoïcienne n’a-t-elle jamais été perçue ou détectée ? Qu’est-ce à dire, sinon qu’elle est la révélatrice d’un probable déficit dans la capacité des philosophes et des politologues à percevoir, puis à saisir et ensuite à inscrire les dires ou les pensées des dirigeants africains dans les grands courants intellectuels les moins connus ?
Il est, en effet, bien plus facile de reconnaître un marxiste qu’un stoïcien, surtout africain, d’autant que la doctrine de L’École du Portique (Stoa, Stoïcisme) est peu enseignée en Afrique francophone. Outre les auteurs cités dans notre texte, les lecteurs éventuels peuvent se reporter au brillant exposé de la philosophie stoïcienne66 rédigé par Hegel dans ses Leçons sur l’histoire de la philosophie et que nous avons cité les grandes lignes dans la note 2 de cet article.
Et pourtant, en son langage, qui est une tropicalisation, une naturalisation ou plus exactement une ivoirisation du stoïcisme, Laurent Gbagbo n’a pas cessé de faire signe vers cette doctrine-là, ce qui aurait dû éveiller la curiosité et l’attention.
Au reste, comment comprendre que même le fameux surnom « Cicéron », qui lui a été attribué par ses condisciples, n’a pas suffi à susciter cette curiosité, en particulier celle de nos Espécialistes de rien sauf de l’Afrique.
Tous ceux-là n’ont rien compris, et à l’égal de tant d’autres, ne comprendront jamais rien à-ce-qui s’appelle ou se nomme Laurent Gbagbo et, par suite, ne pas saisir le sens historial de son combat. Mais pour qui décide, enfin, de vouloir savoir le-ce-qui s’appelle Laurent Gbagbo et pourquoi il a été surnommé « Cicéron », il convient de mettre, sous leurs yeux, un seul extrait d’un des plus grands livres de Cicéron, de son vrai nom Marcus Tullius Cicero67, que Mably retiendra pour le placer en exergue et comme fondement doctrinal de son ouvrage, l’un des plus riches et plus beaux textes qui annonçait la Révolution française et la République :
64 Victor Brochard : « À la vérité, d’après un autre texte de Sextus et un autre de Plutarque indiqués également par M. Hamelin, certains stoïciens se montraient encore plus exigeants et voulaient que le lien unissant les deux termes fût ce qu’ils appelaient ἔμφασις (Pyrrh., VIII, 254 ; Plut., De εἰ ap. Delph., p. 387). Ce qui signifie que l’un et l’autre doivent être identiques, mais cette union nous est présentée comme ayant été défendue par quelques stoïciens, peut-être par ceux qui, harcelés par les objections des adversaires, apercevaient mieux les difficultés de la thèse stoïcienne. Nulle part il ne nous est dit que cette thèse ait été celle du Portique tout entier. Au contraire, la définition courante du signe indicatif est celle que nous venons de rappeler, et les exemples invoques a l’appui de cette définition : Si un homme est blessé au coeur, il mourra ; Si une femme a du lait, elle a accouché (Ad. Math., VIII, 252), attestent jusqu’à l’evidence qu’il s’agit d’une séquence empirique et non d’une identité logique », pages 138 à 139.
65 Wikipédia : Elle « est issue d’une famille d’avocats, de médecins, de musiciens et de poètes. Elle est la fille de Mercedes Luisa Carbuccia Montalvo, l’une des premières femmes à obtenir un doctorat en médecine à San Pedro de Macorís, et d’Abelardo Herrera Peña, juge à la Cour suprême de la République dominicaine. Herrera a deux soeurs et un frère : Dora Rosanna Herrera Carbuccia, spécialisée en pédiatrie ; Vanessa Margarita Herrera Carbuccia, avocate spécialisée en droit municipal ; et Manuel Herrera Carbuccia, juge à la Cour suprême de la République dominicaine ». Sur les cinq membres directs de la famille, trois sont juristes.
66 Hegel, La philosophie stoïcienne, 1. La Physique, 2. La Logique, 3. La Morale, in Leçons sur la philosophie de l’histoire, Deuxième division, Deuxième période : le Dogmatisme et le Scepticisme, Les Néoplatoniciens, tome 4, La philosophie grecque, coll. Bibliothèque des textes philosophiques, Vrin, Paris, 1974, pages 633 à 686.
67 Marcus Tullius Cicero, 3 janvier 106 av. J.C. Arpinum (Latium, Italie) — 7 décembre 43 av. J.C. (Formies, Italie),
13
« L’ouvrage qu’on va lire, écrit Mably, n’est qu’un commentaire de ce passage admirable de Cicéron, que les auteurs qui ont écrit sur le droit naturel et les principes du gouvernement n’auraient jamais dû perdre de vue »68.
Mably traduit ainsi ce passage du livre de Cicéron : « Il existe une loi vraie, c’est la droite raison, conforme à la nature, répandue parmi tous les hommes, invariable, éternelle ; ses ordres nous appellent à remplir notre devoir ; ses interdits peuvent nous détourner des mauvaises actions ; ni les uns ni les autres ne s’adressent en vain aux honnêtes gens, mais ils sont impuissants sur les méchants. On ne peut pas supprimer cette loi ; il n’est permis ni d’y apporter le moindre amendement ni de l’abroger en totalité. Ni le sénat ni le peuple ne peuvent nous en affranchir, et il n’y a pas à chercher quelqu’un d’autre pour l’expliquer et l’interpréter. Elle ne sera pas différente à Rome et à Athènes, aujourd’hui et demain ; mais tous les peuples, en tout temps, seront soumis à une loi unique, éternelle, immuable ; et il y aura un être unique qui l’enseignera et l’imposera à tous les hommes, ce sera Dieu, qui a imaginé cette loi, qui en a délibéré, qui l’a adoptée. Quiconque lui désobéira deviendra étranger à soi-même, et parce qu’il aura méprisé la nature humaine, il subira le plus grand châtiment, même s’il échappe à tout ce qu’on range sous le nom de supplice ». De Republica, III, 22 »69.
Mably donne, ici, la clé de lecture de la vie de Laurent Gbagbo, qui, lui, se sera efforcé toute sa vie politique de suivre et d’appliquer cette idée de la République que la conception de Cicéron formule si judicieusement. Il n’a pas porté et ne porte donc pas selon un simple hasard ce célèbre surnom, auquel il reste fidèle et sous lequel se range sa biographie politique.
C’est dans la filiation spirituelle et politique de Cicero et de Mably, lui-même grand commentateur de Cicero, que s’inscrit Laurent Gbagbo.
Mais il n’y a pas que Marcus Tullius Cicero et Gabriel Bonnot de Mably. En effet, les pensées éthiques d’un autre stoïcien semblent tenir une place significative dans la biographie politique de Laurent Gbagbo : Épictète, membre éminent de l’école stoïcienne, qui, d’un statut d’esclave à Rome — ce que son nom rappelle70 —, deviendra l’un des plus grands philosophes de son temps (50 après J.-C., à Hiérapolis — 130, Nicopolis) et dont la notoriété reposera, à la fois, sur la qualité de son enseignement, mais aussi sur la conformité de son mode de vie avec ses leçons orales.
Quant au fond, et nous le verrons, Laurent Gbagbo a ceci de spécial que, dans la panoplie des chefs d’État africains, des plus anciens aux plus récents, il est le premier et pour lors le seul qui appartient à cette école de pensée gréco-latine. Aussi est-il possible de l’inscrire comme figure particulière dans l’histoire de la philosophie politique. La question appelée par V. Goldschmidt sur « la pérennité du
68 Gabriel Bonnot de Mably, Des droits et des devoirs du citoyen, édition critique avec introduction et notes par Jean-Louis Leclercle, Librairie Marcel Didier, Publié avec le concours du CNRS, Paris, 1972, pages 1 à 2.
69 Cicéron, De Republica, III, 22, cité par Gabriel Bonnot de Mably, Des droits et des devoirs du citoyen, édition critique avec introduction et notes par Jean-Louis Lecercle, Librairie Marcel Didier, Publié avec le concours du CNRS, Paris, 1972, p. 2.
70 Épictète, Epíktêtos, Ἐπίκτητος signifie : « homme acheté, serviteur ».
14
stoïcisme »71 reçoit, depuis l’Afrique noire, une réponse, celle de la survivance de cette doctrine au coeur du politique.
Certes, le Stoïcisme n’explique pas toute la biographie de Laurent Gbagbo. Mais cette doctrine n’en constitue pas moins l’une des dimensions essentielles.
VI.
De nouveau, l’avocat anonyme
En tous les cas, ces propos d’un vieil expert du droit me parurent tant vrais et de si bonne foi que, fixant ainsi mon attention, j’y décelais, dans le même temps, comme un degré de réelle compassion doublée d’une stupéfaction profonde. Et, oserais-je le dire, son étonnement m’étonna ; et ce, non pas parce que, à l’évidence, il connaissait insuffisamment ce prisonnier-là, quoique rien ne l’obligeait à le connaître de manière suffisante, mais d’abord et surtout parce que, et c’est là un vrai défaut de mon esprit, je me dis aussitôt qu’il n’avait pas lu les Entretiens72 d’Épictète consignés par Arrien, ou s’il les avait lus, ce qui est le plus probable, il en avait oublié les réflexions et les enseignements éthiques (pratiques, théoriques et logiques).
Notre article vise à combler toutes ces lacunes, ou du moins les principales, sans lesquelles Laurent Gbagbo ne se laisse que difficilement saisir, comme homme libre ou comme prisonnier.
VII.
Gbagbo : après Cicéron, également entre Épictète et Démocrite
Voilà une relation pour le moins inattendue, surprenante même et qui surgit en sonnant de manière bien étrange. Pourtant, les indices font nombre. Et c’est à la philosophie, qui quête « l’essence des choses », qui guette l’étantité de l’étant, c’est-à-dire l’être, et parce qu’elle seule s’oblige à cheminer (μέθοδος, μεθόδων : cheminement) par l’étonnement questionnant (Platon, Aristote)73, que revient la tâche de retrouver ce qui est philosophique dans le monde et l’histoire.
Alors de quels indices la philosophie dispose-t-elle, pour s’étonner autant d’un rapport entre deux grands penseurs stoïciens (matière originelle), un rieur matérialiste (vanité des hommes) et Laurent Gbagbo, tandis que rien, au demeurant, ne paraît de prime abord les lier, si ce n’était le surnom de « Cicéron » ? Au vrai, et pour être d’emblée exact, c’est Laurent Gbagbo qui s’est lié à eux. Pour les stoïciens, par le dicible (« l’exprimable ») et, pour Démocrite, par le rire.
Ainsi le dicible et le rire ouvrent-ils un « chemin » insoupçonné, sur lequel l’étonnement « chemine ».
VIII.
Le « dicible » ou « l’exprimable » des stoïciens
Émile Bréhier précise ce qu’est un exprimable : « La réalité logique, écrit-il, l’élément primordial de la logique aristotélicienne est le concept. Cet élément est pour les stoïciens tout autre chose ; ce n’est pas la représentation (φαντασία) qui est la modification de l’âme corporelle par un corps extérieur ni
71 Victor Goldschmidt, op. cit., p. 216.
72 Épictète, Comment on peut toujours sauvegarder sa dignité personnelle, Chapitre II, in Entretiens, Livres I à IV, Texte établi et traduit par Joseph Souilhé, avec la collaboration D’Amand Jagu, coll. Tel, Éditions Gallimard, Paris, Société d’édition Les belles Lettres, 1943 pour le livre I, 1949, pour le livre II, 1990, pour le livre III et 1991 pour le livre IV, p. 16.
73 Jeanne Hersch, L’étonnement philosophique, Une histoire de la philosophie, coll. folio essais, Gallimard, 1981,1993 ; Heidegger, Qu’est-ce que la philosophie ? in Questions II, coll. Classiques de la philosophie, Éditions Gallimard, Paris, 1968 ; Heidegger, Qu’est-ce que la métaphysique ? in Questions I, coll. Classiques de la philosophie, Éditions Gallimard, Paris, 1968.
15
la notion (ἔννοια) qui s’est formée dans l’âme sous l’action d’expériences semblables. C’est quelque chose de tout à fait nouveau que les stoïciens appellent un exprimable (λεϰτóν) »74.
L’exprimable75 se nomme autrement, par un synonyme. Richard Dufour : « Le dicible, répète-t-il, est une innovation des stoïciens. Il fait partie de leur dialectique et de leur analyse du discours. Selon les stoïciens, le discours implique trois facteurs : le signifiant, le dicible et l’objet. Le signifiant est le son proféré ; le dicible est la signification du mot ; et l’objet est le corps sensible extérieur »76. Chacun reconnaîtra ici la source de la définition que Ferdinand de Saussure donnera quelques siècles plus tard du signe linguistique.
Pour l’école de pensée stoïcienne, ce qui peut être dit, l’exprimable méthodique, le dicible est un des quatre « incorporels », avec le lieu, le vide et le temps qui sont des subsistants77, quand « les corps » sont des existants.
Qu’est-ce que Laurent Gbagbo rend exprimable78, comment le dicible stoïcien advient-il chez lui ? Il y répond, à sa manière, en s’immergeant dans son propre langage, pour rappeler ce en quoi celui-ci consiste, et il « dit » le dicible en ces termes :
« J’ai, se plaît-il à dire, trois niveaux de langage. Le langage châtié du latiniste que je suis. Le langage intermédiaire que tout le monde entend et le langage terre-à-terre si on me cherche »79.
Arrêtons-nous un instant sur cette affirmation qui, pour un regard rapide ou pressé, pourrait paraître banale, mais dont le profond ne l’est pas du tout. Signalons une première non-évidence, c’est-à-dire un fait qui ne se voit pas (voir, videre [latin]. Mettons-le au jour, puisqu’il mérite d’être observé : la
74 E. Bréhier, op. cit., p. 14 ; « Un Grec et un Barbare entendent un même mot ; ils ont tous deux la représentation de la chose désignée par le mot ; pourtant le Grec comprendra et le Barbare ne comprendra pas. Quelle autre réalité y a-t-il donc que le son d’une part, l’objet de l’autre ? Aucune. L’objet comme le son reste le même. Mais l’objet a pour le Grec, je ne dis pas une propriété (car son essence reste la même dans les deux cas), mais un attribut qu’il n’a pas pour le Barbare, à savoir celui d’être signifié par le mot. C’est cet attribut de l’objet que les stoïciens appellent un exprimable. L’objet signifié (τό σημαινόμενον) diffère, d’après le texte de Sextus, de l’objet (τό τύγχανον), précisément par cet attribut qui en est affirmé sans en changer la nature. Le λεϰτόν était quelque chose de si nouveau qu’un interprète d’Aristote, comme Ammonius, a la plus grande peine à le loger dans les classifications péripatéticiennes. Pour Aristote, la chose signifiée par le mot était, dit Ammonius, le pensée (νόημα), et, par la pensée, l’objet (πρᾶγμα). “Les stoïciens, ajoute Ammonius, conçoivent en outre un intermédiaire entre la pensée et la chose, qu’ils nomment l’exprimable”. Ammonius n’approuve pas cette addition, et en effet la théorie d’Aristote se suffit à elle-même, si la pensée est en elle-même l’objet désigné. Il ne pouvait plus en être de même pour les stoïciens. Pour eux la pensée était un corps, et le son était aussi un corps. Un corps a sa nature propre indépendante, son unité. Le fait même d’être signifié par un mot doit donc lui être ajouté comme un attribut incorporel, qui ne le change en rien. Cette théorie supprimait tout rapport intrinsèque entre le mot et la chose. On peut sans doute y ramener les vues de Chrysippe sur l’amphibologie », op. cit., pages 14 à 15.
75 E. Bréhier : « Dans les exprimables, disent-ils, les uns sont incomplets, les autres complets ». Les exprimables incomplets sont les attributs de jugements, énoncés dans des verbes sans sujet : « écrit, parle ». Les complets sont, pour ne considérer maintenant que les plus simples, le verbe accompagné de son sujet […] Les exprimables se bornent aux attributs sans sujet, tantôt accompagnés de leur sujet » , op. cit., p. 17 ; « Les attributs ne sont qu’une certaine espèce d’exprimables. Ce sont les exprimables incomplets, que l’on transformera en propositions ou en exprimables complets en répondant à la question : « Qui est le sujet de l’action ? ». Ce sont là des propositions simples : les autres exprimables complets seront des propositions composées que l’on obtient par une combinaison de propositions simples, dont un exemple est ce que nous appelons aujourd’hui proposition hypothétique (le σημημμέηοη des stoïciens », op. cit., p. 22.
76 Richard Dufour, Plotin et les stoïciens, Mises en perspective de la psychologie plotinienne, in Études platoniciennes, L’âme amphibie, 3/2006, § 33, OpenEdition Journals, pages 177 à 194.
77 V. Goldschmidt : « Le mot que, à la suite d’E. Bréhier, nous traduisons par “subsister”, sert couramment dans les textes à désigner le mode d’existence des incorporels, c’est-à-dire une existence simplement pensée ou dans la pensée », op. cit., p. 43.
78 E. Bréhier : « d’après Sextus tout exprimable doit être exprimé, c’est-à-dire énoncé par un mot significatif de la pensée. Mais le fait d’être exprimé (λέγεσθαι) qui est un prédicat de l’exprimable ne doit pas du tout être confondu avec le fait d’être signifié (τό σημαινόμενον) qui est lui-même un exprimable et un prédicat de l’objet », op. cit., pages 15 à 16.
79 D’autres significations de l’expression ne sont pas ici prises en compte, parce qu’elles n’ajoutent que peu à notre réflexion.
16
construction typique de la phrase. Elle tient en un ensemble de cinq « propositions vraies »80 [aucune d’elles ne contredit une autre] et qui sont toutes « valables » [la conclusion81 ne contredit pas les prémisses].
Outre l’analyse grammaticale82 sommaire, mais qui n’est pas ici notre objet, il est aisé de procéder à l’analyse logique83 [« nature et fonction de ses propositions »] de cette phrase, selon les principaux syntagmes84 [unités de mots dans une phrase] qui la composent. Car, comme cela a été rappelé par Emile Bréhier, « les stoïciens […] s’étaient mis dans l’impossibilité de procéder autrement que par l’analyse grammaticale »85.
Cette parole de Laurent Gbagbo se compose de cinq propositions qui se répartissent en deux parties inégales. D’un côté, quatre « propositions simples » : 1) « j’ai trois niveaux de langage », qui vaut comme la « proposition principale », suivie et prolongée par quatre « propositions subordonnées » : 2) « le langage châtié du latiniste que je suis » ; 3) « le langage intermédiaire que tout le monde entend » et 4) « le langage terre-à-terre… ». Notons que ces quatre propositions sont « indéfinies » et de nature « assertotique » (c’est-à-dire posée comme « vraie »).
De l’autre côté, une seule proposition, la cinquième, de nature « non-simple » : « si on me cherche », qui est une « proposition conditionnelle », en raison de la présence de la conjonction « si ». Celle-ci, par ailleurs, sous-entend une « proposition subconditionnelle », avec un puisque qui, quoique non dit, est présent : « puisqu’on me cherche, alors j’utilise le langage terre-à-terre ». Nous verrons plus loin que Laurent Gbagbo utilise à souhait les « propositions subconditionnelles ».
En tout état de cause, « Dioclès définit ainsi le sens de la conjonction si : « elle signifie que le second terme est la conséquence du premier »86. Aussi indique-t-elle une liaison entre deux propositions distinctes. Autrement dit, la formule « si on me cherche », comme second terme, est la conséquence du premier terme : « le langage terre-à-terre ». La proposition est dite hypothétique87.
Somme toute la phrase de Laurent Gbagbo sur ses trois langages montre qu’elle est une proposition composée qui combine et additionne des propositions simples88.
Que nous révèle cette brève classification linguistique ? Un fait déterminant. En effet, qui connaît les grandes doctrines philosophiques, au terme d’une très brève analyse logique, n’a pas grande peine à
80 E. Bréhier : « Quel est […] le principe de liaison dans la proposition causale comme : “puisqu’il fait jour, il fait clair ?” Il est, en apparence, assez différent, c’est un lien de conséquence (άϰολουθία). La proposition est vraie, à condition que la seconde (ou le second fait) suivie de la première (ou du premier fait), et non inversement », op. cit., pages 28 à 29. Victor Brochard : « l’ἀκολουθία, c’est-à-dire l’impossibilité de poser l’un des termes sans l’autre », La logique des stoïciens (Deuxième étude), Cahiers philosophiques, n° 151/4e trimestre 2017, p. 138.
81 Dans un syllogisme (mode de raisonnement), la conclusion est introduite par l’adverbe « Donc ». Dans la phrase de Laurent Gbagbo, cet adverbe est remplacé par la conjonction « si ».
82 Stéphane Pagès, Les bases de l’analyse grammaticale (nature & fonction), in Grammaire expliquée de l’espagnol, 24 avril 2019, pages 9 à 21. L’analyse grammaticale consiste à mettre au jour, d’une part, la nature et la fonction des éléments constitutifs d’un énoncé, et, d’autre part, sa structure. E. Bréhier, op. cit., p. 26.
83 Maxicours, L’analyse logique, Fiche de cours, nature et fonction des propositions
84 Université Polytechnique Hauts-de-France : « Le syntagme est une séquence de mots liés entre eux par des relations de dépendance et formant donc une unité syntaxique dans la structure de la phrase. Syntagmes (ou groupe de mots) : nature et délimitation, Cours 2.
s’apercevoir que la substruction (fondement de la construction) de cette phrase est typiquement stoïcienne : simple, non-simple, indéfinies, assertotique, conditionnelle, voire subconditionnelle. Ce fait saute immédiatement aux yeux. Ainsi surgit une première indication qui agrafe le dire de Laurent Gbagbo dans l’univers stoïcien. Dans sa phrase, il pense et parle comme un stoïcien, sans le dire.
Mais approfondissons ce dicible. Son trilinguisme dit en réalité bien plus qu’il n’y paraît. On y décèle, en effet, une quadruple information : a) une classification (taxinomie) des types de langage (trois modes de parole) ; b) l’image d’une échelle (gradation) linguistique (musicale : rythme) descendante (du châtié élevé au terre-à-terre militant ou combattif) ; c) un usage du langage (selon le contexte et la qualité des interlocuteurs) ; d) une tension « dialectique » : deux (langages) différents qui ne sont pas des contraires (châtié/terre-à-terre) et un moyen terme (l’intermédiaire), qui reprend le procédé académique classique ; e) l’emprunt direct de la présentation tripartite du Français : « français de bon usage », « français courant » et « français familier » qui, dans l’ordre, correspondent au langage châtié, au langage intermédiaire et le langage terre-à-terre.
Il est intéressant de noter que Laurent Gbagbo est l’un des rares hommes politiques africains, peut-être même le seul, à utiliser trois niveaux de langage. Senghor, par exemple, ne s’en tenait qu’à un seul : le « français de bon usage » dans lequel il excellait et qui le mènera à l’Académie française. Il n’a jamais pratiqué les deux autres types de langage. Cabral, lui, parlait le français avec « ductilité » selon François Mitterrand, tandis que dans les forêts de Guinée-Bissau ou dans la Diaspora, il usait volontiers du « langage intermédiaire » ou « français courant » pour exprimer de grandes idées par des raisonnements composés. Félix Houphouët-Boigny, lui, menait un langage courant de sagesse, de bon sens, qui était tout aussi approfondi que ceux des autres.
Mais, suspendons les comparaisons, afin de dissiper toute équivoque éventuelle : que dit la locution « langage terre-à-terre » ? Laurent Gbagbo la pratique dans sa définition la plus commune, c’est-à-dire selon l’une des définitions données par Le Larousse, comme un ensemble de paroles « qui est très proche des préoccupations de la vie courante »89, en l’occurrence celle des Ivoiriens. C’en est la première signification, celle qui a été retenue, parce que la plus commune. Il s’adresse donc à eux en parlant le langage de leur existence quotidienne : « digba dette » veut alors dire mégadette publique ou endettement colossal avec son pesant encours. Par conséquent, il s’agit de la traduction réussie d’une donnée macro-économique en une préoccupation de « la vie courante ».
XI.
« Digbha » ou « digba » : différence, entre danse et dette ?
Mais il y a bien plus. En effet, on l’oublie, parce que l’usage en a été perdu, l’expression « terre-à-terre » désigne aussi « un style de danse où l’importance est donnée aux pas de virtuosité exécutés au ras du sol (petite batterie) ou sur pointes »90. C’en est la seconde signification, la moins connue aussi, mais qu’il convient de retenir sans rejeter ou négliger la précédente ; car elles vont de pair, qui plus est, ne sont pas antinomiques et plutôt s’amplifient réciproquement. Si, dès lors, nous décidons de retenir cette acception-là, il se dévoile aussitôt un rapport caché avec quelques pas d’une danse
89 Le Petit Larousse illustré, terre-à-terre, Vuef, Paris, 2001, p. 1002. Le Robert, terre-à-terre, locution adverbiale, adjectif invariable : « sans s’élever au-dessus du niveau commun », « peu poétique », Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Société du Nouveau Littré, Paris, 1977, p. 1948.
90 Le petit Larousse illustré : « Se dit d’un style de danse (XVe — XVIIe) caractérisé par des pas exécutés au ras du sol, sans sauts », Ibid.
18
vive de la culture béthée91 que Laurent Gbagbo connaît bien : Le Digbha qui, dans la typologie des danses, prend place dans la catégorie des « danses folkloriques »92.
C’est ici le Digbha qui éclaire le Digba. Et par consécution, le Digbha dicte sa signification originaire et authentique au Digba. Ainsi, la formule « digba dette », qui a soulevé l’hilarité générale de tous ses auditeurs et tant irrité ses adversaires, est-elle sans doute l’écho détourné du Digbha.
Bref, si notre hypothèse est juste, et elle l’est nécessairement quand elle est inscrite dans le « langage châtié » que revendique Laurent Gbagbo, si donc l’allusion renvoie au Digbha en tant que type de « danse », c’est tout autrement que devrait s’entendre le formule « digba-dette » qui non seulement devrait plutôt s’écrire « Digbha dette » et non pas « digba dette », comme l’ont fait les journalistes, les économistes et autres politologues. Ainsi, il subsiste une différence notable entre « Digbha » et « Digba ». Le premier appartient au domaine élevé de l’art de la danse, quand le second relève du quantitatif et de la mensuration, et valant comme une unité de mesure.
Rassemblons maintenant les considérations précédentes pour dire et affermir ce qui suit : Digbha-dette signifie dette (publique) dansée par un danseur expérimenté, virtuose de l’emprunt sur le rythme (très rapide) du Digbha, et dont la frappe rapide des pieds au sol (duquel il ne s’arrache pas) indique la virtuosité.
Tout l’humour du « Cicéron ivoirien » est condensé dans cette formule laconique et que, par l’effet lacanien de compréhension spontanée du signe93 (ou ce que les stoïciens appellent la représentation compréhensive94), la plupart des Ivoiriens saisissent immédiatement pour aussitôt se laisser plonger dans une grande alacrité.
Bref, c’est dans le registre de l’art de la danse que Laurent Gbagbo est allé chercher le sens de sa formule vernaculaire et non pas en économie. C’est, à proprement parler, de l’art, plus encore de l’art oratoire et une véritable prouesse rhétorique, que d’aller chercher et surtout trouver des signes percutants dont la percussion même évoque une question économique sérieuse. Ainsi, et donc au vrai, Laurent Gbagbo parle-t-il d’une chorégraphie de la dette ivoirienne, ce qui lui permet d’ironiser implicitement sur le chorégraphe ?
91 Principales danses de l’ethnie Bété : le Gbégbé, le Alloukou, le Kpaklo, le Zagrobi, le Ziglibithy (rythme du Digbha, discours lyrique du Tohourou-Doblhé et gestuelle du Glhè), répertoriés sur le site de la Mairie de Guibéroua : https://www.mairieguiberoua.ci/detail-culture-et-tourisme/90/les-danses-du-pays-bete
92 Danse folklorique/Google /
93 E. Bréhier : « Le signe n’est autre chose que la proposition antécédente d’un συνημμένον, dans le cas particulier où les deux propositions sont vraies, et où la première est capable de découvrir (ὲϰϰαλυπτιϰόν) la seconde, comme : « si une femme a du lait, elle a enfanté », op. cit., p. 31.
94 E. Bréhier : comme « un mode de connaître et de savoir […] la représentation compréhensive […] est non pas une chose incorporelle, comme l’exprimable, mais une action réelle de deux corps l’un sur l’autre, provenant de leur tension intérieure. De ces corps, l’un est l’objet extérieur et l’autre la partie hégémonique de l’âme. Cette manière de connaître, rapprochement intime de l’âme et de son objet, n’a aucune espèce de rapport avec la connaissance de la dialectique : celle-ci n’atteint que des exprimables, des événements ; celle-là atteint l’objet lui-même, l’être avec sa qualité propre derrière le réseau d’événements qui paraissent à l’extérieur. C’est une connaissance du réel qui est intuitive et certaine, mais c’est en même temps une connaissance qui ne trouve pas son expression dans le langage », op. cit., p. 62. Victor Goldschmidt, op. cit., p. 113.
19
Sans aucun doute. « C’est le recours à la substitution »95, procédé que les psychanalystes connaissent bien, avec l’exemple maintes fois interprété de la jupe d’une jeune fille96 qui renvoie immédiatement à autre chose. Par exemple, la dernière strophe de Colombine97, poème de Paul Verlaine, offre un éloquent modèle que cite Moustafa Safouan :
« L’auteur, écrit-il, commente cet exemple en ces termes : « Il (Verlaine) recourt à une allusion, le plus simple et la plus directe, qui consiste à nommer un aspect du geste (lever les jupes) pour suggérer un aspect second du même geste (faire voir ses jambes). On ne confondra pas ces deux moments, dont l’un est physique et l’autre psychologique et qui sont dans un rapport de cause à effet.
D’après ce commentaire, une représentation C (relevant ses jupes) en signifierait une autre, B, en vertu d’une connexion de cause à effet. Plus précisément, ladite connexion permet de désigner par C ce qui, à proprement parler, s’appelle B »98.
Somme toute, en ne tenant la formule de Laurent Gbagbo qu’au premier degré, en croyant ainsi qu’il ne se situait que sur le strict terrain de « l’économie générale »99, en particulier de la dette publique avec son lourd encours, et non dans le domaine de « l’art » en général et celui tout à fait particulier de la danse et de la chorégraphie, ses contradicteurs ont laissé échapper la signification profonde et la dimension humoristique de sa parole. Ce faisant, que n’ont-ils laissé intacte la raillerie et la pique ? Leurs répliques n’ont pas déconstruit l’effet critiqué.
Mais la formule de Laurent Gbagbo ne se limite pas à sa dimension humoristique. Car elle revêt une autre signification beaucoup plus dissolvante, qui la porte au-delà de la danse et la chorégraphie du pays béthé, puisqu’elle évoque une dimension cognitive qui passerait inaperçue, si l’on ne rappelait pas la conception stoïcienne de la danse100.
Mieux vaut la fin que le but101. Considérons ce point. Dans la question de savoir si la médecine et l’art de gouverner [la politique] avaient une fin semblable à celle de la sagesse, les stoïciens ne manquèrent pas de répondre par la négative, car, selon eux, ces deux « techniques »102 avaient leur fin non pas en elles-mêmes, mais à l’extérieur d’elles, à la différence de l’action pure et de la danse qui, elles, ont partiellement leur fin chacune en elle-même, et, en cela, entretiennent une certaine proximité
95 Moustafa Safouan : « c’est le recours à la substitution qui a indiqué la latence d’un Wunsch sous la Vorstellung, comme la présence d’un sujet moins émetteur du discours qu’il n’est lui-même discours. À ce titre, ce qui se passe dans le processus primaire est ce que nous retrouvons dans le premier exemple de l’« allusion de circonstance » que nous rencontrons dans le Dictionnaire de poétique et de rhétorique d’Henri Morier : « L’implacable enfant/Preste et relevant/ses jupes/La rose au chapeau/Conduit son troupeau/de dupes », L’inconscient, in Qu’est-ce que le structuralisme ? 4. Le Structuralisme en psychanalyse, coll. Points, Éditions du Seuil, Paris, 1968, p. 30.
96 Dans les travaux théoriques des psychanalystes, « la jupe » a été et reste un thème de prédilection.
97 Verlaine : « L’implacable enfant/Preste et relevant/ses jupes/La rose au chapeau/Conduit son troupeau/de dupes », Colombine.
98 Moustafa Safouan, Ibid.
99 Insee, Économie générale : « Produit intérieur brut (PIB), PBI Marchand et non marchand, Production, Formation brute de capital fixe (FBCF), Administrations privées, Contribution à la croissance du PIB, Productivité horaire du travail, Valeur ajoutée brute, SQS-EI non financières, Indices de prix de vente industriels, Indices des prix des produits agricoles à la production, Indices des prix à la consommation, Indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH), Pondération, Indice avec ou sans tabac, Glissement », in Tableaux de l’économie française, Paris, 1997, pages 101 – 109.
100 V. Goldschmidt, op. cit., p. 150 à 151.
101 V. Goldschmidt : « Pour poursuivre le σϰόπος [skopos, but], il est certes toujours besoin du temps ; mais, pour atteindre la seule fin véritable, seul est requis le présent et c’est là, non plus du tout un présent d’éternité, mais un présent temporel », op. cit., p. 149.
102 V. Goldschmidt : « la fin, dans ces techniques, est extérieure aux techniques et suppose, pour pouvoir être réalisée, la durée », op. cit., p. 150.
20
avec la Sagesse au point que, à maints égards, elles préfigurent approximativement « la vertu » qui est la visée, la fin de toute sagesse.
En effet, « l’action et la danse sont choisies à cause de leur “finalité interne”, c’est-à-dire qu’elles témoignent, opposées à la médecine ou à l’art de gouverner, de la profonde méfiance du Portique à l’égard de tout finalisme, s’il est vrai que “la finalité est externe ou elle n’est rien du tout”. De plus, ces deux arts peuvent suggérer la plénitude (“omnes numeros continent”) de la vertu, qui se manifeste entièrement et totalement à chaque instant de l’activité vertueuse ; autrement dit, cette activité fait passer dans l’instant une totalité que les autres techniques construisent péniblement et précairement dans le temps étendu […]. Enfin, c’est précisément parce que, en fin de compte, l’action et la danse échouent dans leur effort pour réaliser, à chaque instant, le tota simul, qu’elles aussi sont rejetées comme des figurations approximatives et insuffisantes de la vertu »103.
C’est aussi ce que laisse sous-entendre la notion de « Digbha » : cette danse, aussi belle soit-elle, a en elle une fin qui n’est ni extérieure ni intérieure. Elle est une virtuosité (virtu, vertu104) du virtuose qui, malgré, ne peut nécessairement qu’être qu’une chorégraphie approximative, d’après les stoïciens. Ainsi, le Digbha comme danse, quand bien même serait-elle porteuse d’une « fin » (finalité), mais d’une « fin » qui n’est pas totalement intérieure, n’est pas une vertu pleine. Autrement dit, alors qu’il semble tout d’abord faire du Digbha (la danse) un attribut ou un prédicat (grammaire stoïcisme) de la dette, en définitive, il inverse la relation dans laquelle la dette devient prédicat (attribut) du Digbha.
Nous disions, précédemment, que la locution digba-dette est non seulement la traduction réussie d’une donnée macro-économique en une préoccupation majeure de la vie courante, mais aussi et surtout que sa signification profonde devrait se chercher dans l’espace culturel du Digbha. Ce renvoi montre comment, en l’espèce, le tour de génie théorique qu’opère Laurent Gbagbo est typiquement stoïcien, dans la mesure où il crée ce que les philosophes stoïciens appellent image représentative ou représentation compréhensive, c’est-à-dire, sur le plan cognitif, une sensation réelle (une chose sentie spontanément) naturellement admise, et ce de telle façon qu’il ne peut en être autrement : c’est la forme originelle et initiale de l’assentiment105 comme premier degré de la connaissance en général, qui débute par l’impact d’un corps (l’objet sensible) sur l’âme qui s’oblige à l’accepter : le « Digbha-dette » (danse), qui intègre le « digba-dette » (grandeur, quantité), est une image représentative de haute intensité qui s’entend et se comprend immédiatement.
Une fois de plus, en matière de théorie de la connaissance, il est aisé d’y reconnaître la mise en oeuvre spécifique d’une technique cognitive stoïcienne. En effet, tout d’abord, Laurent Gbagbo commence par évoquer l’idée (thème) de la dette publique sous l’angle macro-économique, c’est-à-dire formelle (évolution, montant, etc.) ; ensuite et aussitôt, il transforme cette représentation formelle en une représentation sensible, en ayant recours au Digbha (un exprimable, une danse ; enfin, par un fait, ici
103 V. Goldschmidt : « Ce refus se précise chez Marc-Aurèle à l’aide d’une comparaison tirée de la biologie […] « le fruit que produit l’âme raisonnable, elle-même le récolte, alors que les fruits des plantes et ce qui y correspond chez les animaux, d’autres le récoltent. Elle atteint sa fin propre, que tôt ou tard survienne le terme de la vie (τοῦ ίδίου τέλους τυγχάνει, ὅπου ἃν τὸ τοῦ βίου πέρας έπιστῇ). Il n’en va pas de même de la danse, du jeu des acteurs et des autres choses semblables, où toute l’action reste inachevée (ἀτελὴς γίνεται ἡ ὅλη πρᾷξις), si quelque détail vient à manquer », op. cit., p. 151.
104 CNRTL : « Empr. à l’ital. virtuoso « celui qui connaît parfaitement un art, une science, etc., et qui en use avec une absolue maîtrise » (dep. 1525, L’Arétin), d’abord adj. « qui pratique le bien, la vertu » (dep. le xives.; Cort.-Zolli), dér. de virtù « vertu », empr. au lat. virtus, — utis (vertu*). Cf. la forme ital. virtuoso, att. en fr. de 1654 (Guez de Balzac, Les Entretiens, p. 522) à 1755 (ds Brunot t. 6, p. 694, note 2).
105 V. Goldschmidt citant Aëtius : « toute sensation est assentiment et compréhension », op. cit., p. 23
21
la proportion, il met en évidence par la comparaison avec la dette publique des États-Unis, il élève (la sursomption chez Hegel, la relève au sens de Derrida,) cette représentation sensible de la dette en une représentation rationnelle, comme font les stoïciens, et non pas à l’aide d’une définition comme le font Platon et Aristote, mais par la description, méthode propre aux stoïciens comme nous le verrons de nouveau plus loin. Ainsi, la « description » (collection de faits pour désigner un objet ou une idée, par l’ajout de prédicats ou d’attributs) de la dette publique se substitue-t-elle à sa « définition » (délimitation106 catégorique par concept d’un objet ou d’une idée). C’est pourquoi elle imprime nécessairement la conscience de ses auditeurs et qu’elle impacte tout le monde. Tous comprennent toujours ce qu’il dit, même si lui en retient la dimension cachée, que celle-ci soit première ou ultime.
Il convient donc de le souligner, comme chacun peut désormais s’en rendre compte, Laurent Gbagbo privilégie toujours, et de façon systématique, la description contre la définition. En l’espèce, la dette n’est jamais définie (comme dette), mais toujours décrite (digba-digbha). Ou du moins la définition n’est plus aristotélicienne, mais stoïcienne, au sens où elle consiste en une addition des caractères (c’est-à-dire de caractéristiques) c’est du stoïcisme.
Du point de vue grammatical, nous pourrions dire que d’un « exprimable incomplet », le mot dette, il élabore un « exprimable » que nous qualifierons volontiers de semi-complet (juxtaposition de deux exprimables incomplets, sans ajout d’un verbe107) : dette et digbha ou digba. C’est la juxtaposition108 des stoïciens. La dette est « solidaire » du digbha-digba.
En mettant à profit cette technique cognitive typiquement stoïcienne, Laurent Gbagbo en connaît d’avance les effets mécaniques sur son auditoire (ivoirien et africains). Il sait que, par cet usage, il atteint toujours son objectif pédagogique. L’auditoire rit et apprend, d’un coup, avec une seule image : la dette est là, dans le présent même qui est « préoccupation de la vie courante ».
Laurent Gbagbo, comme chacun sait, est un moqueur patenté. Il aime à (se) moquer109. C’est même, nous semble-t-il, l’un de ses arts favoris. Et il fait cela en usant surtout de son langage terre-à-terre. Dans cette matière, il excelle en public, lorsqu’il brocarde, raille et lance ses piques contre ceux qui l’ont « cherché ». Mais « si » et seulement « si » on le « cherche ».
En privé, il est moins en verve, sans doute parce que moins inspiré. Cependant, sous ses moqueries, tient stable l’humour. C’est que son « humour » est fondamentalement et d’abord une humeur110 qui,
106 Sur la définition comme limite (délimitation) des êtres, lire Émile Bréhier, De l’incorporel en général, in op. cit., pages 3 à 5.
107 Sur les verbes qui sont des « actes », E. Bréhier, op. cit., p. 19 et sur la classification des verbes (« personnels », « impersonnels », « prédicats directs », « prédicats passifs »), E. Bréhier, op. cit., p. 21.
108 Victor Brochard : « On a suffisamment défini un être ou une chose quand on a énuméré les caractères, si nombreux qu’ils soient, qui la distinguent de toute autre, et ces caractères unis sont donnés comme juxtaposés les uns aux autres ; le lien qui les unit est uniquement un lien de concomitance ou de succession, c’est une relation dans le temps. Il en est de même de la théorie du raisonnement et de celle de la démonstration. Ce qui est affirmé dans le syllogisme stoïcien, c’est que si un individu présente un certain caractère, si Socrate est un homme, il présentera aussi un autre caractère, Socrate sera mortel. Ici encore il n’y a point de rapport d’inclusion ou d’exclusion entre des concepts, mais un rapport de concomitance ou de séquence entre des qualités particulières », op. cit., p. 140. Lire également la page 42.
109 Moquer : « origine obscure : « Apparenté au vénitien mocar (« moquer, dire des paroles inutiles »), au piémontais moca (« grimace »), peut-être avec le latin maccus (« bouffon ») ou le grec ancien μῶκος, môkos (« moquerie »). Le rattachement à l’ancien nordique moka (« remuer du fumier ») n’est pas suffisamment étayée quant à son évolution sémantique et à son origine normande, Wiktionnaire.
110 Le mot « humour » est dérivé de l’ancien français humor, qui a donné « humeur ».
22
avec sa propre délectation, va chercher et puiser ses matériaux désopilants aux sources profondes de la langue.
En public, c’est l’auditoire, simultanément allocuteur et agent rythmique, qui motive le locuteur Laurent Gbagbo et, plus encore, excite son art. C’est alors le « moment » spécial où, dans un brusque surgissement, apparaît avec le plus d’éclat possible l’antique lien étymologique entre humour et humeur, tel que le rappelle et le signale le vieux français : « humour » qui, en effet, est dérivé de l’ancien français humor, et a donné « humeur »111. L’un, l’humour, n’est pas sans l’autre, l’humeur ; autrement dit, aucun humour n’est exempt d’humeur. Ainsi, l’humour relève-t-il nécessairement de l’humeur du sujet qui le pratique. Par suite, l’humour est toujours porté par l’humeur d’une monade, c’est-à-dire d’une conscience individuelle en tant qu’elle exprime une idée unique, selon la définition que donne Leibniz de son concept. C’en est la dimension subjective, spécifique et personnelle. Pour autant, il est relatif, c’est-à-dire rapporté à autre chose, car il dépend de ce sujet-là et de son art.
C’est pourquoi, l’humour est la marque d’un esprit dont la forme d’expression principale « s’attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité »112, en l’espèce de la dette publique ivoirienne. Et c’est uniquement dans les propos terre-à-terre de Laurent Gbagbo que s’exercent cet humour et son humeur par lesquels est dit ce qu’il y a de plus relevé dans le champ du langage.
Il s’agit d’un exercice de haut vol, quasi poétique en tant que poïésis : con-struction. Ainsi, pour faire saisir au peuple la gravité de la dette publique et le péril qu’elle fait peser sur le pays, il n’énonce pas une analyse macro-économique savante, ce qui serait rébarbatif et pédant, d’autant plus que sous sa gouvernance il avait mis en place un « budget sécurisé » qui empruntait beaucoup moins. En lieu et place, devant son auditoire, il use d’un seul mot par lequel il condense l’essentiel : « Digbha » (la danse du virtuose), là où, la plupart entendent « digba » (unité de mesure, grandeur). C’est une vraie et totale erreur de compréhension que de ramener son propos à l’une des sept unités de mesure113, en particulier l’unité de volume.
En revanche, force est d’y soupçonner et même d’y voir une influence stoïcienne, avec l’idée de proportion114 que sous-entend Laurent Gbagbo.
Les stoïciens exposent la proportion en ces termes :
« Ailleurs, la puissance et proprement la “capacité” de l’instant par l’idée de proportion. “Qu’on dessine un cercle plus grand ou plus petit, la différence concerne l’aire (spatium), non la forme… Or la forme est la même dans les deux cas. La rectitude ne se mesure ni par la grandeur, ni par le nombre, ni par le temps ; on ne peut pas plus l’étendre que la ramasser”. L’irréalité du temps vulgaire se prouve ici par le fait que l’on peut l’allonger ou le resserrer indéfiniment, sans toucher aux “mesures” propres à la perfection du bonheur
111 Le petit Larousse illustré, op. cit., p. 519.
112 Wikipédia, Humour.
113 Le Système international d’unités (SI) est un système décimal exception faite de la mesure du temps. Il compte 7 unités de base : le mètre (m), le kilogramme (kg), la seconde (s), l’ampère (A), le kelvin (K), la mole (mol) et le candela (cd). Abréviations : s « : seconde (temps), « kg » : kilogramme (masse), « mol » : mole (quantité de matière), « cd » : candela (intensité lumineuse), « K » : kelvin (température), « A » : ampère (intensité électrique) et « m » : mètre (longueur).
114 V. Goldschmidt, op. cit., p. 209.
23
présent ». Une méthode de réduction comparable servira à Bergson, reprenant une idée de Laplace et de Kant, à montrer l’irréalité du temps cosmique ; mais ce sera en faveur du temps de « l’attente ». La méthode stoïcienne, au contraire, réduit le temps de l’attente et le temps « vécu » à son expression mathématique (magnitudo) et oppose cette étendue, si grande ou si petite soit-elle, au présent achevé du bonheur qui, lui, n’est pas grandeur, mais qualité (qualitas). — Une autre comparaison essaie de détruire l’illusion du temps, c’est celle avec l’art de la miniature (μιϰροτεχνία) qui se rattache directement à l’idée de proportion : « C’est le propre d’un grand artiste d’avoir su enfermer le tout dans un espace insignifiant »115.
Certes, la dette publique dont il s’agit, est. Et chacun peut la constater. Aussi, qu’elle soit « digbha », « digba », moyenne ou petite, la dette reste une dette, selon le principe philosophique majeur de la forme définie comme qualité ou essence. Cette forme-là dont l’essence est une présence, Laurent Gbagbo ne la nie pas116. Il s’attaque plutôt à son digbha et digba, une fois de plus, par une seconde moquerie directe, qui prolonge la première. En effet, alors que son auditoire rit à se rompre avec le mot trouvé et tiré du vocabulaire béthé, il enchaîne aussitôt par une seconde moquerie qui fait perdurer la première, en retournant l’argument prêté à ses contradicteurs, dont il ne cite aucun :
« Il y a des gens qui me disent, oui, mais, les États-Unis sont trop endettés. Je dis, ah bon, tu veux comparer la Côte d’Ivoire aux États-Unis ? Eh bien, je te souhaite bonne chance. Parce que, comparer la Côte d’Ivoire aux États-Unis, c’est comme comparer le margouillat et l’éléphant […] C’est pourquoi en politique, plus que partout, comparaison n’est pas raison […] La Côte d’Ivoire ce n’est pas les États-Unis […] Quand je parle de la digba-dette, parce que c’est une dette digba […], il y en a qui me disent que les États-Unis sont endettés, eeehhh. Tu n’enlèves pas ta bouche là-bas, ahhh, il faut enlever ta bouche, sinon ce qui va tomber sur toi… »117.
On le voit, cette approche orale reprend l’idée de proportion telle que définie par les stoïciens. Ce n’est donc pas la forme (existence, qualité) de la dette ivoirienne qui, au premier chef, lui importe. Ce sur quoi, en l’occurrence, Laurent Gbagbo insiste tout spécialement c’est la proportion de cette dette, ou plus exactement, la proportion érigée en dette ; conception qu’il met au jour par l’absurdité de la comparaison entre deux pays. L’un grand, dont le bras ne peut être tordu, puisque rien ne peut lui être opposé, pas même la proportion stoïcienne. Car, quand bien même sa dette serait digba, elle n’est pas digbha. Elle ne relève pas de la virtuosité. L’autre petit, fragile et sur lequel des gens « sont assis et peuvent fumer un cigare ».
Une fois de plus, le locuteur utilise et s’exprime à l’aide d’images compréhensives qui arrachent l’hilarité de son public. Ainsi, bien plus que la forme (qualité : ce qui fait qu’une dette est une dette) de la dette, c’est maintenant la proportion de la dette ivoirienne qui devient présence, un « présent temporel ». Si c’est là une pensée stoïcienne, elle l’est encore plus stoïcienne par la virtuosité qui la fait advenir : l’acte par lequel une grande dette entre dans un petit pays. Là est la virtuosité que
115 V. Goldschmidt, op. cit., pages 208 à 209.
116 APAnews, Gbagbo dénonce l’envolée de la dette ivoirienne, 26 janvier 2025.
117 Actupeople, Laurent Gbagbo – L’histoire de la Digba dette qui a fait réagir Dagbo Godé-Et qui alimente les débats, YouTube.
24
Laurent Gbagbo moque, bien évidemment. Le virtuose est ici à l’image du grand artiste : C’est le propre d’un grand artiste d’avoir su enfermer le tout dans un espace insignifiant, pour reprendre la pensée stoïcienne.
Ainsi, à tous ceux qui, espécialistes en économie et en finance, entendent ou voudraient faire de la dette publique un incorporel, Laurent Gbagbo leur objecte, stoïquement, que c’est un corps.
Au fond, l’humour est chez lui l’exercice d’une série de « punchlines », une suite de phrases-chocs, de réelles percussions rythmiques. En plein discours, il ne traite pas ses contradicteurs de bouffons, mais emprunte au langage local et terre-à-terre un mot que tous connaissent bien : « On m’appelle Gbagbo Laurent, je ne sais pas s’ils sont au courant. Je ne sais pas s’ils sont au courant. C’est des gaous », pour dire qu’il n’y a rien de sérieux dans leurs attitudes.
La syntaxe structurale118 exposée par Georges Mounin pourrait servir à comprendre la stylistique119 de Laurent Gbagbo. Mais laissons aux linguistes, en particulier ivoiriens, le soin de tels travaux.
XII.
Le rire de Laurent Gbagbo
En tous les cas, chez Laurent Gbagbo, l’humour par humeur maximale, est la surface d’une double réalité qui, bien plus profonde, n’a pas encore été mise au jour. Tout d’abord, comme chacun peut le constater, Laurent Gbagbo n’est pas un pince-sans-rire120, à la manière des humoristes Léonard Groguhet, Raymond Devos ou Fernand Raynaud qui font rire leur public, mais sans eux-mêmes rire. Louis Jouvet121 à l’humour ravageur l’était. Laurent Gbagbo, lui, rit de ses propres paroles, tout autant que son auditoire.
Pourquoi rit-il et fait-il rire tous ses allocuteurs ? Au reste, il n’y a pas d’antériorité ivoirienne. Félix Houphouët-Boigny ne riait quasiment pas et n’esquissait que des sourires. Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, fort peu. Mais ce n’est pas parce que l’humour est humeur que Laurent Gbagbo rit.
Autrement dit, que cacherait son rire ? Tout d’abord, que ne rappelle-t-il celui célèbre de Démocrite d’Abdère122, sur lequel tant de commentaires ont été faits ! Aussi, comment ne pas s’étonner que les philosophes ivoiriens n’aient pas établi de similitude entre les deux rires ? Or, c’est dans cette filiation intellectuelle que Laurent Gbagbo semble s’inscrire. Il ne rit pas au hasard ou en raison de sa propre humeur.
Mais avant d’en venir au rire de Démocrite, écartons celui d’un autre philosophe de renom, Chrysippe, « le représentant le plus considérable de l’ancien stoïcisme »123, à propos duquel une belle rumeur, peu probable, a donné son rire ou fou rire comme la cause de sa mort. En effet, après une plaisanterie relative à l’âne qui avait dévoré ses figues, il demanda à la propriétaire de l’équidé de lui proposer du
118 Georges Mounin, Clefs pour la linguistique, pages 109 à 147.
119 Georges Mounin, op. cit., pages 149 à 166.
120 Le pince-sans-rire est une personne qui fait rire, pendant que lui ne rit pas.
121 Louis Jouvet (1887 – 1951), l’un des plus grands acteurs du cinéma et du théâtre français, reste la figure même du pince-sans-rire.
122 Démocrite d’Abdère, philosophe grec né en 460 av. J.-C., à Abdère (Thrace, Grèce) et mort en 370 av. J.-C.
123 E. Bréhier, op. cit., p. 3. Hegel : « Il en est toutefois un qui se distingua davantage sur le plan scientifique : Chrysippe, de Cilicie, né ol. 125, I (474 a.u.c. ; 280 av. J.-C.) a, qui vécut également à Athènes, et fut disciple de Cléanthe. Il est avant tout celui qui a le plus contribué au développement et à l’extension de la philosophie stoïcienne dans ses multiples aspects », La Philosophie stoïcienne, in Leçons sur l’histoire de la philosophie, tome 4, La philosophie grecque, coll. Bibliothèque des textes philosophiques, Éditions Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 1975, p. 642.
25
vin à boire, pour faciliter sa digestion. Il rit tant de sa raillerie qu’il en mourut. Le rire de Laurent Gbagbo ne se rattache pas à celui de Chrysippe le stoïcien.
Mais qu’est-ce qui arrachait à Démocrite son rire ? C’est le panorama du monde, avec son spectacle de futilités, sa cohorte longue de vanités, sa panoplie d’absurdités, toutes les faiblesses humaines (cupidité, chair, vices, etc.), l’ignorance triomphante érigée en savoir, la chrématistique, les tricheries et autres combines, les comédies quotidiennes et leurs enfantillages. Son rire est donc l’expression d’une représentation critique du monde opposée à sa conception matérialiste qui conçoit l’univers comme un assemblage continu/discontinu d’atomes (entités indivisibles) et de vide (condition de possibilité de mouvement des atomes).
Lorsque Laurent Gbagbo rit, il est dans le même registre. Il rit du monde créé par ses adversaires et qui, selon lui, leur sera finalement fatal : « mais où est Sarkozy ? Il a plein de chaînes… », pour dire et rire, en son « langage intermédiaire que tout le monde entend » : il est dans (au-dedans de) maints procès et porte un bracelet électronique. Ironie cruelle, pense-t-il : l’un, lui, est acquitté, par un haut tribunal international, l’autre est condamné, par un tribunal national, et le sera sans doute encore !
Toutefois, chez Démocrite, il n’y a pas que le rire qui put l’intéresser. Autre chose, tout aussi décisif pourrait le lier à ce penseur grec : le patronyme du penseur, susceptible d’indiquer une éventuelle parenté intellectuelle. Démocrite d’Abdère. Le nom est Démocrite, Abdère indique la ville d’origine.
Alors, que nous dit en propre le nom Démocrite, en ce qu’il signifie ? Dans la langue grecque, le nom Dêmókritos, Dêmó-kritos, signifie : « choisi par le peuple » ou le « choix du peuple ». Selon notre façon d’entendre le kritein grec, empruntée au professeur Toussaint Desanti, nous traduirons : « trié, par le peuple ». Les noms124 et les prénoms125 ont leur secret. En d’autres termes, le rire de Laurent Gbagbo ne cacherait-il pas un pli, dans lequel se logerait une autre relation avec Dêmókritos, Dêmó-kritos, lui qui a toujours revendiqué être le fils des élections, c’est-à-dire « choisi par le peuple », trié par le peuple ? Le parallèle n’a rien d’imaginaire.
Mais, soyons, nous aussi, prosaïques, pour reprendre le fil du « langage terre-à-terre » de Laurent Gbagbo. Après les « gaous », un autre phonème (morphème) : « trouillette ». Là, de nouveau, Laurent Gbagbo fait usage d’une représentation sensible.
XIII.
Alors, qu’est-ce donc cela « la trouillette » ?
Il faut savoir écouter et décoder les mots que Laurent Gbagbo emploie, ceux qu’il invente de façon spontanée ou réfléchie ou dont il détourne le sens originaire, surtout lorsqu’ils soulèvent des rires. Ainsi, parlant de « la trouille » du Gouvernement ivoirien, il lance un mot nouveau : « la trouillette » qui, en première intention, peut s’entendre comme une « petite trouille », parce que l’affixe « ette », féminin de l’affixe « et », en français, a pour fonction langagière de désigner la forme plus petite d’un nom, d’un mot, d’un objet, d’un phénomène. C’est une chose, mais en bien plus petit, donc une réduction de dimension. Une « trouillette » ! Il lance le mot en riant de sa signification. D’aucuns ont cru à un néologisme.
124 Jean-Louis Beaucarnot, Les noms de famille et leurs secrets, coll. Le grand livre du mois, Éditions Robert Laffont, Paris, 1988.
125 Jean-Louis Beaucarnot, Les prénoms et leurs secrets, Éditions du Club France Loisirs, Éditions Denoël, paris, 1990.
26
Mais, parlant de trouillette, ne renvoie-t-il pas aussi à autre chose qu’à la dimension réduite de « la trouille », fût-elle petite ? Car, au vrai, le mot existe déjà dans le lexique français. Il ne l’invente donc pas, mais plutôt en détourne l’usage initialement géographique (hydrographique, spéléologique) pour l’utiliser comme un nouvel élément de langage politique.
Une trouillette, en effet, désigne une exsurgence (du latin surgere : « se lever »), c’est-à-dire l’endroit de sortie d’eaux de pluies infiltrées ou de cours d’eau souterrains. C’est une source visible à l’endroit de son ouverture.
Ainsi les géographes parlent-ils, en France, de La Trouillette à propos de l’exsurgence des Avalanches (source de la Volferine, à Champfromier, commune du département de l’Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes), qui est alternativement à sec et en crue déferlante. Le mot désigne aussi Le Gouffre de Fontaine-de-Vaucluse (entre Le Luberon et le Mont Ventoux).
Dès lors, que veut exactement dire ou peut-être laisser sous-entendre Laurent Gbagbo, lorsqu’il parle de « trouillette » ? Première hypothèse : ne songe-t-il qu’à une sorte de peur « petite », une auto peur-ette gouvernementale paralysante, au sens où François Villon, vieux poète français, dit de lui-même : « Ce faisant je “m’entroubliai”, mon esprit [étant] comme lié »126 ? Cette hypothèse offre un réel intérêt interprétatif. En effet, si nous anticipons l’appartenance de Laurent Gbagbo à l’école stoïcienne, alors la trouille et (sa petite soeur) la trouillette n’exprimeraient que cette « trouille », ce trouble de l’âme dont parle Épictète et que tout stoïcien doit nécessairement vaincre. Cette finalité (télos) est le premier exercice pratique qui, par soi-même, tend vers elle-même comme but ultime du devoir éthique par excellence. Une « trouille » et une « trouillette » ne sont possibles et ne deviennent effectives que lorsqu’il y a une déstabilisation de « la partie hégémonique »127 de l’âme, qui, dès lors, n’est plus à même de maîtriser les représentations128 de l’objet (le corps) de sa frayeur. En dernière instance, cette victoire sur « la trouille » repose sur la doctrine fondamentale de la distinction entre la Prohairesis, tout « ce qui dépend de nous », en propre notre liberté dont l’exercice conduit à « la
126 François Villon : « Ce faisant, je m’entroublié, non pas par force de vin boire, Mon esperit comme lié. Lors je sentis dame Mémoire / Reprendre et mettre en son aumoire / Ses especes collateralles, / Oppinative faulce et voire, / Et autres intellectualles », Le Lais, XXXVI, in OEuvres, Avec la traduction en Français moderne par André Lanly, Éditions « ’Radouga », Moscou, 1984, p. 77.
127 V. Goldschmidt : « La psychologie […] confirme la cosmologie. Le principe hégémonique est en nous comme Dieu dans le corps de l’univers. Comme Dieu, il est cause, tout en restant lui-même, de deux séries d’effets différentes. D’une part, “notre âme est un souffle naturel et continu, parcourant le corps tout entier”. Localisé dans le coeur, le principe hégémonique s’étend à travers les sept autres parties du corps, comme à travers autant “d’organes naturels, comparables aux tentacules du polype”. Cette série unifiée des huit “parties” de l’âme, de ses “puissances et facultés”, correspond, dans l’univers, à la série des causes parfaites. Ces causes, d’autre part, vont agir et produire des effets, non seulement dans l’âme même (pensée, désir, colère), mais encore en dehors d’elle, jusqu’aux actes les plus extérieurs (se promener, s’asseoir). Voilà la série des événements. Mais dire cela, c’est dépasser l’analogie, instituée entre la psychologie et la physique, vers une participation. La série des événements est soumise à la loi du destin. Les événements que suscite l’âme ne peuvent se considérer en dehors de l’enchaînement universel des causes. À leur tour, les activités de l’âme ont-elles-mêmes d’autres événements pour causes prochaines et antécédentes. Ces antécédents, donnés à l’âme sous forme de représentations, sont assimilées par elle et reçues dans son intimité par l’assentiment. De l’acte qui s’ensuit, l’âme sera cause parfaite ; l’acte sera sa “manière d’être” où l’âme sera aussi totalement présente qu’elle l’est dans l’une quelconque des sept “parties” que parcourt le pneuma hégémonique », op. cit., pages 107 à 108. Par principe hégémonique, il faut entendre la partie directrice de l’âme qui, en outre, unifie et tient en cohésion les sept autres parties.
128 Pour les stoïciens, ce sont les représentations qui sont les causes des troubles. Épictète : « Voilà le véritable athlète, celui qui s’exerce lui-même contre de telles représentations. Tiens bon, malheureux, ne te laisse pas captiver. Le combat est grand, l’oeuvre est divine ; c’est pour un royaume, pour la liberté, pour le bonheur, pour la paix. Souviens-toi de Dieu, invoque son aide et son soutien, comme les navigateurs, dans la tempête, invoquent les Dioscures. Car, quelle tempête plus grande que la tempête suscitée par des représentations puissantes et qui excluent la raison ? Et cette tempête elle-même, qu’est-elle d’autre qu’une représentation ? Ainsi, supprime la crainte de la mort et amène tous les tonnerres et tous les éclairs qu’il te plaira, tu verras combien grande est la tranquillité et la sérénité de la partie maîtresse de ton âme. Mais si vaincue une fois, tu dis que tu seras vainqueur une autre fois, et si cela recommence encore, sache-le bien, tu trouveras finalement en un tel état de misère et de faiblesse qu’il te sera impossible de te rende même compte de ta faute, mais tu commenceras aussi à fournir des excuses pour justifier ton action. Et dès lors tu confirmeras la vérité de cette parole d’Hésiode : « L’Homme qui ajourne son travail, à chaque fois porte un défi aux désastres », op. cit., p. 153.
27
tranquillité » de l’esprit, et la Dihairesis, tout « ce qui ne dépend pas de nous », et appelé « le destin », face auquel nous ne pouvons rien, sinon seulement l’accepter ? « La paix de l’âme » des stoïciens, l’ataraxie, l’ἀταραξία signifie « absence de troubles », de toute trouille et à plus forte de toute « trouill-ette », voilà ce qui aurait échappé au Gouvernement dont il parle. La « trouillette » serait alors une critique stoïcienne de l’adversaire.
En tous les cas, nous le verrons plus loin, le stoïcien a le devoir de ne s’en tenir qu’au présent, seul temps réel, parce qu’il est théorisé par la plupart des philosophes, depuis l’Antiquité, par exemple, Platon, les Stoïciens et les Épicuriens, que l’avenir est la source vice de la crainte, du souci, du trouble, de l’agitation et de l’espérance129.
Deuxième hypothèse : Laurent Gbagbo annoncerait-il plutôt une « crue » à venir, autrement dit le lieu (ouvert) d’une sortie des cours d’eaux souterraines, le « se lever » d’une marée depuis une source de colère, parce que, dit Épictète : « il n’y a d’intolérable que ce qui est contraire à la raison » ? Dans ce cas de figure, la colère serait (re) passée du côté de la raison et la trouille et la trouillette du côté de l’irrationnel.
L’herméneutique a permis de mettre au jour la dimension géographique du mot trouillette, qui n’est pas sans revêtir un aspect hypocoristique (intention affectueuse), d’où les éclats de rire affectueux de Laurent Gbagbo lui-même. Au fond, ce qu’il veut dire est ceci : qui donc arrêtera la vague « si » jamais elle se lève ou lorsqu’elle se lèvera depuis sa source ? Et, de quelle façon, par la force (police, gendarmerie, civils, etc.), ou par une nouvelle et inopportune intervention de l’armée française ou encore par le dialogue (politique et social) ? À bon entendeur, salut ! Mais combien est-il difficile, parfois même pénible d’être simplement bon entendeur, car « les oreilles peu profondes débordent vite », avertit Rilke.
Troisième hypothèse : Laurent Gbagbo médite et conjugue, simultanément, les deux phénomènes, auquel cas, la première, qui est d’ordre psychologique (la peur), servirait, par figure de « style » oratoire (technique littéraire), à voiler la force du projet et à renforcer ainsi la conséquence de la deuxième hypothèse qui, elle, nous l’avons vu, est d’ordre hydrographique : la marée montante qui prendra pacifiquement les rues. Nous sommes en présence d’un second cas de « substitution ».
En résumé, passé au tour, il saute aux yeux que les trois hypothèses forment une totalité théorique en pleine cohérence de signification.
On le voit bien, lorsqu’il prend la parole, Laurent Gbagbo passe continument, sans le dire, d’un registre à un autre, d’un type de langage à un autre : avec la digbha dette, il glisse subrepticement de l’économie à l’art (la danse) ; avec la trouillette, par « substitution », il procède à un savant amalgame entre le psychologique (la peur) et l’hydrographique (géographique), passant furtivement de l’un à l’autre et alternativement.
Il ressort des considérations précédentes deux faits linguistiques structurants et d’importance. Tout d’abord, chez Laurent Gbagbo, contrairement aux apparences, le langage châtié commande toujours au langage terre-à-terre auquel il fournit, simultanément ou après coup, sa signification authentique et dont les dimensions à la fois désopilante, humoristique et délassante sont l’habillage. Ensuite, et ce point est une typique de la conception du temps chez les stoïciens, les intervalles qu’il créé ou place
129 V. Goldschmidt, op. cit., pages 171 à 173.
28
constamment entre ses phrases, comme s’il les construisait au moment même où il parle, sont suscités par le passage (traduction intérieure et automatique) du langage châtié au langage terre-à-terre ou au langage intermédiaire ou encore inversement.
Ainsi, ses détracteurs qui, en guise de raillerie, disent qu’il a l’esprit terre-à-terre ne savent et ne croient pas si bien dire, sauf qu’ils ne savent pas eux-mêmes le sens des mots qu’ils emploient. Ils ont tort de n’y voir que platitude de langage. Car la locution « terre-à-terre » vaut, également et parfois, comme un réel « compliment » et une qualité, lorsqu’elle est par exemple objectée aux propos d’un rêveur ou à la pratique d’un individu « hors sol », c’est-à-dire qui ne tient pas compte de la réalité. Le terre-à-terre est aux antipodes du hors sol. Entre les deux contraires, un choix se pose.
Nous pourrions ajouter maints autres exemples relatifs à ce langage terre-à-terre. Mais le suivant suffira, celui de la salutation quotidienne appelée le « gbô » qui, popularisée par Laurent Gbagbo et puisée dans le langage nouchi, ne manque pas de faire songer au geste de l’assentiment130 par lequel les stoïciens donnaient leur accord ou leur approbation à une chose, « en fermant le poing » à titre de monstration directe.
Il est impossible que le « Cicéron ivoirien » n’ait jamais entendu parler ou ne sache pas ce qu’est ce geste d’approbation typique des stoïciens. Tous les spécialistes de cette doctrine l’enseignent. Ainsi la formule « donne-moi ton gbô »131 ne peut pas seulement valoir comme un acte de salutation voire d’urbanités, mais aussi et surtout, quoique personne ne le souligne, comme la marque d’un accord donné ou d’un consentement : « mon gaza, prends mon gbô ! On dit quoi ? »132. Lorsque ce gbô est pris et, par suite, accepté, il est rendu, alors la rencontre des deux gbô ressemble à l’assentiment stoïcien, mais redoublé (comme dirait Kierkegaard), bien évidemment sous une forme édulcorée, déformée, banalisée, qui souligne la tranquillité d’esprit des deux individus, sans pour autant être un acte de connaissance philosophique à part entière133. L’assentiment devient acte de politesse. Le double gbô ou le gbô « redoublé » est un geste d’acceptation qui va au-delà du « bonjour, comment allez-vous ? ».
130 Paul Ricoeur : « On doit aux stoïciens d’avoir ajouté un troisième trait à la philosophie grecque de l’opinion ; ce troisième trait devait conduire de façon décisive à la philosophie moderne (cartésienne, humienne, kantienne) du jugement. C’est d’une tout autre distribution des notions que cette dernière procède, à savoir d’une véritable analyse psychologique de l’opération en quoi consiste la saisie (katalepsis) ou appréhension des choses qui se décompose en deux termes dont l’un est “reçu” : l’image, la représentation (phantasia) ; et l’autre, une véritable action : l’“assentiment” (sunkatathesis).
Cicéron, qui latinise les notions stoïciennes et ainsi les rapproche de nous et des champs sémantiques qui sont ceux des langues latines, rend compte de cette opposition en distinguant le visum (l’être vu, inerte, sans force propre) et la fides (Académiques, XI, 40) ; ce second terme intéresse notre enquête, car il souligne le caractère de confiance, de crédit, de créance par lequel nous “adjoignons” notre acceptation, notre “approbation”, à ce qui n’est qu’une impulsion à croire : la fides est donc un acte volontaire qui dépend de nous, un accueil, une acceptation que nous pouvons refuser, “suspendre” (épochè), quand cet assentiment nous fait consentir aux passions mauvaises ; ainsi, grâce aux stoïciens, la notion d’assentiment est introduite dans la sphère de la croyance », L’assentiment, in Croyance, Universalis.
131 Le Gbô, formule typique du parler Nouchi, signifie : « salue-moi, [c’est un] signe de salutation qui marque le respect dans les ghettos ivoiriens. C’est un croisement de poings (face à face), http://www.nouchi.com/dico/liste-des-derniers-mots/item/gbo.html
132 La formule se traduit : « mon gars, prends mon poing serré, donne-moi le tien. Comment vas-tu ? ou quelles sont les nouvelles ? ».
133 V. Goldschmidt : « C’est l’objet présent (ὑπόϰειται͵ τὁ ὑτάρχον) qui produit (τὁ πεποιηϰός) la représentation et, par là, agit sur l’âme (s’y « imprime » ou l’« altère »). À cette affection (πάθοσ) passivement subie, l’âme donne son assentiment et, ainsi, obtient la compréhension de l’objet. Recevoir des représentations ne dépend pas de la volonté… leur donner l’assentiment, cela dépend de celui qui les reçoit ; mais l’assentiment ne se fonde sur aucune « délibération » (βουλεύεσθαι). « Car, de même que le plateau d’une balance s’incline nécessairement, quand on le charge d’un poids, de même l’âme cède à l’évidence ; de même qu’un être ne peut pas ne pas se porter au-devant de ce qui convient à sa nature (un tel objet, les Grecs l’appellent οἰϰεĩον), il ne peut pas ne pas donner son assentiment à une chose qui s’offre à lui avec évidence », op. cit., pages 113 à 114.
29
Et il ne vaut rien de voir ou de trouver une sorte d’exagération dans notre propos. Cela reviendrait à oublier que, pour les stoïciens, « l’assentiment est, à la fois, si nécessaire et si naturel qu’il a lieu également chez les animaux. Même chez l’homme, il peut être comparé à l’inclination naturelle de l’animal »134. Une fois de plus, en matière de « gbô », Laurent Gbagbo use de façon adéquate de son inouïe capacité de transposition ou de « substitution » (psychanalyse), dans son langage terre-à-terre.
Au fond, chez le « Cicéron ivoirien », cette technê, ce savoir-faire langagier, est mis à profit. On l’aura compris, il s’agit d’une équivalence culturelle entre un usage cognitif de l’assentiment propre à une école philosophique gréco-latine et un usage du savoir-vivre populaire ivoirien. C’est la traduction empirique d’une pratique. « L’assentiment » stoïcien est traduit en (langage) nouchi et, inversement et au même moment, le « gbô » ivoirien traduit le geste stoïcien.
En tous les cas, l’indication relative au trilinguisme et au cursus scolaire de Laurent Gbagbo, s’ils signalent son enracinement dans le répertoire des langues romanes et son indéniable ancrage dans la culture populaire ivoirienne, est bien loin d’être anodine. Elle met en exergue sa culture classique, elle laisse penser qu’il a dû lire Épictète ou, à tout le moins, entendu parler de ses principales idées morales.
XIV.
« Le paradoxe du crocodile » ou « le paradoxe du menteur »
Lors d’un entretien accordé à France 24, en octobre 2010, Laurent Gbagbo s’est fendu d’un jugement qui, à l’époque, fit grand bruit. Il dira :
— Mais Alassane Ouattara est un menteur, et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs. Il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbroufe. C’est parce qu’il est menteur qu’il n’a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993.
–
Le mot est fort, menteur, reprend le journaliste.
–
Le mot n’est pas fort, c’est ce qu’il est, c’est la description ».
Cette parole, bien évidemment, engage la responsabilité de son auteur et non celle de l’interprète. Au reste, Alassane Ouattara a renvoyé le jugement, en parlant des « mensonges » de Laurent Gbagbo. Et, si la bienséance philosophique, les urbanités comme dit Hegel, eut voulu que nous n’interprétions pas cette parole, rappelons que, ici, il s’agit, d’une part, uniquement de philosophie, et, d’autre part, prenant appui dans ce domaine, d’en montrer l’origine et les racines stoïciennes qui, aussitôt, en dédramatise la signification qui n’est plus une insulte comme beaucoup ont pu le croire.
Dussions-nous le redire, pour comprendre certaines paroles de Laurent Gbagbo, il faut un tant soit peu connaître les idées et quelques anecdotes sur l’histoire du Stoïcisme. Les deux journalistes de France 24, manifestement, n’avaient pas cette connaissance pour saisir ce que voulut leur faire savoir leur interlocuteur. Qu’est-ce que celui-ci a-t-il voulu dire en employant le qualificatif « menteur » ?
134 V. Goldschmidt : « Cette comparaison même montre déjà que l’assentiment imposé et cependant volontaire, s’applique, non pas à un objet étranger qui nous envahirait, mais bien à quelque chose qui nous est approprié (οἰϰεĩον) : la perception de l’objet s’accompagne d’une “co-perception” (συναίσθησισ) de nous-mêmes qui permettra, plus tard, non seulement de saisir les choses, mais encore de les mettre en rapport avec nous, de les apprécier », op. cit., p. 115.
30
Au vrai, ce qu’il entend par ce mot ne se limite pas à son étymologie135 ou à sa signification ordinaire. Le qualificatif « menteur » ne doit pas être pris au premier degré, en son sens trivial ou vulgaire. En vérité, le mot ne dévoile la totalité de son sens, que lorsqu’il renvoyé à la théorie du menteur, un vieux thème philosophique que trois grands stoïciens ont chacun médité : Épictète, Chrysippe et surtout et Cicéron : « le paradoxe du menteur » également nommé « le paradoxe du crocodile ».
C’est au grec Épiménide de Cnossos ou de Phaestos (en Crète), auteur prolixe, à la fois « philosophe », poète, chamane et devin, cité par maints grands philosophes, législateurs et théologiens (Solon, Platon, Aristote, Diogène Laërce, saint Paul, Chrysippe, Épictète, Cicéron, Plutarque, Goethe, etc.), qu’a été attribué en premier comme auteur « le paradoxe du menteur », qui consiste en un énoncé : « Tous les Crétois sont menteurs ».
Le mot a connu une belle fortune littéraire et surtout philosophique (en logique et en éthique) où il n’a cessé de faire l’objet de développements approfondis, au point de valoir comme un des modèles de raisonnement. Pourquoi et comment ?
« Tous les Crétois sont menteurs » : si ce jugement est énoncé par un non-Crétois, il peut être ou bien « vrai », ou bien « faux », c’est-à-dire ou l’un ou l’autre, mais jamais les deux au même moment. C’est le principe de non-contradiction que l’on retrouvera totalement développé chez Aristote. Mais, dès lors qu’il est énoncé par un Crétois, ce qui est le cas d’Epiménide, il est aussitôt, à la fois, c’est-à-dire simultanément, en même temps, et « vrai » et « « faux ». C’est le principe de contradiction opposable et opposé au principe de non-contradiction. Car, si Épiménide dit vrai, alors lui-même ment et, en cela, il est un Crétois « menteur », ce qui confirme la vérité de sa parole. Mais, en confirmant ainsi son jugement, il dit vrai et le « vrai », et, par conséquent, il ne ment pas, ce qui fait de lui un Crétois non — « menteur » (ce) qui infirme totalement son énoncé qui alors dit vraiment et faussement le « faux ». Ainsi le mot fameux d’Épiménide synthétise-t-il contradictoirement les deux grands principes, les deux fondamentaux sur lesquels s’édifiera toute la pensée philosophique en matière de logique (les règles de la pensée droite) et dans le domaine de l’éthique (pourquoi et comment agir de manière droite ?).
Sous ce rapport, on peut considérer que Hegel a été le premier et peut-être le seul, parmi les grands philosophes occidentaux, à sursumer l’insolubilité du « paradoxe » (les insolubilia des scholastiques), en élaborant une méthode par et dans laquelle la contradiction et la non-contradiction sont devenues un seul principe : la théorie de l’unité (identité) et de la différence des contraires. Il a appelé cette méthode en reprenant un vieux mot jusqu’à lui tombée en désuétude : la dialectique, la méthode (μέθοδος, μεθόδων : cheminement) dont le principe fait de la contradiction précisément la non-contradiction et qui concevra avec audace toute l’histoire de l’activité humaine et de la philosophie.
Nous savons désormais, en quoi consistait, à l’origine, c’est-à-dire selon son premier énoncé, « le paradoxe du menteur ». Il est maintenant instructif de voir comment elle a été reçue et mise à profit par deux éminents stoïciens, non plus des Grecs, mais des Romains : Épictète et Cicéron, dont nous citerons pour chacun un long extrait. L’un et l’autre retiennent la forme du paradoxe, en l’expurgeant par, abs-traction, de son contexte crétois (lieu ou espace et ethnique) et en l’élevant au rang d’une
idée générale, c’est-à-dire universellement valable pour tous, partout (tous lieux), à chaque moment (tout temps). Le mot d’Épiménide a donc perdu son caractère spécifique et particulier, pour devenir universel. Ils l’ont placé au coeur de leur logique et de leur éthique.
D’abord, Épictète qui l’évoque lors d’un entretien dans lequel Le menteur est appelé le Trompeur :
« Mais je me suis déjà exercé à ce second thème. Ce que je désirais, c’était de l’acquérir d’une façon sûre, inébranlable, et cela non seulement quand je veille, mais quand je dors, quand j’ai bu et dans mes heures de mélancolie.
–
Homme, tu es un Dieu, tu as de grands desseins,
–
Non, mais : “Je veux savoir ce que dit Chrysippe dans ses dissertations sur ‘le Trompeur’.”
–
Va te faire pendre, toit et ton dessein, malheureux ! Et à quoi cela te servira-t-il ? Tu le liras d’un bout à l’autre en gémissant, et c’est en tremblant que tu le réciteras devant les autres. Voilà comment vous agissez vous aussi :
–
Veux-tu que je te fasse une lecture, mon frère, puis à ton tour tu m’en feras une.
–
Homme, tu écris d’une façon étonnante.
–
Et toi magnifiquement, dans le style de Xénophon.
–
Toi, dans celui de Platon.
–
Toi, dans celui d’Antisthène.
Et puis après vous être raconté mutuellement vos rêveries, vous retombez dans vos mêmes défauts : vous avez les mêmes désirs qu’auparavant, les mêmes aversions, les mêmes aspirations, vous avez les mêmes desseins et les mêmes projets, vous demandez les mêmes choses dans vos prières, vos préoccupations sont les mêmes. Et avec cela, loin de chercher un homme qui vous avertisse, vous vous irritez plutôt si vous venez à entendre ces avis. Vous dites alors : “Le vieillard au coeur dur ! Quand je suis parti, il n’a pas pleuré, il n’a pas dit : au-devant de quelles difficultés tu vas, mon fils ! Si tu restes sain et sauf, j’illuminerai.” C’est là le langage de l’homme affectueux ? Ce sera un grand bien pour un homme tel que toi de demeurer sain et sauf, et cela méritera bien qu’on illumine. Sûrement tu dois être immortel et immunisé contre la maladie !
Cette présomption, je le répète, qui nous fait croire que nous savons quelque chose d’utile, il faut la rejeter avant d’en venir à la philosophie, comme nous nous portons à l’étude de la géométrie ou de la musique, sans quoi nous serons très loin de faire le moindre progrès, même si nous parcourons toutes les introductions et tous les traités de Chrysippe, en y joignant ceux d’Antipater et d’Archédémos »136.
Ensuite, Cicéron : « selon le compte rendu de Diogène Laërce (Vitae Philosophorum VII), Chrysippe a écrit plus de dix traités sur le paradoxe du menteur (voir Section 2), mais aucun de ces travaux n’est parvenu jusqu’à nous »137. Or cette problématique du menteur nous intéresse ici au plus haut point, puisque son nom est devenu le surnom de Laurent Gbagbo et que nous pouvons supposer que ce
136 Épictète, Comment il faut adapter les prénotions aux cas particuliers, in Entretiens, Livre II, chapitre 17, Texte établi et traduit par Joseph Souilhé, avec la collaboration D’Amand Jagu, coll. Tel, Éditions Gallimard, Paris, Société d’édition Les belles Lettres, 1943 pour le livre I, 1949, pour le livre II, 1990, pour le livre III et 1991 pour le livre IV, p. 150.
137 Proietti Carlo, Origine du mot 1.1, Paradoxe (A), in Maxime Kristanek (dir.), l’Encyclopédie philosophique, avril 2018.
32
dernier le connaissait ou en avait entendu parler. Cicéron expose le paradoxe dans les termes suivants, dans un ouvrage dont le sous-titre est précisément Les paradoxes :
« Votre art ne vous est donc d’aucun secours contre les sorites, puisqu’il ne vous enseigne pas quel est, en augmentant, le premier point où l’on atteint à beaucoup, et, en diminuant, le dernier où l’on arrive à peu. Que dis-je ? De même que Pénélope défaisait sa toile, la dialectique détruit son ouvrage après l’avoir composé. Est-ce votre faute ou la nôtre ? Le fondement de la dialectique est que toute proposition (en grec [ἀξίωμα], en latin effatum) est vraie ou fausse. Eh bien, ce qui suit est-il vrai ou faux ? Si vous dites que vous mentez, et que ce soit vrai, vous mentez et vous dites la vérité. Ce sont, répondez-vous, choses inexplicables. Votre terme est plus dur que les nôtres : nous disons que ces choses ne sont ni comprises ni perçues.
XXX. Mais passons par là-dessus. Je vous le demande : si ces propositions ne peuvent être expliquées, s’il n’est aucun jugement qui vous mette à même de prononcer sur leur vérité ou leur fausseté, que devient votre définition : On entend par proposition ce qui est vrai ou faux ? Après avoir posé des prémisses, j’en déduirai des propositions, dont les unes seront admissibles et les autres inadmissibles, parce qu’elles seront opposées aux premières. Ainsi, que pensez-vous de cette conclusion : Si vous dites qu’il fait jour à présent, et que ce soit vrai, il s’en suit qu’il fait jour. Vous approuverez certainement ce genre d’argumentation, et la conséquence vous paraît très juste. Aussi cette forme est-elle la première que vous donnez dans votre enseignement. Vous approuverez donc toute conclusion déduite de la même manière, ou votre art est nul. Voyons donc si vous approuverez aussi cet argument : Si vous dites que vous mentez, et que ce soit vrai, vous mentez ; or, vous dites que vous mentez, et c’est vrai, donc vous mentez. Comment n’approuveriez-vous pas ce raisonnement, après avoir approuvé celui qui précède ? Ce sont là des objections de Chrysippe, et que Chrysippe n’a point réfutées. Que ferait-il en présence de cette conclusion : S’il fait jour, il fait jour ; or, il fait jour ; donc il fait jour ? Il l’adopterait sans doute. L’enchaînement même des propositions, quand vous avez admis les premières, vous force à admettre la dernière. En quoi le syllogisme précédent diffère-t-il de celui-ci : Si vous mentez, vous mentez ; or, vous mentez ; donc vous mentez ? Vous déclarez pourtant ne pouvoir ni approuver ni improuver cette conclusion. Pourquoi pouviez-vous plutôt admettre l’autre ? Si l’art, si les règles, si la méthode, si la force de l’argumentation ont quelque valeur, elle doit être la même dans les deux exemples »138.
138 Cicéron, Académiques I, Livre II, Les académiques des vrais biens et des vrais maux, Les paradoxes, in Oeuvres complètes de Cicéron, traduction de MM. Delcasso et Stiévenart et M. Périgaud et Louis Chevalier, soigneusement repris par M. J.-P. Charpentier, coll. Bibliothèque latine-française, Garnier Frères, Libraires-Éditeurs, Paris, 1872, pages 107 à 109. Le passage cité est précédé et introduit par le suivant qui en éclaire le sens et la portée : « Mais les sorites sont des arguments vicieux. Voulez-vous en éviter les atteintes, brisez-les, si vous pouvez ; car ils vous blesseront, si vous n’y prenez garde. On y a pris garde, dit Lucullus. Lorsqu’on fait marcher Chrysippe de question en question, et qu’on lui demande : Trois sont-ils peu ou beaucoup ? avant d’arriver à beaucoup, il juge à propos de se reposer, ce que les Grecs expriment par ἡσυχάϚειν. Goûtez le repos, répond Carnéade, et même ronflez ; je ne m’y oppose point. Qu’y gagnerez-vous ? Viendra quelqu’un qui vous réveillera et continuera à vous interroger de même : Si j’ajoute un au nombre après lequel vous vous êtes tû, serons-nous arrivés à beaucoup ? Vous irez encore en avant tant qu’il vous plaira. Mais pourquoi insister ? Vous avouez vous-mêmes ne pouvoir désigner le dernier degré pour arriver à peu, ni le premier pour atteindre à beaucoup. Ce genre d’incertitude s’étend si loin, que je ne vois rien qui puisse s’y soustraire.
33
Nous connaissons maintenant l’origine et la stoïcisation du « paradoxe du menteur », qui a fait l’objet d’une autre démonstration, non plus philosophique cette fois, mais par son adaptation populaire dans un conte animalier : « le paradoxe du crocodile ».
Chrysippe, qui en serait l’auteur, l’expose tel que nous le condensons : « un crocodile, qui a réussi à s’emparer de l’enfant d’une femme, lui pose une question dé-cisive : que vais-je faire de ton enfant ? Si tu réponds juste, je te le rends ; sinon, je le dévore. La mère médite et trouve la réponse juste : tu vas le dévorer. Le crocodile, selon son engagement, devrait le lui rendre. Mais s’il le faisait, alors il mentirait à sa propre nature. Le crocodile, et il ne peut en être autrement, suivra donc sa nature plutôt que sa parole. Tel est ce crocodile dont le paradoxe n’aura valu que le temps de sa propre apparence : le corps (la nature, la tendance animale du crocodile) l’emporte sur l’incorporel (la parole donnée).
Ainsi, dans son dicible (son « exprimable »), le crocodile « parle » en dialoguant avec la mère de sa victime : il ment par vérité et dit la vérité par le mensonge, dilemme logique dont il ne peut sortir. Car, disant vrai, il ne sait pas faire autre chose que mentir, et inversement. Sa proposition (phrase) est contradictoire et non contradictoire, tout autant que non-contradictoirement contradictoire, à l’infini, contradictoirement non contradictoire quelle que soit la manière dont elle est étudiée.
Après avoir rappelé ce qu’est le « paradoxe du menteur » dont « le paradoxe du crocodile » est une variation, revenons à Laurent Gbagbo. Le fait que Cicéron ait théorisé ce paradoxe suffit-il à prétendre qu’il en a eu connaissance ? Un indice, qui pourrait être anodin, en conforte la possibilité et oriente vers une réponse positive. C’est un mot, banal en apparence, que Laurent Gbagbo place à la fin de la séquence sur « le menteur » et qui est une référence stoïcienne, sérieuse, indubitable. À l’objection du journaliste selon lequel « le mot [menteur] est fort », il réplique aussitôt : « Le mot n’est pas fort, c’est ce qu’il est, c’est la description ».
Jusqu’ici, personne n’a remarqué et souligné l’importance de ce mot. Or, nous savons que, à la grande différence d’Aristote qui expose les choses (idées, réalités, etc.) par leur stricte définition (concepts), les stoïciens, eux, procèdent par la description, comme l’a si clairement montré et démontré Émile Bréhier139. Autrement dit, en recourant à la « description » (méthode descriptive) lorsqu’il parle d’un « menteur », Laurent Gbagbo utilise consciemment le principal mode d’exposé des stoïciens.
Ainsi, dans le même entretien, par l’effet cumulé du paradoxe du menteur et du crocodile (outils pédagogiques) ainsi que la description140 (élaboration d’une représentation), Laurent Gbagbo dévoile et signe, une fois de plus, sa parenté intellectuelle avec le Stoïcisme.
Aucun trait ne me blesse, dit Chrysippe : comme un conducteur habile, avant d’arriver au but, je retiendrai mes chevaux, et surtout s’ils se précipitent sur une pente inclinée. Je m’arrêterai donc au milieu de l’interrogatoire, et je cesserai de répondre à vos questions captieuses. Si vous avez à dire quelque chose de clair, et que vous ne répondiez point, vous êtes bien dédaigneux. Si vous n’avez rien à dire, c’est que vous ne percevez rien. Est-ce l’obscurité des idées qui vous force au silence ? D’accord ; mais vous prétendez ne pas avancer jusqu’aux idées obscures. Le point auquel vous vous arrêtez est donc clair. Votre but est-il seulement de ne pas répondre ? Cet expédient ne vous réussira point. Qu’importe à celui qui veut vous saisir, de vous enlacer silencieux ou parlant ? Enfin si, arrivé à neuf, par exemple, vous répondez sans hésitation que c’est encore peu, et si vous vous arrêtez sur dix, alors vous refusez votre assentiment à des choses certaines et très-claires, ce que vous ne me permettez pas pour des idées obscures. Votre art ne vous est donc d’aucun secours contre les sorites, puisqu’il ne vous enseigne pas quel est, en augmentant, le premier point où l’on atteint à beaucoup », op., cit., pages, 106 à 107.
C’est donc pour cela qu’ils le surnommèrent « Cicéron » ?
Et lui, de toute évidence, semble ne pas avoir oublié ses lectures stoïciennes de jeunesse. Sous ce rapport, un fait supplémentaire vient conforter l’idée précédente. Est-ce fortuit que ses condisciples universitaires le surnommèrent « Cicéron », pointant son goût pour la littérature de l’époque gréco-romaine et, on n’y prête nullement attention, son appartenance à l’école de pensée stoïcienne ? Il est souhaitable que ses condisciples commentent ce surnom à la fois hypocoristique et d’ordre cognitif.
En tous les cas, ce trilinguisme est au coeur d’un double malentendu qui perdure. D’abord, une équivoque entre Laurent Gbagbo et les philosophes ou les penseurs ivoiriens. En effet, si lui-même se garde d’expliquer sa filiation intellectuelle à la doctrine stoïcienne, à laquelle il ne fait que des allusions indirectes et de vagues références, compliquant ainsi la tâche d’interprétation, eux, tout autant, n’ont jamais su mettre au jour et saisir la dimension stoïcienne de sa culture personnelle et de sa pratique du politique. Les défauts d’explication pourrait-on dire sont doublement partagés. Ensuite, un quiproquo, entre Laurent Gbagbo et une fraction active de l’intelligentsia française (universitaires et médias) dont la croissante pauvreté intellectuelle141 a jusqu’ici empêché celle-ci de voir en quoi et combien il est, quant au fond, un stoïcien, un stoïcien de gauche en politique.
C’est que le rapport entre Laurent Gbagbo et l’intelligentsia française a toujours reposé sur une forte ambiguïté. Excipons ce qui est dit de deux exemples. En premier lieu, que Bernard Henri Levy n’ait pas apprécié Laurent Gbagbo et ait été prompt à le fustiger, cela se conçoit aisément, car il ne faut pas trop attendre de la médiocrité142 qui est d’autant plus entêtée qu’est grande chez elle la certitude de soi et l’arrogance des préjugés. Mais que, au plus fort de la crise ivoirienne, l’immense Roland Badinter ait refusé toute discussion avec Pierre Sané143, l’un et l’autre grand défenseur de droits de l’homme, qu’il ait fulminé emporté par une rage contre Laurent Gbagbo, montre à souhait combien la campagne médiatique d’intoxication a été efficace.
Et même, fait juridique quasiment inédit, que Laurent Gbagbo ait été acquitté par la Cour pénale internationale (CPI) avant même que ses avocats n’exposent sa défense, n’a pas appelé d’excuses ou de reconnaissance d’erreurs de Bernard-Henri Lévy, de Robert Badinter et de tant d’autres comme cette cohorte d’universitaires. Tous se sont tus, en particulier le vitrificateur et celui qui, dans l’ordre des palmes de fréquentabilité, décernait alors les titres. Nul mot. Le porte-clés de Jean-Pierre Dozon ne tinte plus. Il repose, rangé dans le fond d’un tiroir. Une belle unanimité qui n’honore pas la classe politique, intellectuelle et médiatique française, excepté les Communistes et le peuple français qui, depuis la Conférence de Berlin, ont constamment défendu les Africains. Mais, « n’est-ce pas ? », quand tout le monde se trompe, c’est que personne ne s’est trompé.
En tous les cas et tout d’abord, de façon succincte, nous avons rappelé la liberté de Laurent Gbagbo, liberté essentielle de nature stoïcienne, qui sera affichée dès son arrivée à La Haye. Cette liberté-là,
Ils recherchaient du (τί ἠν εἰναι) d’Aristote, le mot (εἰναι), voulant sans doute indiquer par (τί ἠν) le stable et le permanent. Ainsi la définition n’est pour eux que la collection de faits caractéristiques d’un être ; mais la raison intrinsèque de la liaison, l’essence échappent aux pises de la pensée logique », op. cit., p. 31. Sur le « descriptif » chez les stoïciens, V. Goldschmidt, op. cit., p. 72.
141 Sophie Coignard & Romain Gubert, L’oligarchie des incapables, coll J’ai lu, Éditions Michel Albin, Paris, 2012. Louis Chauvel, Les classes moyennes à la dérive, coll. La république des idées, Éditions Seuil, Paris, 2006. Pierre Franklin Tavares, La conspiration des médiocres, Amazon Éditions, 2017. Anne et Marine Rambach, Les nouveaux intellos précaires, coll. J’ai lu, Éditions Stock, Paris, 2009.
142 P. F. Tavares, La conspiration des médiocres, Ils ont pris le pouvoir partout en France, Éditions d’Orgemont, Paris, 2017.
143 Pierre Sané, fonctionnaire international reconnu. Il a été respectivement Secrétaire général d’Amnesty International (1992 –, 2001) puis Sous-directeur général des Sciences sociales et humaines de l’Unesco (2001 – 2010).
35
de nature ontologique, n’est donc pas d’ordre contractuel et, comme telle, ne se négocie pas. C’est cela la conception stoïcienne de la liberté qui prend racine dans « ce qui dépend de nous », de telle sorte qu’elle peut supporter sans gémir « ce qui ne dépend pas de nous », le destin. La prison, en autres, n’est vraiment rien, quand elle est le prix à payer de la liberté, car, dit Épictète « pour l’être raisonnable, il n’y a d’intolérable que ce qui est contraire à la raison, mais ce qui est raisonnable peut être supporté. Les coups ne sont pas par nature intolérables ». Dès lors, tout, même le pire, devient supportable pour un stoïcien. Le slogan d’Épictète est explicite : « Supporte et abstiens-toi » (Sustine et abstine). C’est pour cette raison que la tranquillité d’esprit, la fameuse ataraxie des stoïciens, aura prévalu tout le long du long procès de Laurent Gbagbo à La Haye : « On ira, dit-il, jusqu’au bout ». Ensuite, nous savons qu’il énonce des propositions de facture stoïcienne, mais jusqu’ici passées inaperçues. Puis, nous avons esquissé une analyse étymologique, freudienne et humoristique de deux mots, digbha et trouillette, tirés de son répertoire. Enfin, de cette sélection, nous avons saisi en sa signification réelle le rire de Laurent Gbagbo comme renvoyant au « rire de Démocrite ».
XVI.
Stoïcien socialiste ou socialiste stoïcien ?
De cet ensemble de faits, il se dégage une réelle appartenance ou à tout le moins une accointance forte avec le Stoïcisme, au point que même le projet sociétal prôné par Laurent Gbagbo, excepté « la justice sociale », emprunte volontiers plus à l’éthique des stoïciens qu’à l’analyse matérialiste de Marx, à l’individualisme forcené de Proudhon ou au paternalisme vigoureux de Fourrier.
Il peut sembler que Laurent Gbagbo soit plus un stoïcien socialiste qu’un socialiste stoïcien.
C’est ce point qu’il s’agit de consolider en menant, après l’examen du langage, celui du « temps » tel que perçu par Laurent Gbagbo est vécu à la façon des stoïciens.
Est-il possible que le « Cicéron ivoirien » n’ait pas lu Épictète, le plus illustre des stoïciens et, entre autres, Chrysippe, Sénèque et Marc-Aurèle ? Dans son ouvrage, Les Stoïciens : Cléanthe, Diogène Laërce, Plutarque, Cicéron, Sénèque, Épictète, Marc-Aurèle144, Émile Bréhier montre les filiations intellectuelles entre ces grands penseurs.
Cependant, aussi suggestifs soient-ils, ces deux indices n’assurent pas ni ne garantissent encore le fait que Laurent Gbagbo ait lu des livres ou suivi des cours sur Épictète. Alors, sur quoi se fonde notre affirmation ? Ce qui mène le « Cicéron » ivoirien au philosophe gréco-latin, on en trouve trace dans trois notions auxquelles il fait référence constante, mais traduit en langage local avec un art reconnu dont lui seul a le secret : la raison, le temps et la dignité personnelle, qui sont au coeur de la pensée d’Épictète.
La raison stoïcienne devient, chez lui, ce que nous appelons la « raison démocratique » ou raison pratique, au sens où la démocratie, démo-cratie, dêmó-kratia145 n’est entendue que comme « choix du peuple » ; la dignité personnelle stoïcienne en tant que valeur axiale à laquelle il ne peut déroger.
En dépit de tout l’intérêt immédiat qu’offre l’étude des notions de raison et de dignité personnelle146 chez le « Cicéron ivoirien », nous allons porter notre attention sur son idée du temps. Victor Goldschmidt a mis au jour l’importance de la théorie du Temps dans le système stoïcien147.
XVII.
« Le temps » chez les stoïciens, « l’autre nom de Dieu », « le second nom de Dieu »
On entend souvent dire, à propos des injustices subies par Laurent Gbagbo, le mot suivant : « le temps est l’autre nom de Dieu » ; parce que, contre toute attente, après leurs exploits, ses « ennemis » finissent presque toujours dans des difficultés, quand lui s’en sort indemne ou auréolé.
Mais, comment entendre le mot ? Car, à écouter l’affirmation et plus encore à y réfléchir, l’idée qu’elle affiche suspend l’attention, dans la mesure où, dans tous les textes philosophiques, les écrits sacrés et les publications théologiques, Dieu est toujours strictement identifié à l’éternité ; c’est donc cette notion qui, en principe, devrait être son « second » nom, en lieu et place du « temps ». Au vrai, dans toutes ces doctrines métaphysiques, chez Héraclite, Platon, Aristote, les Stoïciens ou Kierkegaard, c’est toujours l’éternité qui accorde et dispense le temps, et jamais l’inverse. En effet, dans toutes ces pensées, à quelques nuances matérialistes près, l’éternité n’est jamais « située » dans le temps. Mieux, toutes plaident la thèse inverse. Ainsi, le rapport du temps et de l’éternité reste-t-il, même à notre époque, l’un des plus complexes, comme l’a si bien thématisé Jean-Louis Vieillard-Baron148.
Alors, en affirmant que « le temps est l’autre nom de Dieu », ceux qui ont lancé la formule voulurent-ils simplement défendre l’idée de Platon selon laquelle « le temps est l’image mobile de l’éternité »149 ou soutenaient-ils la thèse paradoxale du « temps éternel », ou encore reprenaient-ils spontanément et sans vraiment le savoir la conception du « temps total »150 de Chrysippe le stoïcien ? À moins qu’ils
146 Nous consacrerons un autre article à ces deux thèmes chez Laurent Gbagbo.
147 V. Goldschmidt considère que l’idée de temps est au centre du système stoïcien : « Ces études débordent le problème du temps chez les stoïciens, sans toutefois viser à un exposé intégral de leur système. Elles se proposent uniquement d’établir que ce problème, en apparence modeste, permet d’éclairer, et même commande l’ensemble du système.
Au premier abord, en effet, la théorie du temps se présente comme une simple section d’un chapitre de la Physique, celui qui traite des Incorporels. Mais déjà la seule interprétation des quelques textes qui nous l’ont transmise, fait voir que cette théorie ne saurait, dans l’ensemble de la doctrine, être découpée à la hache ; elle tient étroitement à d’autres théories, comme celle des incorporels en général, des catégories, de la substance. Abordant ensuite les thèses majeures de la logique et de l’éthique, on s’aperçoit qu’à leur tour elles sont solidaires de la conception du temps qui, dans bien des cas, fait évanouir leur apparence de paradoxe. À cela même, il n’y a rien d’étrange, si l’on se souvient que le stoïcisme, plus que tout autre philosophie antique, constitue un système cohérent. Mais plus particulièrement, le problème du temps a dû former comme le noeud de la réflexion stoïcienne qui vise, contre les lourdes autorités de Platon et d’Aristote, à rétablir dans sa réalité et dans sa dignité, le concret, le sensible, disqualifié comme “sujet à la génération et à la corruption”, c’est-à-dire, en un mot, comme “l’être dans le temps”. Une telle tentation exigeait, et cela à tous les niveaux du système, non seulement une revalorisation, mais une totale refonte de l’idée même de temps », op. cit. p. 5.
148 Jean-Louis Vieillard-Baron : « L’élucidation des concepts nécessaires à la compréhension du problème du temps est une tâche difficile. En effet, trop souvent, on a bloqué la question sur les rapports du temps à l’éternité. Or le concept d’éternité est fuyant comme un mirage philosophique : peut-on en toute rigueur substantialiser ce qui est présent chez l’homme sous la forme du désir d’éternité ? Échapper au temps qui fuit, arrêter le temps, sont des sentiments humains permanents : mais l’éternité n’y apparaît que comme le contraire du temps. Or l’ide de durée est précisément celle d’un temps qui ne fuit pas, mais qui est plénitude. Dès lors, le concept d’éternité apparaît dans sa vérité, un concept mal défini, mal délimité, et en tous cas secondaire par rapport à celui du temps.
Trop souvent aussi, on a confondu le temps et le devenir, le temps et l’histoire. C’est ici que la confrontation entre Platon et Hegel est indispensable : pour Platon, le temps qui fuit est le temps des choses, la génesis, alors que le temps qui dure accède à la pensée sous la forme de “l’image mobile de l’éternité”. Contrairement à l’idée répandue, Platon a tenté de penser le temps, mais en écartant le temps des choses et le temps vécu », Le Temps,
150 V. Goldschmidt : « Chrysippe définit le temps : intervalle du mouvement, au sens où on l’appelle parfois mesure de la rapidité et de la lenteur ; ou encore : l’intervalle accompagnant le mouvement du monde ; et c’est dans le temps, que toutes choses se meuvent et existent. Toutefois, le temps se prend dans deux acceptions, ainsi que la terre, la mer et le vide : (on peut en considérer) le tout ou les parties. De même que le vide total est infini de toutes parts, de même le temps total est infini à ses deux extrémités ; en effet, le passé et le futur sont infinis. C’est ce qu’affirme très clairement sa thèse : aucun temps n’est entièrement présent ; car puisque la
37
ne songeassent, sans jamais le dire, au « présent total de la période cosmique »151 qu’ils transposent subtilement sur terre, comme font les stoïciens, et à l’avantage de Laurent Gbagbo ? Et, dans cette série, faut-il d’un revers de main écarter l’idée platonico-aristotélicienne du « présent éternel de la Forme »152 qui échappe aux flux du devenir, le mouvement du passé vers le futur et que contestent si hardiment les stoïciens153 ? Et s’ils avaient été inspirés par Søren Kierkegaard qui définit l’instant comme le croisement du temps et de l’éternité154 ?
Rien, pour lors, ne permet de privilégier l’une de ces possibilités. La formule garde son ambiguïté. En tous les cas, l’intention de ceux qui ont répandu l’idée du temps comme autre nom de Dieu est d’autant plus recevable qu’elle s’est imposée aux partisans de Laurent Gbagbo. Et elle serait, dans le cas qui nous occupe, une reformulation de la doctrine de l’ordre du destin qui prend corps et effet au travers de la contingence des événements155 dans lequel leur héros serait impliqué.
Pour les stoïciens, l’éternité est ce qu’ils appellent le « temps cosmique » ou « temps physique » que Dieu a créé, domine et tient d’un seul et continuel regard156. Alors, comment méditer le paradoxe qui renomme Dieu par le temps et non plus par l’éternité ? L’explication se prolonge en s’aidant d’une seconde formule quotidiennement rebattue : « Dans l’affaire de Gbagbo, il y a Dieu dedans ». C’est, en termes clairs, ce qui s’appelle la Providence ou plus exactement la mise en oeuvre du plan de la Providence. Une sorte de prédestination. C’est en ce sens que les séides de Laurent Gbagbo voient le divin dans sa tumultueuse biographie. D’autant que, de sa série d’épreuves, depuis les années 90, il s’en est toujours étonnamment sorti. Et, croient-ils, livré à lui-même, un homme seul ne le peut, s’il n’est pas porté par autre chose de plus grand et de plus haut que lui. Ainsi, les épisodes ahurissants du bombardement de la résidence présidentielle157 et le pilonnage du palais présidentiel158 y compris les conditions de son arrestation159 servent-ils d’exemples qui, probants selon eux, viendront conforter cette vision.
division des continus va à l’infini, et que le temps est un continu, chaque temps aussi comporte la division à l’infini ; en sorte qu’aucun temps n’est rigoureusement présent, mais on le dit (présent) selon une certaine étendue. Il soutient que, seul, le présent existe ; le passé et le futur subsistent, mais n’existent pas du tout, selon lui ; de la même manière, seuls, les attributs qui sont des accidents (actuels) sont dits exister : par exemple, la promenade existe pour moi, quand je me promène ; mais quand je suis couché ou assis, elle n’existe pas », III. La théorie du temps, in op. cit., pages
156 V. Goldschmidt : « On discerne, en gros, deux méthodes d’interprétation. La première s’élève, autant que l’homme en est capable, à une vision d’ensemble des événements, telle que, en toute rigueur, elle est réservée à Dieu. Cette méthode, poussée jusqu’au bout, se révèle insuffisante. Une autre méthode va venir à son secours, “l’usage des représentations”, méthode qui aboutit toujours, mais au risque, parfois, d’isoler l’autonomie humaine de la providence de Zeus », op. cit., p. 79.
157 Le Monde Afrique, Côte d’Ivoire : les hélicoptères français ouvrent le feu sur la résidence de Gbagbo, Dimanche, les hélicoptères français de la mission Licorne ont ouvert le feu sur la résidence de Laurent Gbagbo, 10 avril 2011.
158 Le Monde Afrique, Côte d’Ivoire : l’ONU et la France bombardent le palais de Gbagbo, Alors que les combattants pro-Ouattara ont lancé une nouvelle offensive, lundi à Abidjan, l’armée française et les militaires de l’Onuci ont bombardé le palais et la résidence de Laurent Gbagbo, 4 avril 2011,
159 Le 11 avril 2011, après dix jours d’intenses combats urbains et des bombardements de la Résidence présidentielle située à Cocody et du Palais présidentiel situé au Plateau par les forces spéciales françaises de la Force Licorne et l’Onuci, Laurent Gbagbo, Simon Ehivet Gbagbo et des membres de leur premier cercle sont arrêtés per les forces d’Alassane Ouattara. Le commandant Issiaka Ouattara
38
Nous sommes donc face à une idée répandue et pas uniquement dans les milieux populaires. Et, pour en prendre la mesure et en saisir toute l’importance, nous appellerons au jour les témoignages directs de trois personnalités. La première est une universitaire de renom, plutôt porté aux explications de type matérialiste, excepté dans le cas que nous évoquons. Le second, l’un des prélats qui fut parmi les plus respectés de la Curie romaine, un véritable mystique au sens philosophico-théologique du mot. Le dernier, un homme politique de grande influence.
Ces témoignages forment une séquence comprenant trois phases : l’hypothèse, la certitude et la main.
1.
Christophe Wondji : Complot d’assassinat du 18 février 1992, l’hypothèse de la Providence
Le professeur Christophe Wondji, premier Ivoirien agrégé d’Histoire, a été le premier enseignant noir de Laurent Gbagbo, étudiant. C’est lui qui me présenta à Memel Foté, surnommé la Bibliothèque, et à l’excellent Barthélémy Kotchy. Ils formèrent un remarquable trio d’intellectuels de gauche qui suscita quelques inquiétudes au président Félix Houphouët-Boigny. De tous nos échanges personnels sur l’histoire de la gauche ivoirienne, un seul fait lui parut relever de la Providence.
Le 18 février 1992, au Plateau, commune d’Abidjan, l’opposition légale ivoirienne mena une marche de soutien aux étudiants qui, après la manifestation de mai 1991, tinrent d’importantes manifestations revendicatives dix mois plus tard, en février 1992, très sévèrement réprimées par l’armée dirigée par le général Robert Guéi. Contraint politiquement, le Gouvernement lança une enquête qui ne se termina par aucune condamnation. Ce fut le motif principal de la manifestation de ce 18 féviers qui se déroulait à l’initiative du Front populaire ivoirien co-fondé (1982) et dirigé par Laurent Gbagbo, alors député. La veille, Alassane Ouattara, Premier ministre, fit signer au président Félix Houphouët-Boigny une « loi » « anticasseurs » qui permettait de procéder à l’arrestation de quiconque serait pris à détruire les biens publics et privés. Laurent Gbagbo est en tête de cortège, avec son épouse Simone Éhivet Gbagbo et son fils. Des débordements orchestrés par des infiltrés, dit-on, semèrent une confusion, du désordre et des dégâts. Un témoignage et une accusation fusèrent qui désignèrent son épouse, son fils, et lui. Aussi furent-ils arrêtés, transférés et détenus dans la caserne de gendarmerie d’Agban (Abidjan), puis incarcérés à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA). Deux mois plus tard, le 6 mars 1992, ils seront condamnés à deux ans de prison, mais libérés six mois plus tard, le 31 juillet 1992, en vertu de la loi d’amnistie adoptée deux jours plus tôt.
Mais, ce 18 février, une folle rumeur s’empara de la capitale ivoirienne et selon laquelle un « plan d’assassinat de Laurent Gbagbo » était en cours d’exécution par des inconnus : le « complot du 18 février 1992 ». Selon Christophe Wondji, et plus d’un partagent cette vision, ce jour-là, Laurent Gbagbo n’eut la vie sauve qu’à l’initiative d’une « faction » républicaine de l’armée, un petit groupe d’officiers, qui fit avorter ce macabre projet, en anticipant son arrestation, en l’extrayant de la foule pour l’exfiltrer à l’aide d’un véhicule, après avoir fait une percée vive et rapide au coeur du chaos de la foule des manifestants. Ainsi, par leur décision, stoppèrent-ils ce plan. Le fait était si « incroyable » que Christophe Wondji évoquera l’hypothèse de la Providence pour l’expliquer. Car cette rupture inopinée de l’enchaînement des événements, c’est-à-dire de la modification du destin, qui, de façon
alias Wattao, qui dirige cet assaut, prend la décision de protéger le président Laurent Gbagbo en lui procurant un casque et un gilet pare-balles. Un plan d’assassinat, dit-on, était prévu par des radicaux.
39
inéluctable, aurait dû ou pu conduire au meurtre du leader de l’opposition, eut une « cause » heureuse aussi inattendue qu’imprévisible.
2.
Bernard cardinal Agré : la Dame en bleue, la certitude de la Providence
Une autorité religieuse et intellectuelle aussi considérable que Bernard cardinal Agré, archevêque métropolitain, le pensait fermement et surtout le croyait. Un jour, recevant mon regretté frère aîné Jean-Baptiste et moi à déjeuner en ses appartements, il nous fit part de deux confidences. La première concernait le retour de Laurent Gbagbo au sein de l’église catholique, une tâche nécessaire, disait-il, dont une jeune ministre du Gouvernement et lui étaient convenus. Pour lui, « Laurent » n’avait jamais vraiment rompu avec le Catholicisme et, pour étayer sa conviction, il prétextait qu’il continuait de jouer au piano le Requiem des anges. La seconde confidence, encore plus étonnante, était un rendez-vous qu’il devait avoir avec Laurent Gbagbo le lendemain, si le souvenir est exact, pour lui dévoiler un « projet d’empoisonnement au café » dont il avait été informé.
Le Révérendissime plaçait tous ces faits sous l’initiative et la protection de la Dame en bleue, comme il aimait à appeler la Vierge Marie, « protectrice de la Côte d’Ivoire », affirmait-il. Et, ajouta-t-il, au cours d’un échange qu’il eut avec un officier français, celui-ci reconnut qu’une « force supérieure » protégeait le régime de Laurent Gbagbo.
C’est cette atmosphère dans laquelle de nombreux Ivoirien(ne)s placent encore le destin de Laurent Gbagbo : un plan de la Providence, qui lui permettait d’échapper au plus terrible de ce qui peut se présenter à lui. Le salut. Mais est-ce parce qu’il est un stoïcien que, comme les stoïciens l’enseignent, Laurent Gbagbo crédite la pensée suivante : « la mort est un croque-mitaine », un épouvantail, qui ne doit susciter aucune frayeur en nous ?
Hegel, plus que tout autre penseur, a insisté sur cette « liberté intérieure » des stoïciens. Pour lui, ils ne sont rien d’autre que cette liberté-là160. Est-ce cette force intérieure qui guide Laurent Gbagbo ?
3.
Guillaume Kigbafori Soro : seconde exfiltration de Laurent Gbagbo, main de la Providence
Excipons d’un autre exemple, parmi bien d’autres, ce qui vient d’être dit. Guillaume Kigbafori Soro a affirmé avoir pris seul la décision du transfèrement de Laurent Gbagbo d’Abidjan à Korhogo, parce que certains radicaux étaient convenus d’attenter à sa vie. Si l’on considère comme vraie sa parole, il aura pris une part active au prolongement d’un incroyable enchaînement d’événements qui conduiront Laurent Gbagbo à La Haye, là même où sa victoire « inattendue » le verra auréolé de la couronne de la victime innocente avec un retentissement mondial tout aussi inattendu.
En effet, transférant Laurent Gbagbo à La Haye pour un retentissant procès, duquel il était censé ne jamais plus revenir, ses plaignants civils et tous ses adversaires politiques étaient bien loin d’imaginer qu’ils le placeraient dans un contexte stoïcien qui, dès lors, lui serait très favorable, à maints égards : tout d’abord, la prison est un terrain (un lieu, donc un incorporel) dont il fera l’expérience dès sa jeunesse et qui se répètera au cours de son activité professionnelle161 et de sa carrière politique162. C’est donc un prisonnier expérimenté que la Cour pénale internationale (CPI) avait entre ses murs et
en face d’elle. Un habitué des procès. Ce qui n’est pas le cas de tous les autres prisonniers africains. Ensuite, seconde particularité de ce procès, l’Accusation fit le choix stratégique de l’étendre en longueur par la durée qu’elle entretenait par une « divisibilité infinie » du « temps vulgaire », comme indiqué dans un article sur ce procès consacré au paradoxe sur le temps établi par Zénon163, fondateur du Stoïcisme. Ce fut sans doute là, pour les Accusateurs, l’erreur la plus grande.
Un procès atypique, à l’avantage de Laurent Gbagbo
Car, en prolongeant indéfiniment le procès, ils commettaient une double méprise qui sera la cause de leur échec. D’une part, en effet, ils ne faisaient que mettre en oeuvre l’inexistence du temps par sa divisibilité infinie164. Or, c’est cela la théorie de la divisibilité du temps qui, empruntée à Aristote par les stoïciens, peut se poursuivre à l’infini et par lequel les deux procureurs ont montré que, pour eux, seul compte ce que nous appelons volontiers le présent édulcoré ou la « durée durante », c’est-à-dire prolongée de manière fictive et artificielle. D’autre part, ce faisant, ils attestaient que le temps, en tant que continuité, est une étendue, comme l’affirment avec force les stoïciens ; d’autant que, pour eux, le recours à la théorie de la divisibilité ne visait pas à démontrer que le temps est en lui-même irréel, mais, plutôt, une étendue qui, comme telle, ne peut et ne doit essentiellement être saisie que par « la sensation »165.
On se souviendra, ici, à titre anecdote, de la célèbre raillerie de Plutarque à l’endroit de la divisibilité à l’infini du Temps (et du Lieu) rappelée par Émile Bréhier166, au sens où l’application de cette méthode menait droit à une absurdité, dans la mesure où, prenant l’exemple du corps et du doigt d’un individu, tous deux étant infiniment divisibles à l’infini, revêtaient dès lors une valeur égale. En effet, l’absurde est qu’un grain de sable et la terre entière deviennent égaux par leur infinie divisibilité. Ainsi, uniquement occupés et préoccupés par la seule divisibilité du temps du procès, par lequel objectivement ils ne faisaient que favoriser l’accusé et sa défense, les procureurs successifs n’ont pas pris la peine et n’ont peut-être même pas songé à constituer un dossier solide, une tâche qui n’était manifestement pas leur souci premier et ne pouvait pas l’être. Tous deux, enthousiastes, feront bien mieux que Pénélope167 : ils auront détruit leur ouvrage, avant de l’avoir composé.
Il me souvient bien que, lors d’un nos nombreux entretiens avec maître Seyni Loum, avocat de renom au barreau de Paris et l’un des plus grands diplomates africains des indépendances, il émit de fortes réserves quant à l’impréparation de ce dossier. Mais là où lui voyait un défaut de professionnalisme qui ne résisterait pas à l’expérience et à la notoriété de maître Emmanuel Altit, je voyais plutôt une erreur ontologique, qui non seulement créait un contexte stoïcien qui favoriserait Laurent Gbagbo, mais aussi, de façon nécessaire, leur ôtait toute possibilité de constituer un dossier recevable, sans
préjugé du fond. Comme par un retournement de situation, ils étaient doublement stoïciens, par la « divisibilité » du temps et faisant du temps une « étendue ».
En tous les cas, l’insuffisance notoire de culture philosophique conduira les procureurs successifs, Luis Moreno Ocampo et Fatou Bensouda, à ne pas pressentir puis à ne pas comprendre qu’ils ne faisaient, en réalité, que reprendre à leur propre compte « l’analyse méthodique »168 par laquelle les stoïciens déconstruisent le temps vulgaire perçu comme irréel169 pour faire place au présent défini comme moment et qui, pour ces philosophes, est la seule étendue par laquelle le temps perd toute facticité pour devenir ce qu’il est, en propre, c’est-à-dire réel, ce qui est la quête de tout stoïcien. Ils ont eux-mêmes créé, à leur corps défendant, le moment (de) Gbagbo.
Ainsi ont-ils eux-mêmes déconstruit le temps par la durée en le transformant en un présent continu, dans lequel l’instant fictif était répété indéfiniment. C’est donc « à l’insu de leur propre gré » que nos deux Procureurs ont placé Laurent Gbagbo dans un contexte et une temporalité qui étaient clairement à son avantage. S’ils avaient seulement su qui étaient leur prisonnier « personnel », sans doute eurent-ils fait ou alors tenter d’organiser un procès expéditif. Leur calcul stratégique s’est révélé être une lourde erreur tactique. Chacun peut dès lors comprendre pourquoi Laurent Gbagbo fut tout à son aise tout le long de ce long procès. Il était dans son élément, c’est-à-dire un contexte stoïcien. Lui misera sur le présent réel, pendant que ses deux procureurs mettront en oeuvre un présent fictif, le présent limité, dénoncé par les stoïciens, parce que reproductible à l’infini.
En somme, Laurent Gbagbo finira par emporter son très long procès, non pas seulement en raison de la lourde légèreté des témoignages et l’insuffisance manifeste de preuves, mais d’abord et surtout parce que, contre la durée (reports successifs, futur) introduite par L. M. Ocampo et artificiellement entretenue par F. Bensouda, les Juges abrégeront par et en un instant le procès, c’est-à-dire sans même prendre le temps d’écouter la défense de Laurent Gbagbo. La durée fut abolie, comme par décret. Ce fut la brusque immixtion de l’intervalle sur le plan juridique. Temps : durée contre intervalle. Une seule mi-temps. Et l’arrêt du match par l’arbitre.
Somme toute, on peut raisonnablement affirmer que ce procès aura été un affrontement entre deux conceptions du temps ontologiquement distinctes et radicalement opposées. Un épisode universel, comme cela arrive peu dans l’histoire.
Au fond, Laurent Gbagbo et ses avocats auront laissé ses accusateurs actualiser et déployer au coeur de « son » procès la conception du temps de la doctrine stoïcienne : l’intervalle170.
168 V. Goldschmidt, La connaissance, Chapitre IV : L’interprétation des événements, in op. cit., pages 77 à 124.
169 Sur « l’irréalité du temps vulgaire » ou « le temps illusoire », V. Goldschmidt, op. cit., p. 208.
170 Victor Goldschmidt : « L’indépendance à l’égard de l’avenir et de la réussite peut être illustrée par la distinction qu’a établie M. Eugène Dupréel entre deux types de techniques : la technique au sens ordinaire du mot (technique A) et les pratiques religieuses (technique B) qui prétendent arriver là où les techniques courantes ne peuvent aller. « Il faut, pour aboutir, ce qu’on peut appeler la collaboration de l’intervalle. L’intervalle, c’est tout ce qui, entre le projet et le résultat, peut survenir, sans être le fait propre de l’agent, et qui se combine avec l’effort direct de celui-ci pour assurer le succès ou l’empêcher… La technique B ne prétend influencer que la partie de l’opération soustraite aux forces et au savoir de l’agent, elle ne porte que sur l’intervalle, et elle ne laisse, quant à elle, aucun intervalle », op. cit., p. 214, « La philosophie s’offre à nous comme la seule technique capable de réduire cet intervalle et de vaincre cette contingence en nous », op. cit., p. 215.
42
Qu’est-ce que l’intervalle ? Il concerne le temps, le lieu et le vide171. Lorsqu’il concerne le temps, il s’expose et se définit brièvement comme suit : « L’intervalle, c’est tout ce qui, entre le projet et le résultat, peut survenir, sans être le fait propre de l’agent [en l’occurrence, Laurent Gbagbo], et qui se combine avec l’effort direct de celui-ci pour assurer le succès ou l’empêcher… »172.
Et ce qui n’est pas « le fait propre de l’agent », autrement dit « ce qui ne dépend pas de [lui] », c’est cela que les stoïciens nomment destin, ou libre intervention des dieux ou de Dieu : (la) Providence. C’est cela « la soumission au Destin » qui, selon les stoïciens, est toujours à l’avantage de celui qui s’y plie, autrement dit par « l’effort de celui [qui doit en] assurer le succès », en ne l’empêchant pas.
À ce « présent mutilé »173, autrement dit partiel, instable, dans lequel s’inscrivaient les procureurs, Laurent Gbagbo recherchera la présence de la réalité unique du présent réel174 en attendant le moment favorable pour susciter le présent qui est dans le temps réel : l’intervalle175.
Dès lors, devenue la « cause motrice » de son propre procès, il déploiera « l’acte pur » qui, pour les stoïciens, n’est réalisable que dans un intervalle, mais, en l’occurrence, avec cette particularité tout à fait frappante que cet intervalle-là ne sera plus l’intervalle stoïcien classique qui, lui, est marqué et borné par deux incorporels, à savoir le passé et le futur, mais, en l’espèce, par trois incorporels, le troisième étant la durée (factice, mais effective) créée et entretenue par les procureurs ; la durée, elle, n’étant conçue par les deux procureurs que comme un assemblage éclectique voire chaotique du passé, du présent et du futur qui, conséquence inéluctable, les conduira au désaveu et au ridicule. Ils ne savaient pas que l’intervalle176, c’est ce que les stoïciens appellent le présent177 ; et que, selon ces derniers, seul compte le présent178.
171 E. Bréhier, Chapitre III, La théorie du lieu et du vide, in op. cit., pages 37 à 53. Victor Goldschmidt, II. Le vide et le lieu, Chapitre premier, La théorie physique du temps, in Le système stoïcien et l’idée de temps, quatrième édition, revue et augmentée, coll. Bibliothèque d’histoire de la philosophie, Librairie philosophique Vrin, pages 26 à 30.
172 V. Goldschmidt, op. cit., p. 214. Par ailleurs, il a formulé des rappels sur la notion d’intervalle dans la théorie du lieu : « Les commentateurs d’Aristote rangent sans exception les stoïciens parmi ceux qui ont accepté la troisième hypothèse, l’identité du lieu avec l’intervalle entre les extrémités du corps en tant que cet intervalle est plein », p. 38 ; « Aristote pour expliquer cette théorie comparait le lieu à un vase qui peut être rempli successivement par des corps différents tout en restant le même lieu, parce que l’intervalle des extrémités du corps qui le remplit est le même », p. 39 ; « L’argumentation des stoïciens est beaucoup plus directe : Diogène Laërce la résume ainsi : “Il n’y a pas de vide dans le monde, mais il est uni (ήνῷσθαι) ; c’est la conspiration et le concours (σύμπνιαν ϰαὶ συντονίαν) des choses célestes avec les choses terrestres qui forcent à cette conclusion”. La prémisse du raisonnement est donc la nature de l’action qui doit se répandre à traves tous les corps, et qui serait arrêtée par des intervalles vides. D’après Clèomède, qui détaille un peu la même argumentation, les sensations mêmes de la vue et de l’ouïe seraient impossibles, s’il n’y avait pas entre les corps et l’organe un continu doué de tension, sans aucune intervalle », p. 45 ; « En définissant le lieu par les limites du contenant, Aristote avait déterminé le lieu d’un corps par son rapport avec un autre. En revenant à la théorie du lieu, intervalle, les stoïciens avaient à supporter toutes les difficultés de cette théorie, à moins d’admettre, comme nous l’avons expliqué, la pénétration mutuelle et intégrale de tous les corps les uns dasn les autres ; il n’y avait alors qu’un lieu absolu par l’extension du corps lui-même. Mais les corps ne se pénètrent pas tous naturellement dans toutes les parties. L’âme du monde par exemple qui pénètre toutes les parties de l’univers n’est pénétrée par chacune d’elles que dans une de ses parties. On ne parle plus alors du lieu de ces parties, mais de la place qu’elles occupent dasn l’âme du monde ; Les places sont donc les lieux de chaque corps considéré dans leur rapport au lieu plus grand du corps où il est », p. 53 ; « D’autre part nous avons vu Philon, dans un passage qui, pour la substance des idées, remonte au Timée, donner la définition stoïcienne du temps : intervalle du mouvement », p. 57.
173 V. Goldschmidt : « L’interprétation, pour être correcte, devrait nous associer à l’activité divine. Or, “le génie en nous” n’est qu’une “parcelle détachée” de Zeus. Que l’interprétation envisage les fins, les causes prochaines ou la cause parfaite, il semble que jamais nous ne puissions atteindre la totalité cosmique, enfermés que nous sommes dans le partiel et dans le présent mutilé », op. cit., pages 98 à 99.
En termes stoïciens, nous dirons que Laurent Gbagbo et ses avocats ont mis à profit l’intervalle pour saisir un fragment du temps qu’ils ont transformé en présent réel.
C’est là le « modèle » de « l’acte » qu’à toujours posé, pose et posera Laurent Gbagbo. Et c’est dans l’intervalle des stoïciens qu’il trouve et puise la force ontologique de ses combats.
Ainsi et avec art, Laurent Gbagbo aura pratiqué « durant » tout son procès ce qu’un exégète a appelé « la collaboration de l’intervalle ». Il a fort habilement pratiqué ce que nous pourrions appeler ici le jeu de l’intervalle. En Côte d’Ivoire, depuis sa jeunesse jusqu’à La Haye (Pays-Bas), il aura été le maître des intervalles qu’il a toujours placé au centre de ses activités.
Pour les stoïciens, nous l’avons vu, l’intervalle est lui aussi un « incorporel », c’est-à-dire qui n’est que dans la pensée et, par conséquent, est « un ordre de raison » selon Chrysippe. Cette conception particulière du temps diffère radicalement de celles de Platon et d’Aristote pour qui le temps est saisi par le nombre, quand pour d’autres philosophes il l’est par le mouvement, tandis que les stoïciens le définissent par l’intervalle, l’acte de l’individu, qu’ils appellent l’agent. Là où L. M. Ocampo et F. Bensouda calculaient le procès par le nombre, Laurent Gbagbo s’y pliera par l’intervalle où loge et se déploie le destin qui, accepté, permet que le présent soit effectivement présent.
Ainsi, aux yeux des stoïciens, la « seule faute morale » inacceptable « est [celle] de ne pas obéir à l’impératif du présent […] qui se renouvelle incessamment »179. Car en lui seul se réalise pleinement le temps de l’acte ou le dé-pliement des devoirs qui transcende toutes les circonstances (περιστάσις) ou situations qui, elles, ne sont propices qu’à atteindre un but mais jamais la visée, c’est-à-dire la fin. Aussi, la clarté de l’acte stoïcien se garde de confondre but et fin, comme nous l’avons déjà dit.
En effet, « le télos de l’action peut être atteint à chaque instant, et que cet instant est le seul temps dont nous disposions, il est également (lui, et non pas l’avenir de nos bonnes résolutions) l’unique temps du salut : le temps de la libre initiative actuelle. Il s’ensuit qu’il faut accomplir l’action présente, comme si c’était la dernière. Mais, à l’inverse, il n’y a aucune préparation requise pour bien mourir, si ce n’est de bien faire ce qu’on est en train de faire »180.
Dans le domaine pratique, la quête-conquête du présent est impérative. Il n’y a pas de pratique en tant que telle, hors du présent. Aussi, pour saisir l’essence (qualité) du temps, contre le nombre181, le mouvement et le mouvement nombré182, les stoïciens instituent l’intervalle et l’acte par lequel surgit le présent temporel, c’est-à-dire l’instant auquel ils accordent certains « attributs » de l’éternité : totalité et infinité (passé-présent-futur), immutabilité (suppression du devenir), stabilité (résorption du passé et du futur). Bref, la perfectibilité devient perfection, et le vide, dans l’intervalle, devient plénitude. Le présent est alors fragment183 et totalité de l’éternité. Et cela suffit à cet acte stoïcien,
179 V. Goldschmidt, op. cit., pages 168 à 169.
180 V. Goldschmidt, op. cit., pages 169 à 170.
181 V. Goldschmidt, op. cit., p. 35.
182 V. Goldschmidt, op. cit., p. 32.
183 V. Goldschmidt, op. cit., p. 97 et p. 111.
44
une manière d’être184 qui, ne tendant plus vers la « cause finale », se vise comme « cause motrice »185 agissant dans l’intervalle entre deux incorporels (passé et futur, deux subsistants, donc de moindre existence), pour réaliser son « saut » dans l’éternité.
À cet instant, dans l’instant, l’agent moral est au présent ce qu’est Dieu, comme « cause unique »186, à l’éternité à l’échelle cosmique et du monde. Le temps physique et le temps vécu sont identiques.
En tous les cas, la conception de l’éternité comme ligne droite, ouverte et infinie est remplacée, chez les stoïciens, par celle du retour de l’éternel entendu comme « rythme périodique »187 du temps cyclique (circulaire) dans lequel le présent essentiel, sans interruption, s’étend de sa naissance et ses variations188 jusqu’à sa conflagration universelle189, puis le recommencement complet du temps se répétant avec les mêmes séquences.
Ce rythme périodique à l’échelle cosmique190 qui, à quelques égards s’apparente au « néant » le (non-être), n’est-ce pas celui-là que Laurent Gbagbo a toujours dupliqué à l’échelle humaine : la démocratie, sans cesse prise dans son péril de conflagration, et qui doit renaître, par les intervalles de son acte propre ?
Sans la découverte et le rappel d’un tel ancrage, comment comprendre que Laurent Gbagbo n’ait qu’un seul but : la république, ce système politique de l’égalité ou de la vertu prôné par Marcus Tullius Cicero, Cicéron, qui en a été le grand défenseur et dont Mably réclame la lecture ? Comment aussi
184 E. Bréhier : « Lorsque le feu échauffe le fer au rouge par exemple, il ne faut pas dire que le feu a donné au fer une nouvelle qualité, mais que le feu a pénétré dans le fer pour coexister avec lui dans toutes ses parties. Les modifications dont nous parlons sont bien différentes : ce ne sont pas des réalités nouvelles, des propriétés, mais seulement des attributs (ϰατηγορήματα). Ainsi lorsque le scalpel tranche la chair, le premier corps produit sur le second non pas une propriété nouvelle, mais un attribut nouveau, celui d’être coupé. L’attribut, à proprement parler, ne désigne aucune qualité réelle ; blanc et noir par exemple ne sont pas attributs, ni en général aucune épithète. L’attribut est toujours au contraire exprimé par un verbe, ce qui veut dire qu’il est non un être, mais une manière d’être, ce que les stoïciens appelaient dans leur classement des catégories un πώς ἔχον. Cette manière d’être se trouve en quelque sorte à la limite, à la superficie de l’être, et elle ne peut en changer la nature : elle n’est à vrai dire ni active ni passive, car la passivité supposerait une nature corporelle qui subit une action. Elle est purement et simplement un résultat, un effet qui n’est pas à classer parmi les êtres », op. cit., pages 11 à 12. « L’attribut par exemple (ϰατηγορήματα) indique ce qui est affirmé d’un être ou d’une propriété », op. cit., p. 15.
185 E. Bréhier : « les seuls êtres véritables que reconnaissent les Stoïciens, c’est la cause active » (τὸ ποιοῦν), puis l’être sur lequel agit cette cause (τὸ πάσχον), op. cit., p. 10.
186 V. Goldschmidt, op. cit., p. 35. Du statut de « causalité auxiliaire », le sage passe à celui de « causalité divine », op. cit., p. 94.
187 V. Goldschmidt, op. cit., p. 49 et p. 73. E. Bréhier : « Qu’il n’y ait qu’une seule espèce de cause, c’est au contraire la théorie soutenue avec insistance par les stoïciens. C’est qu’il s’agissait pour eux d’expliquer l’unité de l’individu, aussi bien que l’unité du monde que l’unité d’une pierre ou d’un animal, et non plus cette unité compréhensive de plusieurs individus qui est le général. Aussi la cause doit être une dans l’intimité de l’individu. Cette force intérieure ne peut nullement se concilier avec l’action extérieure d’un être immatériel », op. cit., p. 10. L’auteur précise : « Les éléments actifs du monde, le feu et l’air, donnent naissance par transformation aux éléments passifs ; les trois derniers [éléments ! terre, air et eau], dans la conflagration universelle, se résorbent eux-mêmes dans le feu, si bien que l’être primordial est le feu, la raison séminale du monde. Les autres êtres sont produits par une tension moindre, un relâchement du feu primordial. Ils ne sont ni les effets ni les parties des êtres primitifs, mais plutôt des états de tension différents de cet être », op. cit., pages 10 à 11.
188 E. Bréhier : « le monde ne garde pas le même volume à tous les moments de son histoire : il se contracte dans la διαϰόσμησις, et il se dilate dans la conflagration universelle. Cette dilatation exige autour de lui un vide dans lequel il puisse s’étendre », op. cit., p. 48.
189 E. Bréhier : « le monde entier avec son organisation et la hiérarchie de ses parties, son évolution qui va d’une conflagration à une autre est un être vivant », op. cit., p. 4 ; « Le mouvement […] n’est pas le passage d’une puissance à l’acte, mais bien un acte qui se répète toujours de nouveau […]. Le monde […est] dans un état de changement perpétuel qui va de la conflagration à la restauration du monde, puis à aune conflagration nouvelle. Mais pour beaucoup d’entre eux [les stoïciens], chacune de ces périodes renouvelle l’autre intégralement. On conçoit aisément comment ils ont pu être amenés à cette idée du « retour éternel », pages 45 à 46.
190 E. Bréhier : Chrysippe, après Aristote : « de même que chaque être est mesuré par une unité de la même espèce, de même le temps est mesuré par un temps défini. Ce temps défini (que nous appellerions aujourd’hui l’unité de temps) est mesuré lui-même par un mouvement défini. Le seul mouvement défini que nous ayons à notre disposition est le mouvement circulaire du ciel, parce que seul, il est uniforme (όμαλής). C’est pourquoi, dit-il, le temps paraît être le mouvement de la sphère […] Seulement le temps n’est pas réduit au mouvement lui-même, mais à l’intervalle […] que le temps était la “sphère” elle-même », op. cit., pages 54 à 55.
45
concevoir que Laurent Gbagbo ne poursuive qu’une seule fin : la « démocratie représentative », pour laquelle il pourrait emprunter le surnom démo-kritos ; car chez lui la signification du nom Démocrite (Δημό-κριτος, Dêmókritos, Dêmó-kritos) et le système nommé Démocratie (Δημο-κρατία, Dēmo-kratía,) entretiennent une proximité.
Sur la base de l’ensemble des développements antérieurs, la formule selon laquelle « le Temps est l’autre nom de Dieu » se laisse découvrir tout autrement. Elle typiquement stoïcienne. D’une part, parce qu’elle utilise pour la rejeter la divisibilité du temps irréel (ordinaire, vulgaire, quotidien) pour accéder au temps réel, qui relève de son acte. D’autre part, elle conçoit ce temps réel comme une étendue saisissable que par la sensation. D’autre part encore, l’intervalle dans lequel temps réel est appréhendé par la sensation.
Le présent est le temps réel tel que senti par l’acte dans l’intervalle qui ouvre le moment favorable (kairos), pour l’épreuve ou le bonheur ; ce présent toujours logé dans un intervalle.
Cette conception du temps est celui des devoirs191 de Laurent Gbagbo que ses adversaires politiques, en Côte d’Ivoire comme en France, ont quelque mal à comprendre. Après les Procureurs, comme eux, des juges ivoiriens l’ont involontairement placé en situation stoïcienne : en le frappant d’inéligibilité pour un braquage bancaire dont il n’est manifestement ni le commanditaire, ni l’auteur et le responsable, ils ont institué un temps (incorporel) irréel, fictif et factice, dont l’étendue (corps, objet) est indéfiniment étirée par la durée (incorporel) et ont fini par créer l’intervalle.
Ce présent stoïcien est donc favorable à Laurent Gbagbo. Ainsi, placé dans le même contexte que celui de son procès à La Haye, il peut en sortir vainqueur et auréolé d’une couronne de laurier. C’est ce que pronostique « le Temps », cet « autre nom de Dieu ».
C’est pourquoi son dicible (langage : syntaxe et vocabulaire), ses représentations (digbha, digba, trouillette, etc.), ses descriptions (méthode d’exposé) et son éthique personnelle, l’ataraxie (manière d’être) restent encore si efficaces, tant appréciés par les uns, tant redoutés par les autres.
Au fond, Laurent Gbagbo est-il un penseur qui ne dit jamais théoriquement qu’il pense, parce qu’il prend la précaution de laisser à chacun le soin, c’est-à-dire, à tous, la liberté d’éprouver cela par la sensation.
Mais au vrai, cette précaution-là est également la conséquence d’une autre cause : l’impossibilité pour Laurent Gbagbo de dévoiler l’intensité de sa vie intérieure. C’est pourquoi s’il peut dire ou faire dire qui il est (objet de la biographie), il ne parvient pas à dire quoi (« quid ») il est vraiment, c’est-à-dire le contenu éthique de sa propre intériorité stoïcienne, mais que la deuxième détermination constitutive du Stoïcisme ne lui permet pas d’expliquer. La première détermination est « le critère » de la vérité.
191 Hegel : « Il y eut outre Panétius, connu pour avoir été le maître de Cicéron ; c’est d’après ses oeuvres que Cicéron écrivit ses livres sur les devoirs ». Il ajoute, en note 17 : « Cic. De Officiis III, a. ˂ « C’est donc Panétius qui, sans contredit, a disserté des devoirs avec le plus grand soin et c’est lui qui, en y apportant quelques corrections, que nous avons suivi de préférence »… (Les devoirs, III, 2, 7, p. 73, trad. M. Testard, « Les Belles Lettres », La Philosophie stoïcienne, in Leçons sur l’histoire de la philosophie, tome 4, La philosophie grecque, coll. Bibliothèque des textes philosophiques, Éditions Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 1975, p. 643,
46
En effet, cette deuxième caractéristique est la conscience de soi entendue comme liberté individuelle absolue, une hypertrophie du sujet pensant que Hegel a fort bien perçu192 et qui ne lui permet pas de faire son autoportrait. Laurent Gbagbo ne peut s’autodécrire, c’est-à-dire dresser son autoportrait intérieur. C’est son tabou et son totem. Il pratique sa conscience de soi, mais ne peut pas l’expliquer, car cela reviendrait à parler de soi en donnant le portrait que Hegel fait de la subjectivité du stoïcien. C’est la « solitude » de la conscience de stoïcienne qui y trouve sa satisfaction comme l’a vu Hegel.
Ainsi, il ne peut que garder pour lui, et à l’intérieur de soi, son stoïcisme comme conscience de soi, liberté. Autrement dit, et conformément à la doctrine stoïcienne, le dicible de Laurent Gbagbo doit être « sentie » par la sensation193 comme le mode de connaissance qui y donne accès le plus facilement. C’est pourquoi tous les Ivoiriens comprennent spontanément la signification et le sens de ses paroles, pour le bonheur des uns, pour le mécontentement des autres. Ce qu’il dit est donc toujours senti.
Et c’est l’une des raisons pour lesquelles, jusqu’ici, il a été impossible de détecter ses liens cachés à la doctrine stoïcienne, quand bien même il a été surnommé « Cicéron ».
C’est sur les fondamentaux du stoïcisme (l’individu comme seule réalité194 avec le devoir éthique d’accomplir le présent total et la théorie du dicible) qu’il s’efforce, de manière tout à fait remarquable, d’harmoniser république sociale, démocratie représentative et panafricanisme, dans un effort de synthèse entre le socialisme (justice sociale, égalité, réduction de la pauvreté), la laïcité (séparation des religions et de l’État), le catholicisme (religion familiale) et le marché (offre et demande de biens et de services, commerce).
Sous ce rapport, Laurent Gbagbo reste dans le sillage de « l’être raisonnable » dont Épictète a dressé le portrait. Certes, il n’est pas « le sage » que les stoïciens ont érigé en modèle. Cependant, comme eux, « il n’y a d’intolérable [pour lui] que ce qui est contraire à la raison ».
Au nom du « temps réel » et de « la dignité personnelle », deux fruits de « la Raison » selon les stoïciens, acceptera-t-il d’être, dans son pays natal, un dalit politique, un hors-caste, une sorte d’intouchable hindou, après avoir autant combattu pour la démocratie représentative dont il est réputé y être le père ? Chacun peut anticiper la réponse.
Mais la Côte d’Ivoire, ses citoyens et son gouvernement voudront-ils tirer les leçons de son histoire récente ? Le pourront-ils, quand bien même ils le voudraient ?
À sa façon, Hegel forgera la longue remarque suivante :
192 Hegel : « le caractère subjectif du principe, en tant que formel […] a pris ainsi la signification essentielle de la subjectivité de la conscience de soi. […] La deuxième détermination dominante est celle du sage […] ce dont il s’occupe exclusivement] n’est pas seulement le νοũς, c’est toute chose qui doit être du pensé, c’est-à-dire, en tant que subjective, être ma pensée. […] Le penser du critère, de l’unique principe, en tant qu’il est dans sa réalité effective immédiate, est le sujet lui-même ; le penser et le pensant sont en connexion immédiate. Le principe de cette philosophie n’est pas objectif, mais dogmatique, il repose sur l’impulsion de la conscience de soi à se satisfaire. Le sujet est donc ce dont il faut se soucier. Le sujet est à la recherche d’un principe pour sa liberté, pour son inébranlabilité intérieure, il doit être conforme au critère, c’est-à-dire à ce principe tout à fait universel, — il doit s’élever à cette liberté abstraite, à cette indépendance. La conscience de soi vit dans la solitude de son penser ; elle trouve en cela sa satisfaction », tome 4, La philosophie grecque, coll. Bibliothèque des textes philosophiques, Vrin, Paris, 1974, pages 634 à 635.
193 V. Goldschmidt : « C’est à partir de la “représentation” sensible des manières d’être, que s’effectue la saisie rationnelle de l’être même », op. cit., p. 23 ; « Est réel, en revanche, le présent d’une certaine étendue et saisi par la sensation », op. cit., p. 39.
194 E. Bréhier, op. cit., p. 20.
47
« C’est le moment, dit-il, d’évoquer les réflexions morales qu’on introduit dans l’histoire : de la connaissance de celle-ci, on croit pouvoir tirer un enseignement moral et c’est souvent en vue d’un tel bénéfice que le travail historique a été entrepris. S’il est vrai que les bons exemples élèvent l’âme, en particulier celle de la jeunesse, et devraient être utilisés pour l’éducation morale des enfants, les destinées des peuples et des États, leurs intérêts, leurs conditions et leurs complications constituent cependant un tout autre domaine que celui de la morale. (Les méthodes morales sont des plus simples ; pour un tel enseignement, l’histoire biblique est largement suffisante. Mais les abstractions moralisantes des historiens ne servent à rien.)
On recommande aux rois, aux hommes d’État, aux peuples de s’instruire principalement par l’expérience de l’histoire. Mais l’expérience et l’histoire nous enseignent que peuples et gouvernements n’ont jamais rien appris de l’histoire, qu’ils n’ont jamais agi suivant les maximes qu’on aurait pu en tirer. Chaque époque, chaque peuple se trouve dans des conditions si particulières, forme une situation si particulière, que c’est seulement en fonction de cette situation unique qu’il doit se décider : les grands caractères sont précisément ceux qui, chaque fois, ont trouvé la solution appropriée. Dans le tumulte des événements du monde, une maxime générale est d’aussi peu de secours que le souvenir des situations analogues qui ont pu se produire dans le passé, car un pâle souvenir est sans force dans la tempête qui souffle sur le présent ; il n’a aucun pouvoir sur le monde libre et vivant de l’actualité. (L’élément qui façonne l’histoire est d’une tout autre nature que les réflexions tirées de l’histoire. Nul cas ne ressemble exactement à un autre. Leur ressemblance fortuite n’autorise pas à croire que ce qui a été bien dans un cas pourrait l’être également dans un autre. Chaque peuple a sa propre situation, et pour savoir ce qui, à chaque fois, est juste, nul besoin de commencer par s’adresser à l’histoire »195.
XVIII.
En guise de non-conclusion provisoire : trop est-il trop ?
Un souvenir estudiantin. J’étais en licence de philosophie, en Sorbonne, à Paris-1, en 1980, et j’avais choisi parmi les trois « Unités de valeur » (cours) une intitulée Métaphysique dont les Travaux dirigés (TD) étaient dispensés par un Maître de conférences dont j’ai oublié le prénom et le nom, malgré mes récentes demandes répétées auprès du Secrétariat du département de philosophie. Nous étions une quarantaine d’étudiants à participer à ce cours.
Bien évidemment, le contrôle des connaissances était une obligation académique. Aussi, l’enseignant fixa une date, pour le premier devoir sur table. Le sujet était « Trop, c’est trop ». Je débutais ma copie par un mot allemand : Zu viel ist zu viel, c’est-à-dire « Trop c’est trop ». J’eus la meilleure note, ce qui eut pour effet immédiat d’irriter deux jeunes demoiselles, des condisciples, qui, devant moi, questionnèrent ainsi l’enseignant : « il est impossible qu’il ait une meilleure note que nous.
195 Hegel, La raison dans l’histoire, Introduction à la philosophie de l’histoire, Traduction nouvelle, introduction et notes par Kostas Papaoiannou, coll. 10|18, Union Générale d’Éditions, Paris, pages 35 à 36.
48
— Pourquoi donc leur objecta-t-il ? Parce que nous venons de la Rue d’Ulm196. Je regrette, son devoir sur ce sujet est bien meilleur que les vôtres, conclut-il, en mettant un terme à l’échange ».
C’est que, outre la problématique que j’avais élaborée, je fus le seul, par mon goût pour l’étymologie, à soutenir pourquoi et à montrer comment l’adverbe « trop », au centre du sujet proposé, tirait son origine du vocable « troupeau », ce qui frappa l’enseignant. J’en fis toute une série de développements sur le cheptel (moutons, boeufs, etc.).
Si, par bonheur, je retrouvais cette copie dans mes archives, c’est avec intérêt que je le partagerai avec les Ivoirien(ne)s. Cette expression populaire devenue le slogan d’un mouvement pacifique ivoirien a aussi été le titre d’une célèbre chanson de Philippe Clay, Trop c’est trop197, qui remporta un vif succès et dont beaucoup prétendent, en France, qu’elle colle encore à l’actualité.
En tous les cas, il appert que Laurent Gbagbo met toujours un soin particulier à choisir ses formules qu’il se plaît, parfois voire souvent, à obscurcir pour en masquer la signification stoïcienne.
Au lecteur attentif qui nous a fait, comme Chrysippe, « marcher de question en question »198, se peut-il qu’il donne son assentiment à la livraison d’une ultime réflexion, qui surgit ainsi : lorsque Laurent Gbagbo qualifiera de « calamiteuses » les élections qui le porteront au pouvoir, en 2000, qu’a-t-il donc voulu signifier ? Car le mot peut se méditer à la lumière d’une pensée remarquable énoncée par un illustre stoïcien, Sénèque, dans son ouvrage De la Providence (De Providentia) : calamitas uirtutis occasio est199 : « La calamité est une opportunité pour la vertu ».
Voilà, eut dit Milord Stanhope, une méditation qui vaut pour demain.
Dr Pierre Franklin Tavares, Bourg-la-Reine, le 4 août 2025.
Pierre Franklin Tavares est un philosophe et homme politique Français né à Dakar, le 19 janvier 1956, de parents originaires de l’archipel du Cap-Vert
– Conseiller municipal d’opposition (divers gauche) d’Épinay-sur-Seine (93), de 2008 à 2024.
– Docteur en philosophie (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
– Consultant, politologue, conférencier
Pierre Franklin Tavares naît en 1956 à Dakar, alors ville coloniale française, et « commune de plein exercice », c’est-à-dire territoire français. Aussi par le sol naît-il français. Il fait une partie de son cycle secondaire aux lycées Gabriel Fauré à Paris et au lycée Henri-Wallon d’Aubervilliers. Il poursuit ses études supérieures à la Sorbonne où il obtient son doctorat de philosophie, ainsi qu’une licence d’histoire (Paris 1) et un deug de linguistique (Paris IV). Politologue et conférencier, il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages : Science de la Ban-Lieue (éd. Manuscrit Université), Le livre des Sodades (éd. Manuscrit Université), Sur la crise ivoirienne (N.E.I.) et Nicolas Sarkozy : relire le discours de Dakar (N.E.I). Il intervient également dans des émissions politiques (BFM TV, Africa n°1, Africa 24…).
Spécialiste de Hegel et l’un des meilleurs théoriciens de la Banlieue, ancien directeur territorial dans la Fonction Publique Territoriale, il est candidat aux élections municipales à Épinay-sur-Seine en 1995 et en 2008 (tête de la liste Pour une Ville juste envers tous), en 1997 (suppléant) aux élections législatives de la 1e circonscription de Seine-Saint-Denis, et en 1998 aux élections cantonales (Épinay-sur-Seine) .