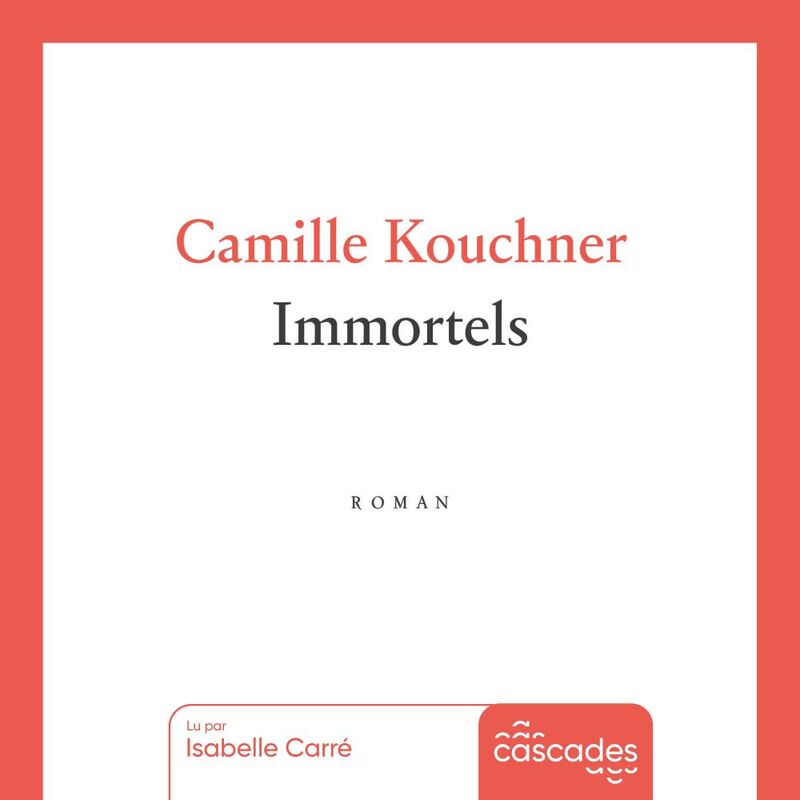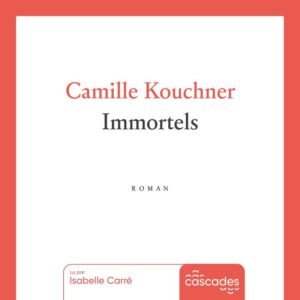
Vous avez dit silence tabou , non non il faut refuser la complicité du silence qui pérennise une pratique inacceptable et qui détruit l’autre. Protégeons nos enfants. Que les adultes se soignent, c’est mieux. P B CISSOKO
Camille Kouchner se met à la fiction avec « Immortels », sans délaisser les enjeux cruciaux de son premier livre
« Grandir à deux donne confiance. On partage tout, sans craindre le manque. Quand l’un défaille, l’autre prend le relais. Quand le second se perd, le premier l’aide à se retrouver. Dans ce lit d’hôpital, seule désormais, j’en fais le décompte. À deux, fille et garçon, j’étais au complet. »
Camille Kouchner est docteure en droit, maîtresse de conférences à l’Université. Elle est l’autrice de La Familia grande, publié aux Éditions du Seuil en 2021. Immortels est son premier roman.
L’écrivaine française est de retour en librairie, quatre ans après « La Familia grande », récit choc qui a révélé les violences sexuelles commises par son beau-père contre son frère quand il était enfant.
Par Valentin Etancelin
Extrait page 66
« Extrait : « Pour nous c’était simple. Nous n’avions qu’un corps, une même existence. La main de Ben était la mienne. Mon pied était le sien. Sa tristesse me dévastait et ma douleur le faisait pleurer. Sa joie me faisait éclater de rire et mon bonheur le surexcitait. À cet âge, c’est vivre seul qui nous paraissait triste. Quand les adultes s’interrogeaient sur l’absence de nos parents, nous, c’était plutôt sur les enfants uniques qu’on se posait des questions. Grandir à deux donne confiance. On partage tout, sans craindre le manque. Quand l’un défaille, l’autre prend le relais. Quand le second se perd, le premier l’aide à se retrouver. Seule désormais, j’en fais le décompte. À deux, fille et garçon, j’étais au complet. » (p.66)
ENTRETIEN – Après La Familia grande, Camille Kouchner interroge les catégories de la famille, du genre et des relations hommes-femmes dans son premier roman, Immortels.
Après le séisme sociétal de La Familia grande, qui a donné naissance au mouvement #metooinceste et à la création de la CIIVISE (Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants), Camille Kouchner publie aujourd’hui son premier roman, Immortels (1), qui interroge tant les structures familiales que l’identité de genre à travers l’histoire de K et de ses relations avec son jumeau de cœur, Ben. Entretien.
Madame Figaro .- Qu’est-ce qui vous a poussée à écrire ce premier roman?
Camille Kouchner.- Je me suis demandé ce qu’on faisait de son enfance. Le temps passe, on grandit, on vieillit, on fait des enfants, parfois, et que reste-t-il de son enfance ? Certains la célèbrent, d’autres la rejettent. Je fais partie de ceux qui n’ont pas gardé de souvenirs de leur enfance, et pourtant j’en ai bien fait quelque chose… J’ai songé que le roman m’aiderait à poser cette question-là, en inventant des personnages, avec l’idée de faire sentir cette présence de l’enfance dans chacune des décisions qu’on prend à vingt ans, à trente ans, à quarante ans. Et puis, évidemment, je me suis demandé si c’était différent quand on grandissait, quand on évoluait, selon qu’on était assigné homme ou assigné femme. Est-ce que l’enfance nous traverse de la même manière ? Résiste-t-on à la norme des adultes ? Comment ?
C’est une histoire de couple, ou plutôt de duo. Pourriez-vous nous parler de Ben et de K ?
J’ai cette particularité d’avoir été dans un lien de gémellité avec un garçon et j’avais envie de retranscrire encore ça, c’est-à-dire la confiance que ça donne dans l’humanité, indépendamment du sexe. Je voulais incarner cette idée à travers ces deux enfants du même âge, l’un garçon, l’autre fille. Allaient-ils évoluer de la même façon, aux mêmes moments ? Mais je n’avais pas envie que ce soit une histoire de couple. J’avais envie que ce soit une histoire d’amour. Ils grandissent en frère et sœur fusionnels, et dans le même temps, ils ne sont pas du même sang. Le roman veut questionner les catégories de la famille, de la femme, de l’homme, de l’amitié, de l’amour… Je crois que ce qui m’a donné l’impulsion de ce livre, c’est le lien entre Heathcliff et Cathy dans Les Hauts de Hurlevent, avec Cathy qui finit par affirmer «Je suis Heathcliff». Il n’est pas son ami, il n’est pas son frère, il n’est pas son amoureux : elle est lui.
On ne peut qu’être frappé par la violence de la parentalité, pères et mères prônant la liberté à tout prix et laissant les enfants livrés à eux-mêmes, sans jamais les écouter. Y a-t-il un lien avec la Familia grande , pour vous ?
Non, je ne crois pas ; ma mère était très douce, par exemple. Et puis je suis heureuse que La Familia grande ait pu aboutir à une prise de conscience sociétale et à des gestes concrets, mais pour moi, cette histoire fait partie du passé. Je trouve que c’est très important de ne pas rester focalisé sur une famille en particulier, parce qu’on risque sinon d’écraser la parole des autres. La question de l’incarnation, de l’iconisation, est une vraie question pour moi. Il ne faut pas qu’un cas singulier dissimule les 160 000 enfants par an victimes d’inceste, dont il faut absolument parler, de même qu’il faut continuer à travailler sur la sensibilisation, à mener des actions.
Reconstituer une identité cohérente
Nathalie Sarraute décrivait dans Enfance comme « les petits bouts de quelque chose d’encore vivant. »
Environnement familial dysfonctionnel
Vous aviez ainsi le désir d’éclairer certains non-dits ?
J’ai parlé parce que je n’avais pas le choix
Camille Kouchner
Vous avez toutes les deux expulsé votre « secret » à travers le processus créatif. Était-il essentiel d’aller « hors de soi » pour le faire ?
Camille Kouchner et Andréa Bescond : « Le courage, c’est d’avoir survécu »
In familia grandé « Dans notre société où dénoncer l’inceste et la pédophilie reste tabou, elles ont osé briser l’omerta. Andréa Bescond, avec un film, Camille Kouchner, avec un livre, partagent la même force de vie et la volonté de faire évoluer la loi.
Depuis que son livre est sorti, ce qu’il se passe « dans le réel » lui est devenu très dur à supporter. Il y a dix jours, nous rencontrions Camille Kouchner aux côtés d’Andréa Bescond. À 45 ans, la première venait de publier La Familia grande (Éditions du Seuil) parce qu’elle ne pouvait plus se taire. En écrivant comment son frère jumeau était abusé sexuellement par son beau-père, elle a provoqué l’onde de choc de ce qu’on appelle désormais l’affaire Duhamel. Pendant des années, pourtant, elle n’a « rien compris » de ce qu’il se passait dans la chambre d’à côté. Parce qu’elle était sous emprise. Sous emprise, la réalisatrice Andréa Bescond l’a été longtemps, elle aussi. Violée dès l’âge de 9 ans par un ami de ses parents. Elle en a fait un seul-en-scène puis un film, Les Chatouilles, en 2018. Toutes les deux ont eu le courage de briser le lourd silence des années plus tard, faisant fi du tabou, de l’omerta et du regard, redoutable, de leur propre mère.
Bénédicte Roscot
LITTÉRATURE – « K » comme Camille, peut-être. Ou « K » comme Kouchner ? Quatre ans après l’onde de choc provoquée par son premier livre La Familia grande qui dénonçait les coulisses de l’inceste dans sa famille, Camille Kouchner est de retour en librairie, ce vendredi 4 avril, avec la parution aux éditions du Seuil des Immortels.
Exit le récit autobiographique. L’écrivaine se lance, ici, dans la fiction. Son héroïne, dont on ne connaît que la première lettre du prénom (le fameux K), est à l’hôpital, où – souffrante d’un cancer du sein – elle s’apprête à subir une mastectomie. Là, dans cet environnement clinique, les souvenirs lui reviennent.
Plus précisément, ceux de son enfance marquée par son amitié inoubliable avec Ben. Fusionnels depuis la naissance, ils ont été élevés par leurs deux mères soixante-huitardes, elles aussi inséparables, dans les années 1980. L’élection de Mitterand, leur premier bisou, l’arrivée au collège… Bras dessus, bras dessous, ils entrent dans la vie ensemble, unis.
Parents toxiques
Mais tout ça ne durera pas. L’adolescence pointe le bout de son nez. Et Ben, sous l’influence de son grand frère et d’un père viriliste, devient insolent, beau parleur, quand K. creuse, elle, ses complexes et nourrit son obsession pour le regard des autres. Car voilà, lui est un garçon. Elle, une fille. Et c’est ainsi qu’ils ont été construits, puis divisés.
« Se méfier de la domination de classe, connaître ses avantages : toute ma vie, je te serai reconnaissante pour cette leçon, maman. Mais en dénigrant les filles de mon école, tu m’as initiée à une concurrence sans intérêt », écrit l’héroïne. Avant d’ajouter : « Les femmes, d’où qu’elles viennent, subissent l’ascendant des garçons, maman. Tu aurais dû me l’apprendre. Me préparer à me défendre. »
Avec Immortels, Camille Kouchner ne se contente pas d’une nouvelle histoire sur la construction binaire des genres. Elle va plus loin, en observant le devenir de deux enfants élevés par des parents toxiques, enjeu crucial qu’elle pointait déjà du doigt dans La Familia grande. Il n’est pas question ici d’inceste, mais d’autres formes de maltraitances infantiles.
Violences obstétricales
À 10 ans, K. n’a pas encore eu de rapport sexuel, ni même ses règles qu’elle est envoyée pour la première fois chez la gynéco. Genoux pliés, talons aux fesses, puis le spéculum jusqu’au bout. « En sursaut, je recule les fesses, je hurle. Cette douleur d’entaille, cette douleur de lame », se remémore-t-elle. À son retour, du sang coule de son pantalon. « Ben comme ça, ce s’ra fait », ironise sa mère.
Autour du même âge, c’est une remarque de son père qui la hantera plus tard. Alors qu’elle venait simplement déposer des affaires chez lui en allant faire un tour de roller avec Ben, il l’arrête : « Tu vas où habillée comme ça ? […] Ne viens pas te plaindre si tu te fais violer. Tu l’auras bien mérité. » Plus jamais elle n’enfilera ses patins.
Lui ne s’est jamais montré pudique. Dès ses 6 ans, quand elle prenait son bain, il « entrait, se présentait de trois quarts, sortait son sexe (pour uriner) et déblatérait », se souvient K., qui n’a pas oublié non plus ce jour où, rentrant de l’école, il lui a ouvert la porte sans caleçon. Il était « avec une dame ».
La « baise au secret imposé »
Quel poids la libération sexuelle, vantée par ses deux parents, a-t-elle eu sur elle, alors qu’elle n’était qu’une enfant ? Comment comprendre cette première fois, où elle dit s’être laissée faire, glissée dans le désir de l’autre ? Cette « baise au secret imposé », un viol sans le nommer ? K. s’interroge sur les mécanismes qui l’y ont conduite.
Et nous, sur la part de fiction et de vérité dans ces pages. De qui parle l’autrice ? Sa propre famille ? Difficile de ne pas voir dans la relation que K. noue avec Ben de possibles ressorts de son enfance avec son frère jumeau. Et quid du cancer ? Camille Kouchner a-t-elle aussi subi une mastectomie ? Comme K., l’homme qu’elle fréquentait s’est-il éloigné d’elle à l’arrivée de la maladie ?
Si son vécu personnel a forcément nourri ce récit, il n’en demeure pas moins universel. D’après une étude de la revue Cancer, une femme a six fois plus de risques qu’un homme de connaître une rupture après un diagnostic de cancer. Le signe que les suites de notre formatage genré vont bien au-delà de l’adolescence.
Camille Kouchner naît le 18 juin 1975, fille du médecin et homme politique Bernard Kouchner et de l’écrivaine et politologue Évelyne Pisier. Elle est la nièce du mathématicien Gilles Pisier et de l’actrice et romancière Marie-France Pisier[3]. À la suite du divorce de ses parents en 1984, elle est partiellement élevée par le second mari de sa mère, le politologue Olivier Duhamel[4]. Elle a deux frères dont un jumeau, ainsi qu’une demi-sœur et un demi-frère adoptés par sa mère et Olivier Duhamel.
Elle a deux enfants, et un beau-fils, avec le scénariste et réalisateur Thomas Bidegain avec qui elle a vécu « presque vingt ans ».
En 2021, Louis Dreyfus était son compagnon[6].
Études
Camille Kouchner fait ses études secondaires au lycée Henri-IV, puis au lycée Fénelon à Paris. Elle poursuit des études supérieures à l’université Panthéon-Assas, puis à l’université Paris-Nanterre où elle obtient un DEA de droit syndical et social en 1998, un DEA de théorie et philosophie du droit l’année suivante[réf. souhaitée], et, en 2004, où elle soutient sa thèse de doctorat de droit privé, De l’opposabilité en droit privé sous la direction d’Antoine Lyon-Caen, avec les félicitations du jury et la mention « très honorable »[7].