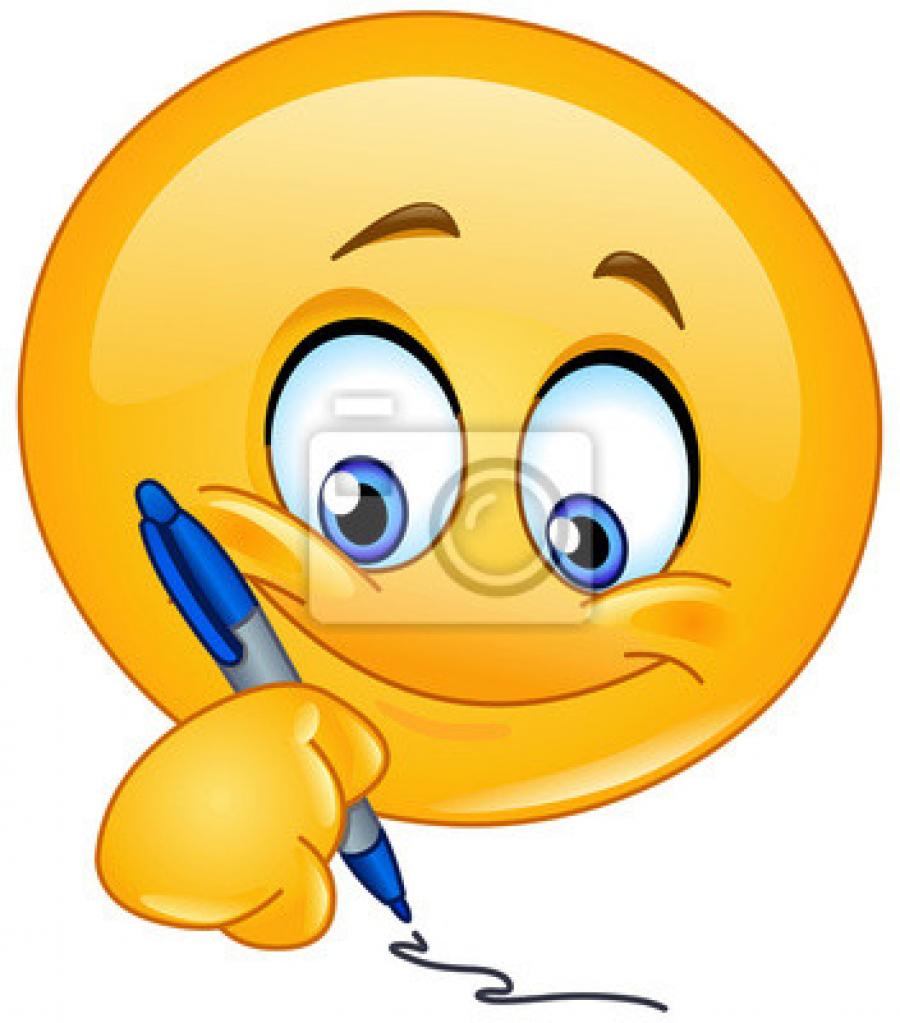La question mérite d’être posée, car certains signes ne trompent pas. Ces derniers temps, on entend parler de citoyens — y compris des responsables politiques — qui auraient vu leur voyage stoppé au dernier moment, sans explication officielle, et parfois après avoir rempli toutes les formalités. Hasard administratif ou simple précaution ? Peut-être. Mais quand ce genre d’épisode se répète, ne peut-on pas se demander si ce n’est pas un symptôme d’une crainte plus profonde ?
Dans une République moderne, la liberté de circuler et de s’exprimer devrait être une certitude, pas une faveur que l’on accorde après examen minutieux. Empêcher un opposant de quitter le territoire, sans justification claire, est une manière subtile de rappeler que, décidément, la République aime bien les surprises… surtout quand elles sont administratives.
Le contexte politique actuel, marqué par une tension perceptible, nourrit ces interrogations. Certains y verront une prudence légitime ; d’autres, un excès d’inquiétude. Dans tous les cas, pourquoi tant de mystère ? Pourquoi cette opacité ? Est-ce un nouveau service offert aux voyageurs, ou une méthode inédite pour tester la patience des citoyens ?
La démocratie, si elle se respecte, ne devrait pas craindre le débat. Empêcher un opposant de circuler ou de parler n’est pas un signe de force : c’est un indice certain qu’on préfère la tranquillité d’un silence imposé à la vitalité d’une confrontation d’idées. Un régime qui se méfie de la critique donne l’impression, certes involontaire, qu’il préfère l’applaudissement aux arguments.
La vraie force d’un État démocratique se mesure à sa capacité à affronter les désaccords dans la lumière, pas dans l’ombre d’interdictions floues. Un pouvoir fort n’est pas celui qui verrouille les portes d’embarquement ou qui scrute les opinions, mais celui qui écoute et assume. Car au final, ce ne sont pas les opposants qui font trembler la République, c’est la peur que le pouvoir nourrit lui-même.
I_Chroniques